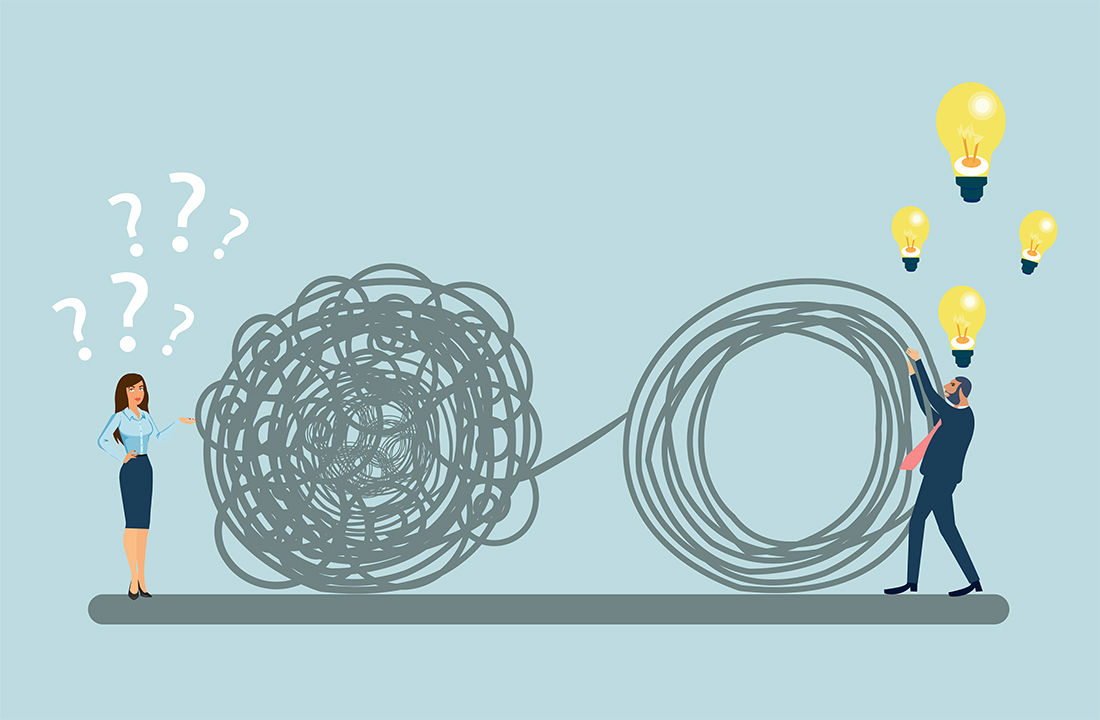Le 21 mai dernier, une partie de l’Ontario et du Québec ont été frappés par un phénomène météorologique peu fréquent, un derecho. Celui-ci a causé la mort d’une dizaine de personnes dans les deux provinces et des dommages matériels qui se chiffreront à des dizaines de millions de dollars. Un bilan humain et financier énorme, mais qui reste faible par rapport aux événements climatiques qui pourraient toucher la province à l’avenir.

« Ce que je crains, c’est qu’un jour, une ligne d’orages violents au Québec provoque 8 à 9 tornades la même journée. Je me demande sérieusement si c’est le genre d’événements auxquels nous sommes prêts à faire face », a commenté en entrevue avec le Portail de l’assurance Alain Bourque, directeur général d’Ouranos, consortium québécois sur la climatologie et l’adaptation aux changements climatiques.
M. Bourque est un ancien météorologue à Environnement Canada. Il se rappelle que le Québec a déjà connu un épisode de derecho il y a une quinzaine d’années. « J’étais dans les Laurentides. C’était la première fois de ma vie que je voyais des arbres passer à l’horizontale ». Il s’agit d’une perturbation climatique rare dans la province. Si les gens ne se souviennent pas de son nom après son passage en 2022, ses victimes auront en mémoire son ampleur.
Pour l’expert, le pronostic est sombre : « il ne faudrait pas se surprendre que ce genre d’événement se répète au cours des années à venir. Ce serait tout à fait cohérent avec les changements climatiques, dit-il. C’est comme si nos orages étaient “boostés” aux stéroïdes ». Il craint encore plus les inondations et les véritables canicules.
Un épisode qui va coûter cher au Québec
Au Québec, le derecho du 21 mai a causé des dommages particulièrement élevés en Outaouais, dans les Laurentides et Lanaudière ainsi que des dégâts plus faibles dans d’autres secteurs.
Partout sur son passage, des arbres se sont cassés ou ont été déracinés, des toitures arrachées, une personne est morte et des dizaines de milliers d’autres ont été privées d’électricité. La facture pour Hydro-Québec sera de plusieurs dizaines de millions de dollars, qui viendra s’ajouter aux indemnités aux assurés. Cet épisode de quatre heures va coûter cher au Québec et aux assureurs.
Heureusement, via un message d’alerte sur leur cellulaire, des millions d’utilisateurs ont été prévenus par Environnement Canada de l’arrivée et de l’ampleur de ces orages violents. Sans ce système, croit Alain Bourque, le nombre de victimes aurait été encore plus grand. Ce derecho a aussi épargné Montréal et Laval. « Considérant la densité de la population de ces deux grandes villes, le bilan aurait pu être pire », pense-t-il.
Des événements extrêmes plus fréquents
Ce qui s’est produit le 21 mai vient s’ajouter à la liste des désastres climatiques qui touchent le Canada depuis quelques années. Il cite les inondations majeures survenues au Québec en 2017 et 2019, la canicule insoutenable et les feux de forêt extrêmement importants en Colombie-Britannique en 2021. À s’ajoute les immenses crues en Alberta en mai 2020. La liste ne cesse de s’allonger confirmant les conséquences des dérèglements naturels.
« Au Québec, dit M. Bourque, on dit que l’on vient de traverser une petite canicule en mai. C’est des peanuts par rapport à celle qui a affecté une communauté l’été dernier en Colombie-Britannique où il a fait 49 degrés. Ce que je crains un jour, c’est dix jours de chaleur à plus de 40’C au Québec. Là, on pourrait parler de véritable canicule ».
Des solutions existent
La nature elle-même avait développé des mécanismes de protection devant ces dérèglements majeurs en s’aménageant des milieux humides et en creusant des rivières sinueuses qui absorbent l’énergie, mais l’homme les a souvent détruits. Il en paie aujourd’hui le prix. Le spécialiste souligne toutefois qu’il y a certaines choses à faire devant la montée de ces fléaux. Il cite un renforcement du code des bâtiments et de la façon dont on construit les infrastructures, des bons systèmes d’alerte, des assurances qui couvrent adéquatement ces sinistres ou encore l’éloignement des zones inondables.
Gérer la végétation différemment
Lors du derecho, la plus grande partie des dommages a été causée par la chute d’arbres. Même contre cela, on peut agir en amont. Comment ? « En gérant la végétation différemment », répond Alain Bourque. Les forêts pourraient être vulnérables aux sécheresses accrues, ce qui affecte la santé des arbres. Le Québec compte beaucoup de conifères et de pins, des espèces aux racines peu profondes. Lors de rafales très fortes, ils ont plus de chances de tomber. Il prône donc de la surveillance et des interventions préventives, notamment au moyen de l’émondage et de l’abattage comme veut le faire davantage Hydro-Québec. « On hésite toujours à couper un arbre, mais quand il devient trop dangereux, il faut passer à l’action, ce que les gens font peu », déplore-t-il.
Atteindre la carboneutralité
Il rappelle aussi l’importance de la réduction des gaz à effet de serre (GES). « C’est fondamental pour stopper la hausse des événements climatiques extrêmes, soutient-il. Mais tant qu’on n’aura pas atteint la carboneutralité, ces phénomènes destructeurs vont continuer à augmenter ».
Les gens ont l’impression qui si on réduit les GES dans un an ou deux, on aura des résultats et des retombées dans l’année qui suit, dit-il. Dans les faits malheureusement, ce n’est pas ce qui se passerait, prévient cet expert. La réduction des GES servira à stabiliser le climat en 2050, mais d’ici là, les impacts du réchauffement climatique vont continuer à s’accélérer avant de commencer à diminuer. C’est pour cela qu’il ne faut pas prendre des décisions uniquement sur le court terme en réaction à des événements récents, indique-t-il.
« On oublie que le climat va continuer à changer et que l’on va assister à une amplification de ces phénomènes, insiste M. Bourque. Ce qui s’est passé en Colombie-Britannique en est une belle illustration. Ce n’est plus juste une catastrophe, mais un cumul de catastrophes qui sont interconnectées et ça devient de plus en plus gros. Les gens pensent que la prochaine inondation au Québec va ressembler à celle de 2017 alors qu’elle pourrait être plus forte ».