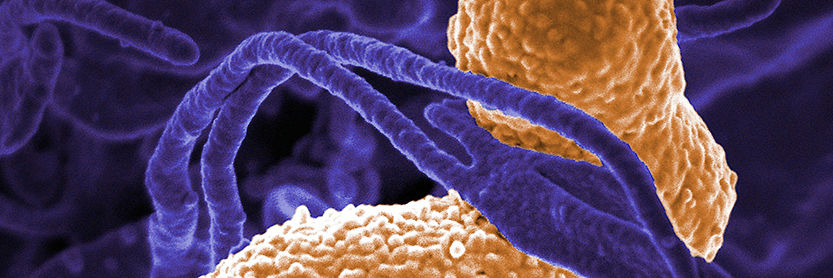« Dans la grande majorité des cas, les régimes d’assurance collective des employeurs couvrent déjà les couts des médicaments pour les maladies rares », rappelle Lyne Duhaime, présidente de la division Québec de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).
Gail Ouellette, fondatrice du Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO), se réjouit que des assureurs privés couvrent des médicaments pour les maladies rares, même ceux qui ne figurent pas sur la liste de la RAMQ et qui sont parfois très couteux. Elle cite notamment le cas du Soliris, qui peut couter 500 000 $ par patient. « C’est quand même incroyable qu’il soit payé par les assureurs », commente-t-elle.
Toutefois, elle rappelle que ces médicaments ne sont pas remboursés à 100 % par les assureurs privés et que les patients doivent en défrayer une partie eux-mêmes. Quand un médicament coute très cher – 20 000 $, 50 000 $, 100 000 $ et plus –, une quotepart de 20 % représente un montant très appréciable. Mme Ouellet signale aussi des problèmes chez des petites entreprises lorsqu’un employé réclame de tels médicaments.
La fondatrice du RQMO juge néanmoins que les assureurs privés doivent continuer à jouer un rôle de premier plan dans la couverture des médicaments pour les maladies rares, et que ce ne doit pas être exclusivement l’affaire de l’État. « J’ai très peur qu’il y ait un système unique public universel », a-t-elle confié au Journal de l’assurance.
En effet, l’Union des consommateurs et plusieurs syndicats québécois réclament un régime universel. « On craint pour les médicaments couteux. Ce n’est pas parce qu’il y aurait un régime public universel qu’il paierait tout. En plus, s’amènent des thérapies géniques innovatrices qui seront aussi très couteuses. Je ne vois pas comment un régime public pourrait payer tout ça », dit Mme Ouellet.
Pas juste pour bien paraitre
La consultante Claude Di Stasio, qui a longtemps travaillé à l’ACCAP et à la Société de compensation en assurance médicaments du Québec (SCAMQ), ne pense pas que les assureurs privés s’intéressent à la question des maladies rares et des médicaments orphelins uniquement pour bien paraitre aux yeux de la société. « La primauté de la décision, c’est qu’il y a une inégalité flagrante au niveau canadien pour le remboursement de certains médicaments. Dans certains régimes, il y a des pressions très fortes d’un employeur ou d’un syndicat pour refuser de payer, alors que d’autres régimes le font. »
Mais elle convient que l’appui des assureurs à cette cause nourrit des intérêts d’affaires. « Ce ne sont pas des gens sans travail, qui sont sur l’assistance sociale ou des ainés qui prennent des médicaments pour les maladies rares. Très souvent, ce sont des travailleurs actifs, ou leurs conjoints ou conjointes ou leurs enfants, qui en ont besoin. Un travailleur qui a un enfant malade peut perdre sa conjointe, sa maison, ne pas avoir la tête à son travail, faire une dépression. Tout ça est un cercle vicieux. »

Elle ajoute qu’on ne peut pas reprocher à l’industrie de vouloir rester en affaires et, ce faisant, permettre à sa clientèle d’avoir un accès équitable à des médicaments couteux. « Les entreprises aussi veulent rester en affaires, elles veulent des employés en santé, fonctionnels au travail, et ça fait partie de l’offre des avantages sociaux pour attirer des employés. Tout ça est relié. Les traitements ou médicaments pour les maladies rares, c’est juste un élément de plus à la couverture. »
Mme Di Stasio vante aussi le régime public-privé d’assurance médicaments du Québec, qui se répartit les clientèles, et elle souhaite la création d’un régime mixte semblable dans le reste du Canada. Pourquoi maintenir le privé alors que beaucoup de groupes au Québec réclament un seul régime, public et universel ? « Parce que les régimes collectifs privés comportent plusieurs types de couvertures d’assurance que n’ont pas les régimes publics », répond-elle.
Qui doit payer ?
Mais alors, financièrement, quel est l’intérêt de l’ACCAP à intercéder en faveur des gens qui souffrent de maladies rares, alors que cette clientèle est très éparpillée entre de nombreux petits groupes et que les médicaments pour les traiter peuvent s’avérer très couteux ? L’Association n’a pas fourni de réponse détaillée à cette question, préférant rappeler que les assureurs couvrent déjà les médicaments liés aux maladies rares.
Le mémoire que l’ACCAP a présenté en septembre 2018 au Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance médicaments amène toutefois des éléments de réponse. L’ACCAP y soutenait la création d’une liste nationale de médicaments payés par les régimes privés ou publics qui comprendrait les médicaments pour ces maladies.
« Les gouvernements devraient dresser la liste des médicaments qui devraient être couverts pour tous; soit par l’intermédiaire du régime d’assurance de l’employeur, pour ceux qui en ont un; soit par l’État, pour ceux qui n’en ont pas, écrivait l’ACCAP. Cette liste serait fondée sur des observations scientifiques et comprendrait les médicaments couteux et les médicaments pour les maladies rares. »
« Un choix de société »
Qui devrait payer pour ces derniers médicaments ? L’État ? Les assureurs, quand ce sont leurs assurés qui sont victimes de ces maladies ?
« Il s’agit d’un choix de société. Les deux sont possibles, mais avec des structures et des conséquences différentes, croit Pierre Hamel, directeur général de la SCAMQ. La réponse est : qui doit payer pour ce choix de société ? L’assurance couvre habituellement des évènements fortuits, inattendus et indépendants les uns des autres, de sorte que la loi des grands nombres fait son œuvre. L’incertitude se traduit en primes. »
Ce qu’il y a de particulier avec les maladies rares, génétiques ou chroniques, ajoute M. Hamel, c’est que ce sont des évènements connus d’avance dans un groupe assuré. « On connait le cout du médicament d’un assuré sur l’année suivante, de sorte qu’il n’y a pas ou peu d’incertitude. Le cout est tout simplement ajouté à la prime. Si le cout est absorbé par l’État, quel en serait le mode de financement ? L’impôt sur le revenu ? Une prime ? Le payeur est différent selon le choix de société. La question, à la fin, est : “À qui veut-on facturer ce choix de société ?” Peu importe le payeur ou le mode de paiement, il vient un moment où l’ensemble des couts se heurte à la capacité de payer de l’ensemble. »
Éviter la première page des journaux
Ce sont surtout les employeurs, syndicats et assurés qui prennent le risque, car au bout du compte, ce sont eux qui paient les primes, rappelle de son côté l’actuaire-conseil en assurance Jacques L’Espérance. « Parce que ces médicaments sont très dispendieux, les assureurs les analysent de près. S’ils les couvrent, c’est essentiellement soit parce qu’ils sont sur la liste de la RAMQ et sont donc obligatoirement couverts, soit parce que les assurés les demandent. Si les assureurs refusent, ils se retrouvent souvent en première page des journaux. »
La médecine personnalisée annonce déjà des médicaments très couteux, et les victimes de maladies rares exigent à bon droit de recevoir des traitements et des soins adaptés à leur condition même s’ils peuvent aussi être très dispendieux. La société, de même que les régimes privés et publics, parviendront-ils à répondre à tous ces besoins ? Au contraire, la facture risque-t-elle de devenir un jour trop grosse pour les contribuables et les assurés du privé ?
« Selon moi, répond M. L’Espérance, il est clair que la société québécoise, canadienne ou mondiale ne pourra continuer longtemps à supporter de tels couts. C’est pourquoi il y a énormément de discussions à cet effet ici comme ailleurs, et que des politiques de contrôle sont mises en place partout dans le monde. »
L’incidence sur les primes
Quelle pourrait être l’incidence sur les primes payées par les employeurs et les employés pour le maintien d’une couverture des maladies rares par et pour les assurés du privé ? L’ACCAP dit ne pas posséder de projections à long terme.
L’Association se fait plus nuancée sur la question du « qui doit payer ». « Les frais à la charge des assurés devraient être limités, possiblement en fonction des revenus, pour tous les Canadiens, écrivait-elle dans son mémoire de l’automne 2018. Nous recommandons que l’État travaille avec l’industrie à l’élaboration d’une solution. »
L’ACCAP suggère par ailleurs qu’on envisage un modèle national de partage des risques entre tous les payeurs (privés et publics) pour les médicaments à cout élevé, a précisé Lyne Duhaime au Journal de l’assurance.
« La solution passe par une mise en commun du risque et une mutualisation des couts. Il existe plusieurs moyens d’y parvenir. Par exemple, le gouvernement envisage actuellement l’élaboration d’un cadre de financement pour les maladies rares. »