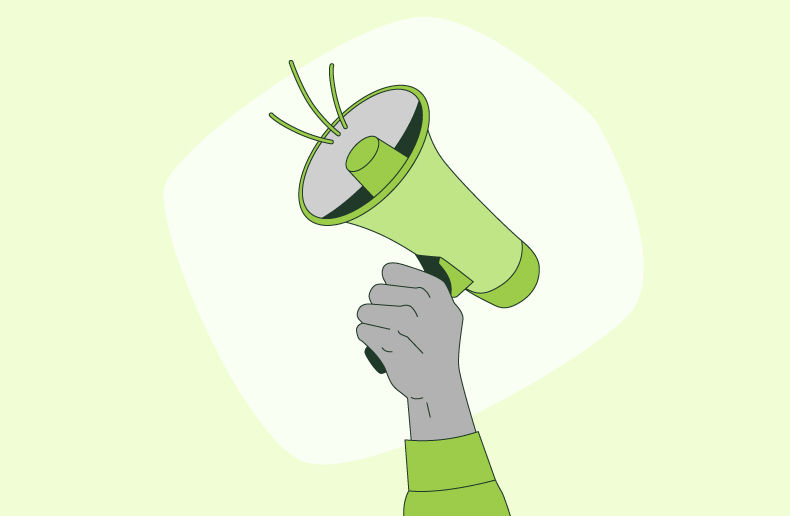Dans la plus récente édition de son bilan annuel, les chercheurs du Centre sur la productivité et la prospérité — Fondation Walter J. Somers (CPP) affirment que le Québec fait fausse route dans sa politique industrielle en usage depuis 25 ans. Le volume élevé de subventions accordées ne contribue pas à ralentir le déclin de son économie.
Les auteurs de l’édition 2023 du bilan, publié depuis 14 ans, sont trois chercheurs de HEC Montréal, Jonathan Deslauriers, Jonathan Paré et Robert Gagné.
Selon ce dernier, qui est directeur du CPP, « le gouvernement force le développement de créneaux qu’il juge prometteurs et cherche passivement à préserver des emplois dans des entreprises peu porteuses sur le plan de la productivité, de l’innovation et de l’investissement. Il en résulte un environnement économique peu stimulant qui tend à limiter la croissance économique au lieu de l’accélérer, avec les conséquences qu’on observe aujourd’hui ».
Cette politique industrielle interfère dans le processus de réallocation des ressources dans l’économie, en plus d’être inefficace et coûteuse, estime Jonathan Deslauriers. « Il ne s’agit plus simplement d’une question de gaspillage de fonds publics », dit-il en ajoutant que cette politique correspond à une époque révolue.
« Le gouvernement doit impérativement procéder à un diagnostic complet et sans complaisance de son approche en matière de développement économique, interventions économiques pour lesquelles il n’existe actuellement aucun recensement valable et encore moins d’évaluations rigoureuses de leur efficacité, ajoute Robert Gagné. Dans le cas contraire, le seul retard que la province parviendra à rattraper est celui qui la sépare de l’Ontario, une économie en perte de vitesse à l’échelle internationale. »
Robert Gagné n’en est pas à ses premières sorties concernant l’aide aux entreprises. Le directeur du CPP l’a fait en publiant le Bilan 2021 en mars 2022. Il l’a encore fait l’année dernière dans son rapport axé sur le manque de concurrence.
Conclusion sévère
Dans sa conclusion, le CPP souligne que la faible prospérité économique du Québec est une préoccupation des différents partis qui ont dirigé la province. Depuis plus de 25 ans, « le gouvernement du Québec tente de corriger le tir à travers une politique industrielle qui allie une politique fiscale complexe et onéreuse à des politiques publiques qui tendent vers le dirigisme économique ».
Les auteurs ajoutent : « La propension des entreprises demeure particulièrement faible, les retombées de leurs activités d’innovation sont marginales, et leur productivité est nettement inférieure à celle de leurs homologues occidentales. Au bout du compte, elles peinent à s’imposer sur les marchés étrangers, avec les conséquences qui s’ensuivent sur le plan de la croissance économique. »
Pour aider les entreprises québécoises à affronter la concurrence étrangère et à s’imposer sur le marché international, le gouvernement doit cesser d’axer ses politiques autour de l’emploi et sortir des secteurs peu porteurs en matière de croissance. Le rapport montre qu’en 2022, près de 80 % des sommes allouées sous la forme de crédit d’impôt étaient attribuées sur la base de l’emploi.
La fiscalité des entreprises ne doit plus cibler des secteurs industriels, mais favoriser l’ensemble des secteurs, indiquent les chercheurs du CPP. Les programmes d’aide et les politiques gouvernementales, incluant celles qui relèvent de sociétés publiques comme Investissement Québec, doivent être évalués, plaident-ils. « Il n’existe aucun recensement valable et encore moins d’évaluations rigoureuses de leur efficacité. »
Le poids de l’État
En 2022, les dépenses courantes des administrations publiques représentaient 30 859 $ par habitant au Québec, à parité de pouvoir d’achat. Ces dépenses étaient plus élevées qu’en Ontario (27 352 $) et au Canada (28 909 $), mais elles étaient inférieures à la moyenne de 33 543 $ pour les 19 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) analysés par le CPP.
Ce niveau des dépenses courantes par le Québec est 15 % plus bas qu’en Suède et 20 % plus faible qu’en Finlande, deux pays auxquels le Québec aime souvent se comparer. En plus, même si ces dépenses sont inférieures à la moyenne OCDE19, elles pèsent plus lourdement sur l’économie de la province en raison de sa taille relativement petite.
La productivité
Les fondements du retard économique du Québec sont documentés par le CPP depuis une quinzaine d’années. Entre 1981 et 2022, la productivité du travail a progressé en moyenne de 1,01 % par année, ce qui place le Québec en queue de peloton au sein du groupe OCDE19. Seule l’Italie (0,87 %) a fait pire durant la même période.
L’écart, qui était alors presque inexistant entre la productivité au travail au Québec et celle des autres pays de l’OCDE, atteint maintenant 31 %. Cela veut dire que chaque heure travaillée génère environ 23 $ CA de moins de produit intérieur brut (PIB) à parité des pouvoirs d’achat qu’une heure travaillée au sein du groupe OCDE19, une différence de près de 24 %.
L’évolution de l’investissement privé non résidentiel explique en bonne partie la faible productivité. Au début des années 2000, la propension des entreprises québécoises à investir était déjà plus faible qu’elle ne l’était chez leurs homologues occidentales. En moyenne, l’écart était d’environ 36 %, ou 8 000 $ de moins par emploi. Cet écart n’a fait que s’agrandir depuis et atteint désormais 12 736 $ par emploi. Et le Québec est en queue de peloton, comme on peut le constater ci-dessous.
La deuxième partie du bilan publié par le CPP s’attaque plus particulièrement à la politique industrielle. Le sous-investissement réalisé par le secteur privé s’explique par trois facteurs, selon les travaux réalisés par le CPP au fil de ses 15 ans d’existence.
Premièrement, les entreprises québécoises et canadiennes n’ont pas développé les réflexes nécessaires pour affronter la concurrence étrangère, car elles sont historiquement protégées des pressions concurrentielles externes par la situation géographique du pays et par des politiques publiques complaisantes.
Deuxièmement, alors qu’elle était dopée par un taux de change avantageux, la compétitivité de la production québécoise s’est effondrée lorsque le dollar canadien s’est apprécié au début des années 2000. Avec l’intégration des marchés mondiaux qui s’est accélérée à la même période, les entreprises du Québec ont rapidement été dépassées par les événements au cours des années suivantes.
Troisièmement, la politique industrielle n’a pas été ajustée en fonction des besoins changeants de l’économie québécoise. Le gouvernement continue de subventionner indirectement la création d’emplois au lieu de stimuler l’investissement, en plus de préconiser une forme d’interventionnisme au lieu de créer un environnement économique sain qui profite à toutes les entreprises.
« Preuve additionnelle de son inefficacité, la politique industrielle du gouvernement du Québec n’a pas généré de résultats supérieurs à ceux observés en Ontario, malgré les milliards de dollars supplémentaires qui y ont été injectés au fil du temps », écrivent les auteurs du bilan.
Stratégie coûteuse et inefficace
Si on mesure la valeur relative des crédits en fonction du PIB du secteur des entreprises, le Québec accorde 0,76 %, comparativement à 0,28 % en Ontario. Si on compare la valeur des crédits d’impôt offerts aux entreprises par rapport à l’impôt et à la taxe sur la masse salariale payés par les entreprises, le Québec y consacrait 12,7 % en 2022, comparativement à 6,1 % en Ontario.
« La stratégie fiscale du Québec a été de 2 à 3 fois plus coûteuse qu’en Ontario, sans pour autant générer de meilleurs résultats. » Pire encore, le CPP estime que la politique industrielle nuit au dynamisme entrepreneurial en favorisant les entreprises établies ou de grande taille, en plus de favoriser la survie d’entreprises qui seraient fermées sans l’aide de l’État.
Cela contribue à catalyser le phénomène d’entreprises zombies. Celles-ci connaissent une croissance faible, mais sans quitter le marché, ce qui est un processus normal dans une économie saine et dynamique. En plus de peser sur la productivité d’une économie, elles accaparent des ressources qui seraient mieux utilisées par des entreprises saines. Ces zombies font aussi concurrence aux autres entreprises au niveau du crédit, des salaires et des prix des extrants.