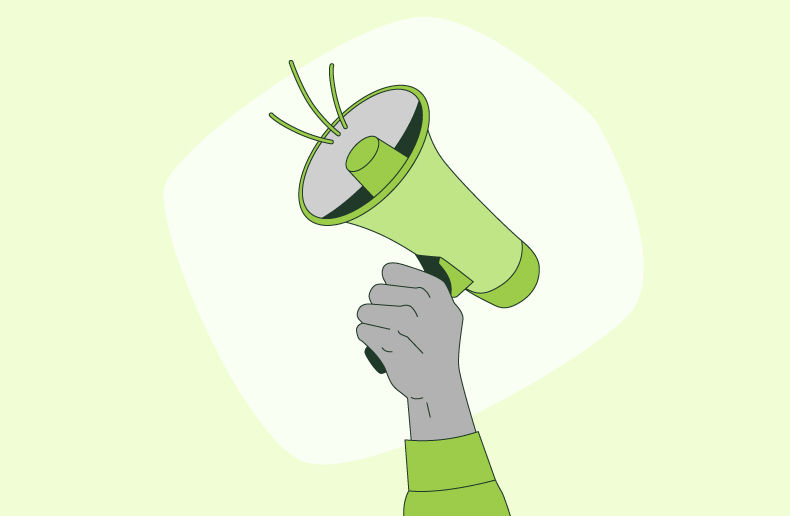Il y a un an, le gouvernement du Canada a achevé un investissement de 180,4 millions de dollars (M$) pour moderniser son réseau de radars météorologiques à travers le pays. Ces efforts suscitent l’enthousiasme des météorologues. Ils affirment que ces améliorations permettront de diffuser plus rapidement des alertes concernant les phénomènes météorologiques violents à court terme.
Le budget de 2024 prévoit un investissement supplémentaire de 6,9 M$ sur cinq ans. Ce qui offre au Service météorologique du Canada l’occasion de poursuivre le développement d’un système d’alerte précoce pour les événements météorologiques extrêmes. Il mettra un accent particulier sur les inondations et les marées de tempête.
« L’objectif est d’obtenir plus d’informations pour que nous puissions émettre des alertes, et que les Canadiens puissent utiliser ces informations pour se protéger », explique Gerald Cheng, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).
« Les conditions météorologiques violentes touchent tout le monde à un moment ou à un autre. Cela entraîne des conséquences économiques importantes et des impacts sociaux. Disposer de meilleurs équipements pour détecter ces phénomènes nous permet de fournir de meilleures informations au public », ajoute M. Cheng.
Alertes et données améliorées
Selon l’ECCC, les radars météorologiques représentent une avancée significative dans la technologie de prévision. Ils fournissent des mises à jour toutes les six minutes au lieu de 10, et leur portée a été étendue de 80 à 330 kilomètres. D’après Gerald Cheng, le réseau de 32 radars couvre désormais plus de quatre millions de kilomètres carrés, contre à peine plus d’un million auparavant.
En plus de remplacer les 31 radars existants du gouvernement, un autre a été ajouté dans la région de Lower Athabasca, en Alberta, ainsi qu’un radar de formation près d’Egbert, en Ontario, utilisé pour former les techniciens et tester de nouveaux équipements avant leur déploiement. Le premier radar a été installé à Radisson, en Saskatchewan, à l’automne 2017, et le dernier a été mis en place à Halfmoon Peak, en Colombie-Britannique, en août 2023.
Ces nouveaux radars offrent plusieurs fonctionnalités. La première est la double polarisation. Elle permet aux météorologues de distinguer différents types de précipitations, telle la pluie, la grêle ou la neige. Elle permet aussi une meilleure identification des cibles non météorologiques, comme les oiseaux, les insectes et les débris de tornades.
La deuxième fonctionnalité qu’identifie M. Cheng est l’extension de la portée Doppler, ce qui donnera aux Canadiens plus de temps pour se préparer en cas de conditions météorologiques extrêmes. Les nouveaux radars sont également plus puissants, permettant une meilleure pénétration des tempêtes. Là où les fortes pluies affaiblissaient auparavant les signaux, l’installation actuelle permet aux météorologues de voir à l’intérieur même des tempêtes.
La fréquence des mises à jour passe de 10 à 6 minutes et la portée augmente, ce qui constitue des avancées importantes, selon Daniel Henstra, professeur de sciences politiques à l’Université de Waterloo et co-responsable du groupe de recherche sur les risques climatiques de l’université.
Réalisés pour l’Université de Waterloo et le Waterloo Climate Institute, ses travaux ont contribué à l’élaboration des plans nationaux d’assurance du gouvernement contre les inondations.
« C’est significatif que la technologie ait énormément progressé. La fréquence des mises à jour est cruciale, car elle offre aux météorologues une image plus précise de la rapidité de déplacement d’un système », explique M. Henstra. « L’adaptation consiste à modifier les comportements des Canadiens. Une partie de cela consiste à être attentif à ces prévisions météorologiques. »
Ces nouvelles données pourraient aussi fournir aux Canadiens, ainsi qu’aux gouvernements et aux assureurs, des indications sur les zones où les risques sont les plus élevés.
Mieux investir en mitigation
Selon Daniel Henstra, les nouveaux radars sont un pas dans la bonne direction en matière de mitigation. « Avec l’accumulation de données à haute résolution, nous pouvons identifier les zones où les événements météorologiques extrêmes se produisent plus fréquemment et cibler les investissements fédéraux dans ces zones à risque élevé », dit-il.
Cependant, il souligne la rareté des fonds disponibles pour ces projets : « Nous ne pouvons pas dépenser de l’argent partout. Le gouvernement du Canada doit identifier les zones à plus haut risque et y investir en priorité », tranche M. Henstra.
Il critique aussi le système de subventions utilisé par le gouvernement. Les programmes de financement pour la mitigation sont souvent accessibles via des processus d’application, ce qui signifie que des municipalités bien équipées pour rédiger des demandes convaincantes sont parfois favorisées, même si elles ne sont pas les plus à risque. « Ce n’est pas forcément là où l’argent serait le plus utile », observe-t-il.
Les travaux de M. Henstra plaident également pour une approche plus réfléchie de la reconstruction après sinistre. Ils suggèrent que les fonds d’assurance inondation du gouvernement ne soient pas utilisés pour reconstruire dans des zones à haut risque.
Conscient que le programme d’assurance inondation du gouvernement vise à combler les lacunes de protection dans les zones à risque élevé, M. Henstra suggère que cela pourrait aussi être l’occasion pour le gouvernement d’explorer de nouvelles technologies. Parmi elles, les radars et des modèles de couverture qui bénéficieraient à l’ensemble du marché, pas uniquement aux ménages des zones à risque.
Assurances : affaire de données
Alors que les Canadiens utiliseront probablement les avertissements radar à court terme pour ajuster leurs comportements et limiter les pertes, les compagnies d’assurances, de leur côté, verront sans doute dans ces nouvelles données des opportunités à long terme.
« Elles ajustent constamment leurs tarifs pour s’assurer de rester rentables, sinon elles quitteraient ces marchés », affirme Henstra. « L’assurance a toujours été une affaire de données. Des données précises et actuelles sont essentielles pour fixer les prix de manière optimale. Et par optimal, j’entends un niveau de prix que les gens sont prêts à payer. »
Cartographie des plaines inondables
En réponse aux questions du Portail de l’assurance concernant l’utilisation des 6,9 millions de dollars supplémentaires, l’ECCC indique avoir lancé en mai 2024 un système de prédiction et d’alerte des inondations côtières. Le ministère ajoute que les avis et alertes concernant les inondations terrestres relèvent des autorités provinciales et territoriales.
« Pour ces avis et alertes, les partenaires provinciaux et territoriaux s’appuient sur le programme national hydrométrique, géré de manière coopérative », explique un porte-parole du ministère. « L’ECCC collabore étroitement avec ces partenaires pour améliorer la production, le partage et la diffusion des informations hydrométriques. »
Le ministère indique également avoir mis à jour les pratiques exemplaires de cartographie des plaines inondables, y compris les procédures fédérales hydrologiques et hydrauliques pour la délimitation des risques d’inondation, en collaboration avec Ressources naturelles Canada et Sécurité publique Canada. « Ce financement permettra à l’ECCC de continuer à soutenir et à promouvoir ces meilleures pratiques avec les intervenants provinciaux et territoriaux », ajoute-t-elle.