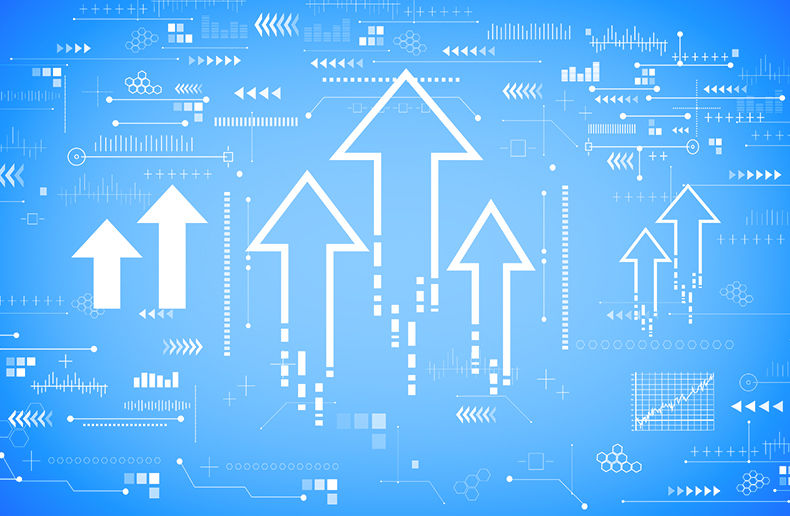Le mois de juillet a été le mois le plus chaud sur Terre depuis 1880, selon ce qu’a rapporté l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), le 15 aout. Cette même journée, Ottawa a lancé un nouveau portail visant à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ce dernier a été présenté par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM).
C’est d’ailleurs grâce à ce partenariat avec le CRIM qu’il a été possible de créer DonnéesClimatiques.ca. Il s’agit d’une plateforme qui cumule des milliers de données climatiques brutes conjuguées en un « outil simple à utiliser et facile à comprendre ».
Le portail réunit des données météorologiques qui montrent, par exemple, les jours les plus chauds, les jours les plus froids ou la quantité des précipitations, et ce, pour toutes les régions du Canada. À cet effet, le pays a été cartographié en zones de 10 km par 10 km et les données y sont présentées en suivants différents scénarios prévisionnels de réchauffement dans le temps. Il est possible d’y observer l’évolution de la température depuis les années 1950 et de remonter jusqu’à la fin du XXIe siècle.
Une bonne initiative, mais…
Présent lors de l’annonce, le directeur du Réseau inondations intersectorielles du Québec, et chercheur scientifique, anciennement de la division de recherche climatique à Environnement Canada, Philippe Gachon voit en ce nouvel outil « une bonne initiative ». Il espère la voir pérennisée, rappelant que le Canada est très en retard en matière de climat par rapport aux autres puissances mondiales et que ce n’est pas le premier portail du genre à être lancé par Ottawa.
Cette fois, l’outil nouvellement créé s’adresse d’abord aux décideurs, gestionnaires, dirigeants, agriculteurs, urbanistes, professionnels de la santé publique, ingénieurs et planificateurs.
« Ils ont besoin de posséder des renseignements plus pointus sur les changements climatiques pour mieux comprendre la situation et s’y adapter. Le but de cette plateforme est d’arriver à bâtir de la résilience, et pas seulement auprès des citoyens, mais des décideurs et des chefs d’entreprises », dit Catherine McKenna.
« Encore une fois, l’idée est bonne, mais le Canada doit cesser de faire cavalier seul. Il devrait davantage coopérer avec des groupes environnementaux, comme le Groupe d’observation de la Terre et chercher la collaboration avec les centres de recherches universitaires », dit M. Gachon, professeur à l’Université du Québec à Montréal. « L’environnement a besoin de main d’œuvre, mais c’est aussi le secteur le moins soutenu financièrement, tant au pays que par rapport aux autres pays membres du G7. Si tu veux être le plus à jour possible, tu as besoin d’aide et d’associations, poursuit-il. L’adaptation ne se fera pas en émettant des hypothèses. »
Pour le moment, les partenariats annoncés comptent le consortium Ouranos, le Pacific Climate Impacts Consortium (PCIC) de l’Université de Victoria et le Centre du climat des prairies de l’Université de Winnipeg.
À l’approche des élections, la ministre de l’Environnement plaide que son gouvernement à l’intention « d’être ambitieux » dans la façon de s’attaquer aux changements climatiques. « Le portail est en première ligne de ce plan », dit-elle.
Santé publique au cœur des préoccupations
« Les changements climatiques ont un réel impact sur les gens et sur les biens. Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde et trois fois plus dans le Nord », a dit la ministre McKenna lors de son allocution.
Le secteur de la santé publique a été priorisé par les experts et le gouvernement lors de la création du site. C’est qu’un mauvais environnement a de graves conséquences sur la santé.
« Au Canada, chaque année, 14 000 Canadiens meurent en raison de la pollution atmosphérique. C’est plus que le nombre de décès en lien avec le diabète, dit la docteure Claudel Pétrin-Desrosiers. Selon l’importante revue médicale The Lancet, les changements climatiques sont la plus grande menace sur la santé du XXIe siècle », ajoute celle qui est membre de l’Association canadienne des physiciens pour l’environnement.
La docteure insiste sur le fait que les changements climatiques ont de grosses conséquences sur la santé, sur les maladies du cœur et des poumons, sur le risque d’AVC et de morbidité, en période caniculaire, outre le fait d’exacerber les maladies chroniques qui touchent les personnes vulnérables.
Plus de maladies différentes
Dre Pétrin-Desrosiers explique que l’augmentation de la température du sol fait remonter les tiques à la surface de la Terre et favorise la transmission de la maladie de Lyme plus que jamais.
« L’augmentation globale de la température a un impact important sur plusieurs autres maladies transmises par des vecteurs ou des insectes, comme le virus du Nil et le choléra. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) prévient que si aucun changement n’est effectué, on met à risque l’apparition de maladies nouvelles et la trajectoire de certaines maladies », dit-elle.
Sans compter les répercussions sur la santé mentale, comme l’écoanxiété qui est très présente chez les jeunes et dans les communautés inuites qui ne reconnaissent plus leur territoire depuis la fonte des glaces. « Dans le contexte des grands changements actuels, il est de plus en plus ardu de se repérer dans un climat qui est totalement différent de celui qu’on a toujours connu. Il est donc difficile de s’y adapter », dit Alain Bourque, le directeur général d’Ouranos.
À titre d’exemple, « dans les zones côtières, le rehaussement du niveau de la mer et la calotte glaciaire qui disparait entrainent de plus en plus de vagues qui frappent les cotes et qui provoquent l’érosion des terres de façon accélérée. Les nombreuses infrastructures et communautés installées près des berges n’ont pas le choix d’entreprendre rapidement des actions pour se protéger. Maintenant, la grande question est : comment utilise-t-on les données pour prendre de nouvelles décisions et bien gérer les risques ? », se questionne-t-il, au cours d’un panel avec la ministre de l’Environnement. « Il va falloir s’adapter et à grande échelle. »
Pour le moment, seul le secteur de la santé publique a été développé, mais graduellement, d’autres secteurs seront ajoutés au portail, notamment le secteur financier qui suscite beaucoup d’intérêt. Cependant, il faudra compter un an avant l’arrivée de chaque nouveau secteur.