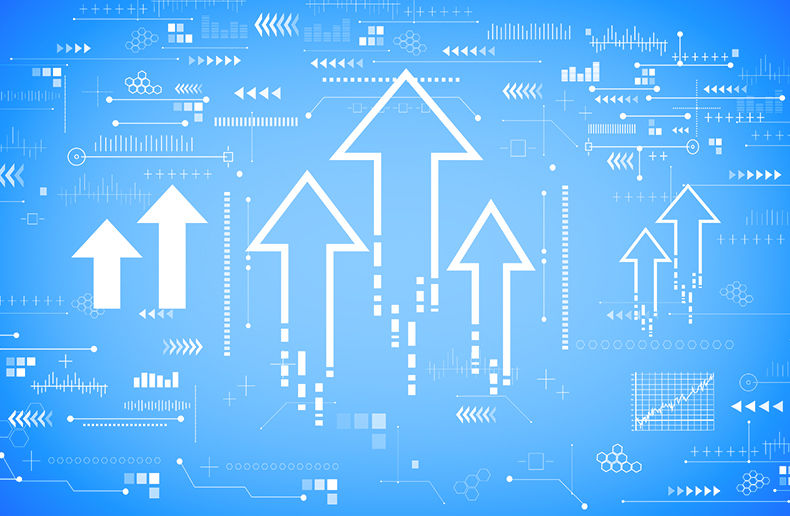Les municipalités devraient en faire plus pour soutenir leurs citoyens avant et après des inondations. Elles devraient aussi être davantage imputables pour ces efforts, estime Bernard Deschamps, dans sa thèse de doctorat réalisée à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Il aura fallu cinq ans à l’ancien président-directeur général de la Mutuelle des municipalités du Québec (aujourd'hui le Fonds d'assurance des municipalités du Québec ou Fonds FQM) pour mettre un point final à sa thèse, intitulée Gestion du risque d’inondations au Québec : vers une contribution accrue des municipalités.
Puisque l’aide financière pour indemniser les sinistrés après une inondation fluviale provient principalement des gouvernements provinciaux et fédéraux via des programmes, les municipalités ne sont pas enclines à en faire plus que le strict minimum, selon le doctorant. Pourtant, celles-ci sont « au cœur de la gestion du risque », une responsabilité qui leur est déléguée par Québec.
La facture continuera d’augmenter
Avec les changements climatiques, la facture des dommages ne cesse d’augmenter. Qui plus est, les inondations entraînent des dommages psychosociaux, écologiques et environnementaux affectant directement le quotidien de milliers de citoyens, particulièrement ceux qui habitent dans des zones considérées à risque.
Celles-ci ont pris de l’ampleur ces dernières années, mais les incitatifs à réduire les risques de sinistre, eux, n’ont pas été ajustés en conséquence, déplore Bernard Deschamps.
Ce faisant, un déficit de plus en plus important se creuse entre l’argent disponible pour indemniser les sinistrés, de plus en plus nombreux, et le coût des travaux. « C’est un écart croissant parce que les assureurs se retirent ou n’ont jamais été présents dans ces secteurs et parce que les gouvernements mettent des restrictions sur leurs programmes, énumère le doctorant. Donc, une charge [monétaire] plus importante incombe aux sinistrés. »
M. Deschamps relève aussi une forme d’iniquité due au fait que certaines personnes habitant des zones à risque sont sinistrées, et donc indemnisées, plus d’une fois, le tout à la charge de tous les contribuables dont les impôts financent les programmes d’indemnisation.
« Nous pourrions être incapables de faire face à ce genre de catastrophe dans le futur, argumente-t-il. Ce qu’on dépense aujourd’hui est emprunté : à quel point pourra-t-on supporter les réparations alors que les coûts continueront d’augmenter de façon importante ? »
Un « aléa moral » qui coûte cher
Parmi les 40 facteurs contributifs aux dommages qui ont été le plus mentionné durant nos entretiens, une vingtaine étaient sous l’influence des municipalités. Ça confirme que les municipalités pourraient agir davantage.
– Bernard Deschamps
Grâce à une revue de littérature et des entretiens avec 45 experts et acteurs du milieu municipal, Bernard Deschamps démontre que les villes disposent de plusieurs leviers d’action dans la prévention des sinistres par inondation.
Parmi les leviers d’action dont elles disposent, on retrouve entre autres une cartographie des lieux, le pouvoir d’aménager le territoire, des efforts de sensibilisation ou même le fait de forcer la relocalisation d’un immeuble.
« Parmi les 40 facteurs contributifs aux dommages qui ont été le plus mentionné durant nos entretiens, une vingtaine étaient sous l’influence des municipalités, précise-t-il. Ça confirme que les municipalités pourraient agir davantage. »
Ce faisant, leur inaction, pour la plupart, engendre un aléa moral, à savoir une déresponsabilisation coûteuse pour la société. « L’aléa moral est un concept économique qui suppose que lorsqu’une partie prenante ne [subit] pas de conséquences d’une situation, elle augmente sa prise de risque ou contribue à augmenter la prise de risque des autres parties », résume le doctorant.
M. Deschamps a également recensé plusieurs freins à l’action municipale, dont une gouvernance fragmentée. « Au Québec, on a 1007 municipalités, 89 MRC, les gouvernements fédéral et provincial et des organismes de bassin versant, énumère-t-il. Ça fait beaucoup de gens impliqués dans l’environnement et la prise de décision, ce qui rend difficile la prise d’une décision exécutoire et finale. »
Le fait que les responsabilités municipales soient déléguées par le gouvernement sans égard à la taille de chaque municipalité constitue un autre frein. « Une municipalité de 500 habitants n’a pas les mêmes outils qu’une autre qui compte 5000 citoyens, pourtant, elle a les mêmes obligations », déplore-t-il.
Les besoins immédiats et le roulement des élus évacuent aussi la planification à long terme qui permettrait de mieux prévenir des sinistres. « C’est la question d’avoir un terrain, et de permettre à un promoteur d’y construire un immeuble à logements plutôt que de le garder pour en faire un parc éponge », illustre le doctorant.
Enfin, relève M. Deschamps, un autre frein à l’action municipale réside dans l’absence d’incitatif à réduire le risque après une inondation. « Les indemnisations sont offertes aux individus, pas aux municipalités, note-t-il. L’individu qui va être indemnisé trop souvent pourrait être pénalisé, mais pas la municipalité où il vit. »
Pour un nouveau modèle
Tant qu’à dépenser de l’argent, aussi bien le faire pour réduire les risques et les coûts futurs.
– Bernard Deschamps
Le point culminant de la thèse de Bernard Deschamps consiste en un modèle de contribution proportionnelle au risque pour impliquer davantage les municipalités.
Ce modèle vise à la fois à réduire, voire éliminer, l’aléa moral observé et à diminuer l’iniquité observée dans les programmes d’indemnisation. Il a été conçu grâce aux rôles d’évaluation et aux cartes des zones inondables de 2022 auprès de trois municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
« On a réalisé que quelques mesures d’atténuation pourraient rendre assurables 68% des bâtiments dans les zones à risque, et que leur taux d’endommagement annualisé correspond à moins de 1% de la valeur foncière [de la municipalité] », explique Bernard Deschamps.
Environ 13% des immeubles en zone à risque ne pourraient être réchappés qu’en étant déménagés, selon les estimations du doctorant, dont le modèle a été validé avec le cadre règlementaire modernisé de la nouvelle cartographie des zones inondables qui a été publié plus tôt cette année. Le déploiement de la future cartographie elle-même devrait débuter en mars 2026.
Bernard Deschamps propose que les municipalités contribuent financièrement à la prévention des risques et à l’indemnisation des sinistrés. Comme elles ont le pouvoir d’imposer des taxes spéciales ou sectorielles, elles seraient en mesure de créer un fonds pouvant servir à ces fins, entraînant du même souffle leur responsabilité.
Une telle proposition ne passe toutefois pas comme une lettre à la poste du côté des municipalités. Certaines arguent que de tels efforts seraient un coup d’épée dans l’eau si leurs voisines ne font rien.
« Quand on parle de résilience, si on souhaite l’améliorer, il faut passer d’une logique d’indemnisation à une logique d’investir en amont, stipule M. Deschamps. Tant qu’à dépenser de l’argent, aussi bien le faire pour réduire les risques et les coûts futurs. »
Autres recommandations
Parmi les autres recommandations de la thèse : la mise à jour des codes du bâtiment pour « construire mieux » et l’attribution d’une cote de résilience aux immeubles.
Le doctorant insiste aussi sur la nécessité de mieux évaluer le risque et pour gérer celui-ci par bassins versants pour forcer une action concertée.
« Il faut du courage politique », reconnaît M. Deschamps, pour qui les sommes versées par les gouvernements supérieurs ne devraient pas systématiquement être transférées aux citoyens.
« Et si on liait les indemnités disponibles à la performance d’une municipalité? Si celle-ci met un certain nombre de mesures [préventives] en place, elle a droit au bonbon, suggère-t-il. Le programme d’aide aux sinistrés pourrait être offert uniquement aux municipalités qui font leur part du travail. »