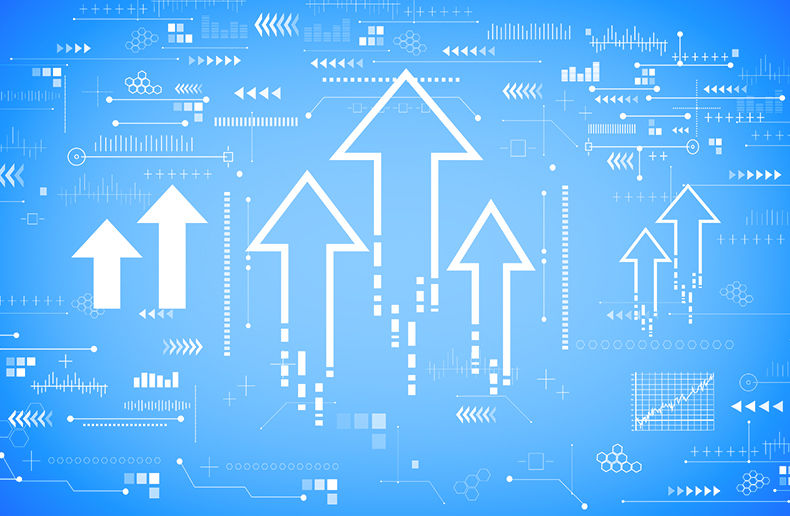Le Québec n’est plus qu’à un pas de sa cible de 10 % de fumeurs qu’il s’était fixée en 2025 dans sa stratégie Pour un Québec sans tabac. La proportion de fumeurs a diminué dans la population de 12 à 11 % entre 2020 et 2023. Bien qu'il s'agisse d'un jalon encourageant, le vapotage a gagné en popularité durant la même période, surtout chez les 20-24 ans.
Ces données sont tirées de la plus récente Enquête québécoise sur le tabac et les produits de vapotage, dont les résultats ont été publiés le 11 août par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dans un rapport intitulé Portrait du vapotage et de l’usage de la cigarette au Québec en 2023.
Une première enquête a été menée en 2020 et une seconde en 2023, ce qui permet aux chercheurs de suivre l’évolution de la consommation durant cette période. La plus récente a confirmé le recul constant du tabac amorcé depuis plusieurs années.
« Le Québec a longtemps été la province où la proportion de fumeurs était la plus élevée au Canada, a commenté la chercheuse et coautrice du rapport Annie Montreuil en entrevue avec le Portail de l’assurance. Nous avons fait de grandes avancées et rattrapé plusieurs provinces, mais l’Ontario et la Colombie-Britannique ont encore des proportions de fumeurs plus faibles qu’ici. »
Bien que le vapotage constitue l’un des enjeux de l’heure en santé publique, rapporte l’INSPQ, le tabagisme représente toujours un des principaux facteurs de mortalité évitable au Québec et ailleurs au Canada.
Plus forte baisse chez les hommes
Le recul du tabagisme au Québec s’observe surtout chez les hommes, où il est passé d'une prévalence de 14% en 2020 à 12% en 2023. Cette baisse a été légèrement plus faible chez les femmes, soit de 11 à 10 %.
À l’exception des 15-17 ans (3%), c’est chez les 65 ans et plus que l’on fumait le moins (8%) en 2023. À l’opposé, c’est chez les 25-44 ans et les 45-64 ans que le tabac était le plus populaire, avec une proportion d'environ 12% de personnes ayant fumé dans les 30 jours précédents l’enquête.
La plus importante réduction a cependant été notée chez les 25-44 ans. La prévalence a fléchi de 3% entre 2020 (15%) et 2023 (12%).
« Notons également que la proportion de fumeurs quotidiens a diminué entre 2020 et 2023 », souligne le rapport de l’INSPQ. Elle est passée de 9 à 7 %, alors que la proportion de fumeurs occasionnels est demeurée stable, à environ 3%.
Éducation et revenu
L’Enquête démontre le lien étroit entre l’usage du tabac et le niveau de scolarité. La proportion de fumeurs est plus importante chez les gens moins scolarisés (14%) que chez les diplômés d’études secondaires (11%) ou universitaires (7%).
Le revenu familial est lui aussi associé à la cigarette. Plus le revenu – qui est divisé en quatre catégories – est important, moins la prévalence de fumeurs de tabac est grande. Elle passe ainsi de 14% chez ceux dont le revenu est « faible » à 7% chez ceux au revenu dit « élevé ».
Les personnes nées au Canada (11%) fument davantage que les personnes installées au pays (8%), qu’ils y soient depuis plus ou moins de 10 ans. Les membres de la communauté LGBTQ2+ seraient aussi plus nombreux à fumer (16%), que les non LGBTQ2+ (10%). « On retrouve une proportion particulièrement élevée de fumeurs parmi les personnes âgées de 45 à 64 ans s’identifiant comme LGBTQ2+ », observe l'INSPQ qui chiffre cette prévalence à 29%.
Le vapotage pour cesser de fumer
« Près des deux tiers (65 %) des fumeurs québécois de 15 ans et plus affirment vouloir cesser de fumer dans les six prochains mois, dont de fortes proportions de 25-44 ans (67 %) et de 45-64 ans (69 %) », indique le rapport.
Par ailleurs, le tiers des Québécois de 15 ans ou plus qui ont tenté de cesser de fumer ou ont cessé depuis moins de deux ans affirment avoir utilisé une cigarette électronique pour y parvenir. C’est particulièrement le cas chez les 18-19 ans (49 %), les 20-24 ans (50 %) et les 25-44 ans (42 %).
Environ 31 % des fumeurs qui ont voulu arrêter ou y sont parvenus ont eu recours aux aides pharmacologiques, et 17 % ont consulté un professionnel de la santé.
Hausse marquée du vapotage chez les 20-24 ans
C’est dommage qu’après avoir réussi à détourner la majorité des jeunes du tabac, ils deviennent dépendants d’un autre produit de nicotine.
– Annie Montreuil
Le rapport révèle que 7 % des personnes de 15 ans et plus ont vapoté au cours des 30 jours qui précédaient l’enquête 2023. Cette proportion était de 4 % en 2020.
De 2020 à 2023, la proportion de vapoteurs chez les 20-24 ans a bondi, passant de 13 à 23 %. Il s’agirait des ados qui avaient commencé à vapoter en 2018 et qui n’ont jamais arrêté devenus jeunes adultes.
Cette forte hausse en seulement trois ans inquiète la chercheuse Annie Montreuil parce que la cigarette électronique contient de la nicotine et qu’arrêter de vapoter s’avère aussi difficile que d’arrêter de fumer.
« On se retrouve donc avec une nouvelle génération – les adolescents et les jeunes adultes – qui ne fume pas la cigarette, mais qui est dépendante de la nicotine, relève-t-elle. L’aérosol n’est pas aussi nocif que le tabac, mais des chercheurs observent des atteintes aux poumons chez les jeunes vapoteurs. »
« C’est dommage qu’après avoir réussi à détourner la majorité des jeunes du tabac, ils deviennent dépendants d’un autre produit de nicotine », ajoute Annie Montreuil.
Usage quotidien
La moitié des personnes ayant utilisé la cigarette électronique au cours des 30 jours précédant l’enquête l’ont fait tous les jours, 23 % au moins une fois par semaine et 27 % au moins une fois par mois. « La hausse de la proportion de vapoteurs quotidiens entre 2020 et 2023 est particulièrement marquée chez les 18-19 ans (38 à 53 %) et les 20-24 ans (39 à 48 %) », souligne l’INSPQ.
Pas un phénomène passager
La prévalence du vapotage diminue toutefois avec l’âge. Elle passe à 9 % chez les 25-44 ans, à 3 % chez les 45-64 ans et elle s’élève à peine à 1 % chez les 65 ans et plus.
Comme c’est le cas pour le tabac, on observe moins de vapoteurs chez les plus scolarisés. La prévalence est de 4 % chez les diplômés universitaires et de 8 % chez les détenteurs d’un diplôme d’études professionnelles ou collégiales.
« Les données colligées en 2023 nous indiquent que le vapotage n’est pas un phénomène passager en voie de se résorber », indique le rapport de l’INSPQ.
Annie Montreuil croit toutefois que la décision de Québec en octobre 2023 d’interdire la vente de liquides de vapotage aromatisés et la diminution de la concentration de nicotine va réduire l’attrait des cigarettes électroniques auprès des adolescents.
Interdire le tabac dans les immeubles ?
18% des personnes de 15 ans et plus disent avoir été exposées à la fumée de tabac par leurs voisins au courant des 30 derniers jours précédents l’enquête, et 11% à l’aérosol de cigarette électronique de cette même manière. Cette exposition n’est pas sans risque pour leur santé.
« Au Québec, la loi interdit de fumer dans les espaces communs des immeubles résidentiels de deux logements ou plus depuis 2015, mais il est permis de fumer à l’intérieur des logements, rappelle l’INSPQ dans son rapport. Le seul moyen efficace de protéger les non-fumeurs de l’exposition à la fumée de tabac est la mise en place de politiques interdisant complètement de fumer dans tous les lieux intérieurs, y compris dans les logements privés. »
Est-ce réaliste? Une interdiction complète de fumer dans des immeubles fortement subventionnés aux États-Unis est en vigueur depuis 2018, note le document. « Sans surprise, commentent les chercheurs québécois, une telle mesure pose des défis d’application, et n’a pas nécessairement apporté les résultats escomptés jusqu’à maintenant. »