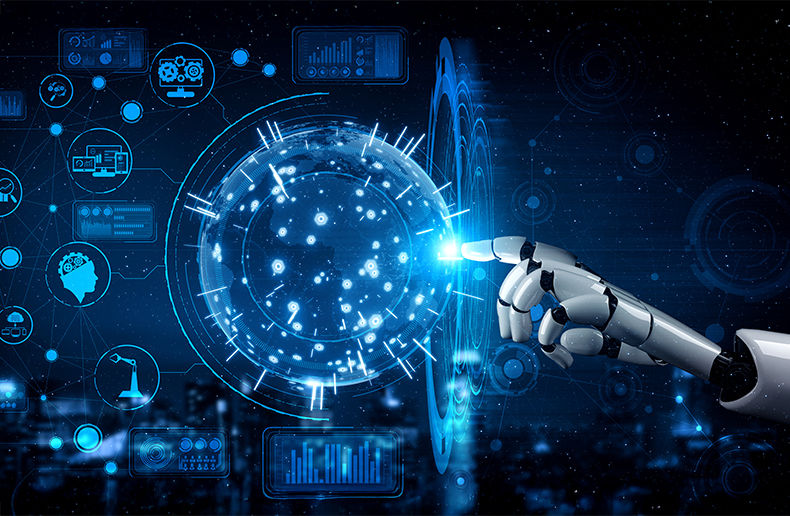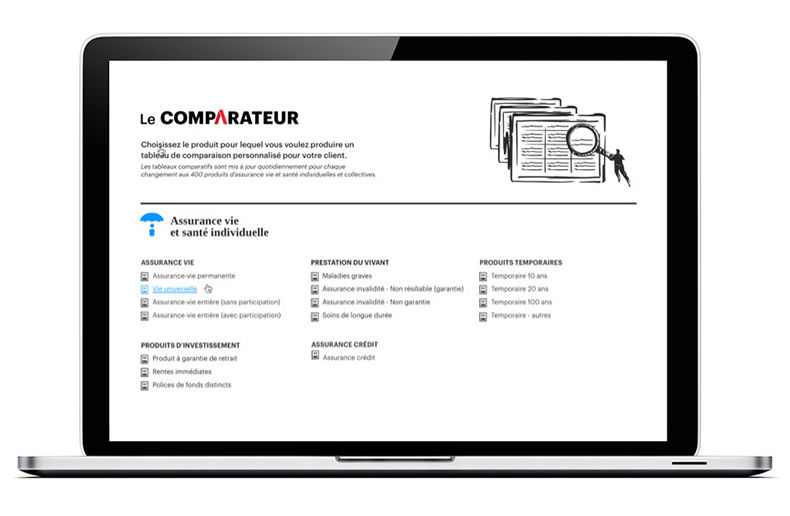Des conseillers en assurance collective recommandent aux employeurs de moduler les couvertures de soins paramédicaux plutôt que de les couper. Ces couvertures peuvent avoir un effet bénéfique pour les employés ayant des problèmes de santé mentale. Les restreindre pourra avoir l’effet contraire.Les soins paramédicaux sont souvent pointés du doigt lorsque l’employeur doit freiner les dépenses d’assurance collective. Mais couper à blanc dans ces couvertures peut affecter des traitements qui auraient permis à des employés de revenir au travail plus rapidement. Une situation fréquente dans les cas de santé mentale.
Les coûts de la santé mentale demeurent d’ailleurs la bête noire des régimes d’assurance collective.
l’Association canadienne pour la santé mentale estime que près de trois millions de Canadiens vivront une dépression à un moment ou l’autre de leur vie et qu’un Canadien sur cinq souffrira d’une maladie mentale.
Cette tendance générale se reflète en entreprise. Selon un sondage Ipsos Reid (Mental Health in the Workplace) mené auprès d’entreprises canadiennes, près de 600 000 employés ont rapporté avoir reçu un diagnostic de dépression clinique en 2007.
D’ailleurs, en 2007, les demandes de règlement pour des problèmes de dépression comptaient pour 7,22 % du total des demandes et occupaient ainsi le second rang, derrière l’hypertension artérielle, indique pour sa part ESI Canada dans son numéro spécial sur les 100 principales classes thérapeutiques de 2007.
Perte de 10 000 $ par année
Le sondage d’Ipsos Reid révèle en outre qu’un médicament destiné à traiter la dépression, l’anxiété et les troubles paniques arrive deuxième parmi les 10 principaux médicaments vendus au Québec. Les coûts annuels par patient oscillent entre 220 $ et 880 $. D’après le sondage, un seul cas de dépression équivaut à une perte de 10 000 $ par année pour une entreprise.
Un autre rapport, celui de Watson Wyatt Au travail! Canada 2007, indique que 82 % des demandes de règlement d’invalidité de courte durée et 72 % de celles de longue durée sont liées au stress et aux problèmes de santé mentale. L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) affirme que 50 % des absences du travail sont liées à la maladie mentale.
La pression sur les coûts des régimes est telle qu’employeurs et fournisseurs de régimes se demandent où couper. Ce sont alors souvent les « peutes » et les « pates » qui écopent. Pas toujours pour le mieux, estime Frédéric Venne, conseiller principal chez Aon Conseil.
Dans sa pratique, M. Venne remarque que les principales causes d’invalidité en entreprise sont d’ordre psychologique et musculo-squelettique. Souvent la cible des coupes, certains soins paramédicaux sont pourtant cruciaux dans la réhabilitation de ces troubles de santé, soutient celui qui a participé à la révision de plusieurs régimes de grandes entreprises au Canada ces dernières années, dont celui du Groupe Transcontinental.
« Si je limite la durée d’un traitement de physiothérapie ou de psychothérapie, je risque d’interrompre un traitement qui aurait permis à l’employé de revenir plus vite, prévient-il. Si trois visites de plus chez le psy ou le physio à 100 $ l’heure permettent à l’employé de revenir une semaine ou deux plus tôt, l’entreprise est gagnante. Surtout quand on sait que l’assurance invalidité coûte en moyenne de 500 $ à 600 $ par semaine en prestations. »
Il déconseille aussi de limiter les frais de laboratoire. « Une limite de 300 $ sur ces frais pourrait être contraignante dans le cas d’un traitement de scanner qui coûte de 600 $ à 700 $. »
Lorsque M. Venne révise un régime, il cherche à maximiser le retour sur l’investissement pour l’employeur. « Ma philosophie consiste à contrôler les coûts sur les éléments que les assurés peuvent budgéter eux-mêmes pour libérer des dollars vers les couvertures qui ont un impact direct sur leur santé, et donc sur la durée de l’invalidité. »
Dans cette perspective, les «pates» se prêteront mieux à des limites (massothérapie, naturopathie, chiropractie, etc.). « Ces couvertures sont de type style de vie, alors que la physiothérapie, la psychologie et les frais de laboratoires sont davantage de l’assurance parce qu’elles prémunissent contre des imprévus, défend M. Venne. Ce que je suggère souvent aux entreprises, c’est d’imposer une limite globale pour tous les soins paramédicaux, disons 600 $ à 700 $ par an, sauf aux soins de physio et de psycho. »
M. Venne préconise plutôt une approche de « frais raisonnables et coutumiers » pour limiter ces deux couvertures essentielles, par exemple 90 $ par rencontre chez le physiothérapeute et 100 $ de l’heure pour le psychologue. Le traitement ne doit pas non plus s’éterniser. Si l’employeur ou le gestionnaire de régime constate que le traitement n’est pas efficace, il faut le changer », conseille-t-il.
Il applique aussi cette mesure de frais coutumier et raisonnable aux médicaments, pour limiter les trop grands écarts de coût d’une pharmacie à l’autre et inciter à la consommation de médicaments génériques. Dans le cas où il n’existe pas de générique pour un médicament, il suggère d’opter pour une thérapie alternative qui pourrait faire l’affaire et pour laquelle il existe un médicament générique.
L’idée, dit-il, est d’amener les employés à se sensibiliser sur leur consommation de médicaments. Or, le tout doit reposer sur un solide programme de communication et de formation de la part de l’employeur. « Je n’implante pas ces changements dans une entreprise qui ne veut pas s’impliquer dans la communication. »
Prendre les devants
Vice-présidente chez AON Conseil et responsable de l’unité de gestion des absences, Johanne Potvin et son équipe de spécialistes sont à même de constater les dégâts que cause une absence prolongée.
Conseillers principaux au sein de cette équipe, Gilles Normandeau et Francine Lahaise rapportent des chiffres préoccupants d’un colloque international sur la santé mentale. « Après six mois d’absence pour cause de santé mentale, la moitié seulement des employés revient à son poste d’origine de façon pleinement fonctionnelle. Après un an d’absence, cette proportion chute à 20 % et après deux ans, elle chute à quelques décimales. »
Il faut à tout prix éviter la prolongation de l’absence, dit Mme Potvin. Un bon pas en ce sens consiste à prévenir, soutient Mme Potvin. « Tout se déroule mieux dans la gestion de l’absence et du retour au travail lorsqu’il y a eu des interventions avant le départ de l’employé. »
Selon elle, cette prévention est essentielle et même plus facile à réaliser dans les cas de troubles mentaux. « Sauf les cas d’événements post-traumatiques que l’on ne peut prévoir, les troubles de dépression et d’adaptation devraient être l’objet d’une intervention de la part de l’employeur trois à six mois avant le départ. »
Autrement, l’affaire traîne facilement de neuf à 12 mois, le temps que l’invalidité court terme se termine (soit 17 ou 26 semaines en général) et que l’assureur commande une expertise médicale, croit-elle. L’approche intégrée est, selon Mme Potvin, la seule réponse efficace à ce problème : toutes les parties concernées doivent se concerter, et cela comprend l’assureur, l’employeur, l’employé, le médecin traitant et tout service externe d’aide.
Cette concertation permettra par exemple de désamorcer un mauvais diagnostic émis par le médecin traitant. L’équipe de Mme Potvin observe des cas où le médecin de l’employé, souvent un généraliste, prescrit un antidépresseur à la hâte pour un trouble d’humeur, par exemple, alors qu’un autre traitement serait requis. Rapportant des statistiques de Economic Roundtable on Mental Health at Work, M. Normandeau et Mme Lahaise soutiennent que seul un patient sur 10 reçoit le bon diagnostic (ou le bon traitement) du premier coup. En moyenne, cela prend de deux à trois diagnostics avant d’obtenir le bon traitement pour un employé. Ces diagnostics erronés constituent une autre source de prolongation de l’absence.
Autre source de prolongation observée par l’équipe de Mme Potvin : l’assureur ne communique pas toujours à l’employeur l’information reçue du médecin traitant dans le cadre de la réclamation. Par ailleurs, Mme Potvin conseille à l’employeur de transmettre à l’assureur, dès le deuxième jour d’absence de l’employé, s’il s’agit d’un problème relationnel ou administratif lié à la nature de ses fonctions.
Devant la nécessité pour l’employeur d’intervenir tôt, et pour toutes les parties de se concerter, les firmes d’aides et de formation aux entreprises vivent une croissance importante. Chez Shepell-fgi, spécialisée dans les programmes d’aide et de formation aux employés, les services offerts pour le soutien et le retour au travail des employés en invalidité sont en hausse de 40 %, soutient son président et chef de la direction, Rod Phillips. « Comparé à l’an passé, il y a vraiment un réveil quant à la nécessité de s’attaquer aux problèmes de santé mentale et d’en réduire les coûts, tant chez les employeurs que chez les assureurs », lance-t-il.
Les PAE en croissance
Le rôle de l’assureur traditionnel en invalidité, qui se contente de traiter des papiers, est selon lui du passé. Aujourd’hui, la réduction des coûts demande que celui-ci devienne un véritable gestionnaire de l’absence et du retour au travail. Shepell-fgi recommande d’ailleurs une coordination accrue entre les parties dans une nouvelle approche à ses clients.
Aussi fournisseur de programmes d’aide aux employés (PAE) et de services aux employeurs et aux assureurs, Solareh vit cette tendance. Lorraine Dauphinais, psychologue et directrice des services professionnels, supervise entre autres le service de prévention et de gestion de l’arrêt de travail Posaction Plus.
Posaction Plus offre aux gestionnaires des services de références, d’aide et d’intervention post-traumatique. Mme Dauphinais constate que le nombre de gestionnaires issus de PME qui ont recours aux services de Solareh augmente. « On reçoit fréquemment des appels de gestionnaires, car il n’y a pas de service de ressources humaines dans leur entreprise », dit-elle.
Même dans les entreprises dotées de telles ressources, précise Mme Dauphinais, il n’est pas rare que leurs gestionnaires appellent nos services conjointement avec des responsables des ressources humaines, pour obtenir de l’aide liée à des problèmes de santé mentale. « Les ressources humaines n’ont pas été formées pour ça et ont besoin d’encadrement, de coaching », indique Mme Dauphinais.
Actuellement destiné à des groupes de gestionnaires de PME, le programme de formation. Ça me travaille de la Fondation des maladies mentales est aussi appelé à croître. « Créé en 2003, il a pour but d’amener les gestionnaires à mieux soutenir les employés qui ont des problèmes de santé mentale et à dépister les premiers symptômes », explique Nicole Allard, directrice générale de la Fondation.
En cinq années d’existence, quelque 13 500 personnes ont utilisé ce programme, précise Mme Allard, ce qui correspond plus ou moins à une centaine d’entreprises. Et la tendance va croissante au fil des ans, à cause des problèmes d’absentéisme, fait-elle remarquer. « En 2003 les entreprises n’étaient pas très à l’aise de nous contacter mais elles n’ont plus le choix. Un cas de dépression revient à 10 000 $ par an. C’est vraiment les coûts qui font que les gens cherchent les solutions », dit-elle.
Aller vers une firme externe peut aider à réduire les coûts liés à la santé mentale en démasquant les mauvaises thérapies.
Selon M. Philips, une classe d’antidépresseurs appelée les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS ou SSRI en anglais) sont les médicaments les plus couramment prescrits en cas de maladie mentale, dont le Prozac. Ils ne donnent pas toujours les résultats escomptés observe toutefois le président de Shepell-fgi.
« Notre expérience en Ontario indique que le médecin traitant prend en moyenne 10 minutes pour émettre un diagnostic de trouble mental et prescrire un traitement, alors qu’il devrait y mettre une heure. En plus, il se limite la plupart du temps à prescrire un médicament alors qu’une co-thérapie serait plus efficace, soit la prise d’un médicament accompagné d’une thérapie avec un professionnel », observe M. Phillips.
Prendre sa médication
Johanne Potvin observe que plusieurs employés refuseront de prendre leur médication pour ne pas être ostracisé. « Ils croient que c’est plus acceptable socialement s’ils n’ont pas besoin de pilules pour régler leur problème de santé mentale. Il faut sensibiliser l’employé à l’importance de prendre ses médicaments. »
Les assureurs multiplient pour leur part les programmes de retour au travail qui favorise la concertation de toutes les parties à un dossier d’invalidité. Un des plus récents en lice, Solutions de gestion des problèmes de santé mentale au travail de Manuvie a été lancé en septembre.
Le programme s’adresse aux entreprises clientes et utilise cas par cas une approche intégrée pour réduire les absences. « La solution que nous avons développée couvre tous les éléments, de la prévention à l’intervention précoce, à la gestion du traitement en passant par le retour au travail de l’employé», indique Donna Carbell, vice-présidente, Invalidité et Solutions de gestion des absences, division canadienne, assurance collective.
Selon Mme Carbell, l’implication du gestionnaire est essentielle tant dans le cadre de la prévention que dans celui du retour au travail après un congé de maladie.
Ainsi, pour que les superviseurs sachent comment intervenir quand une personne revient travailler après une absence pour un problème de santé mentale ou de santé physique, Manuvie a élaboré des cours en ligne et un guide à leur intention. Des rencontres sont aussi organisées entre l’employé, le gestionnaire et Manuvie.
En ce qui a trait à la prévention, en revanche, l’assureur apporte ses services aux gestionnaires seulement sur demande, souligne Mme Carbell. Des outils pour les aider à détecter les problèmes de santé mentale leur sont offerts. Ils peuvent accéder à des formations ou à des cours en ligne développés en collaboration avec Wilson Banwell, une firme de services psychologiques qui travaille avec les entreprises.
Les superviseurs, avec l’accord de l’employé, peuvent référer ce dernier à Manuvie s’ils l’estiment utile, avant qu’il soit en invalidité.
« Nous voulons que le retour au travail se fasse avec succès grâce à une bonne coordination entre toutes les parties au dossier. Elles doivent être impliquées dès le début pour voir par exemple, si d’autres traitements sont disponibles », explique Mme Carbell.
Le programme de Manuvie est gratuit pour l’entreprise. Il ne dispense toutefois pas l’employeur d’intervenir tôt puisqu’il ne s’applique qu’au moment de la réclamation.
Mais mieux connaître l’employé au moment de la réclamation peut aider même si aucune action n’avait été entreprise avant. « Nous pouvons mieux favoriser le retour au travail si nous en apprenons davantage sur les capacités de l’employé en invalidité. »
Manuvie dit verser plus de 30 % de ses prestations d’invalidité de longue durée en vertu de troubles liés à la santé mentale. Elle cite des études de l’industrie à l’effet que l’impact estimé des maladies mentales sur l’économie canadienne atteint plus de 51 milliards$ par an en perte de productivité, en coûts médicaux directs et en réduction de la qualité de vie.