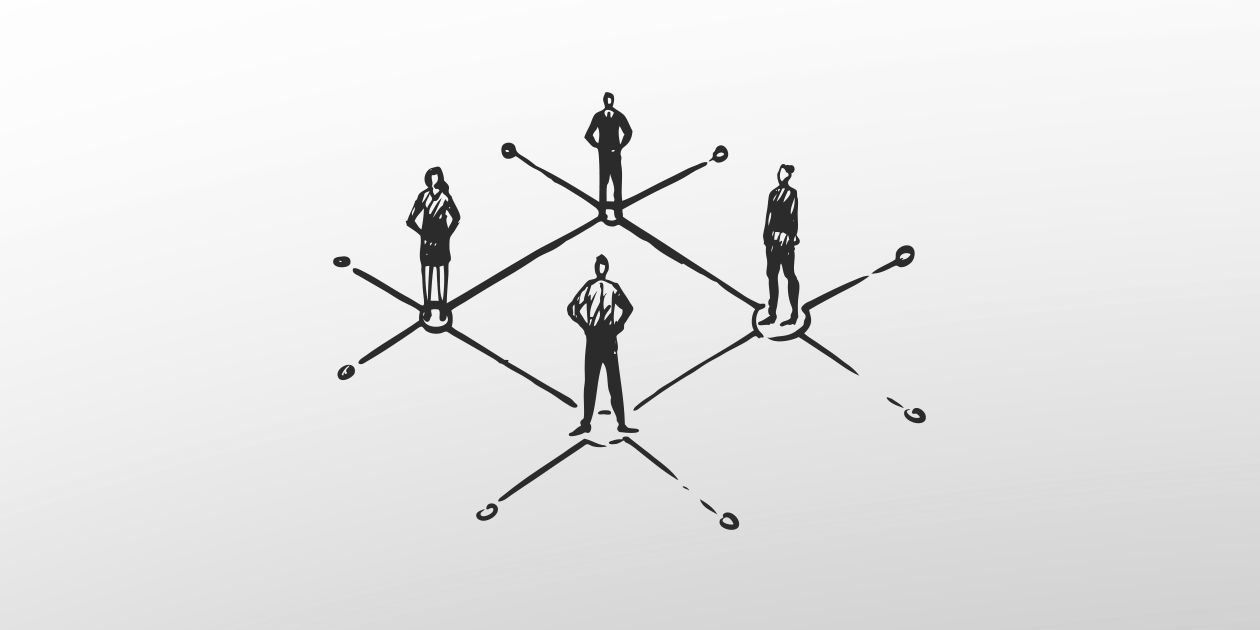Avec la montée du cybercrime, protéger la propriété intellectuelle de son entreprise est plus d’actualité que jamais.
Quand ils attaquent une entreprise, les cyberpirates ne cherchent plus uniquement à lui soutirer une rançon. Ils veulent lui voler ses plus précieux secrets pour faire monter les enchères.
Hang Le Hong, vice-présidente, unité des institutions financières et services spécialisés, Aon, a bâti son expertise autour de l’évolution des questions d’assurance et de propriété intellectuelle. Ce segment a bien changé au fil des ans, a-t-elle souligné en entrevue au Journal de l’assurance.
Assurer la propriété intellectuelle d’une entreprise ne se résume plus à protéger des droits d’auteur, une marque de commerce, un brevet ou la recette du Coca-Cola. Les enjeux sont bien plus grands aujourd’hui, affirme-t-elle.
Ce ne sont pas toutes les cyberassurances qui couvrent la propriété intellectuelle lors d’un vol de données. Ce qui est particulièrement important au Québec, ajoute-t-elle.
« Le Québec est une province où la nouvelle économie du savoir est très avancée. On n’a qu’à penser à l’expertise qu’on développe en intelligence artificielle », dit-elle.
Mme Le Hong affirme aussi que 85 % de la valeur des actifs des sociétés du S&P 500 sont des actifs incorporels. « Avant, la valeur d’une entreprise se déterminait beaucoup en fonction de ses équipements. Aujourd’hui, c’est sa propriété intellectuelle qui détermine sa valeur. »
Incidence sur les brevets
Assurer un brevet représente une tout autre paire de manches qu’il y a 10 ou 20 ans, souligne la spécialiste d’Aon. Il s’agissait d’un produit déjà couteux au début des années 2000, dit-elle. Aujourd’hui, la prime minimum pour couvrir un brevet est de 100 000 $, dit Mme Le Hong.
« Il y a aussi des frais pour effectuer une soumission. L’assureur doit faire une étude pour son contrôle de risque. Comme il embauche des avocats pour le faire, il y a des couts d’entrée pour se procurer le produit, qui vient avec une franchise et une co-assurance, qu’on demande de mettre en banque. »
L’entreprise qui souscrit la couverture assume donc une part importante du risque. Pourquoi alors en a-t-elle besoin ?
Pour protéger le volet recherche et développement du produit, dit Mme Le Hong. À la commercialisation du produit breveté, l’entreprise risque de rencontrer des chasseurs de brevets qui voudront la pousser à la faillite en la noyant sous des frais de défense.
« Ces patent trolls y pensent à deux fois avant de poursuivre une compagnie d’assurance, qui a les moyens de faire face aux avocats de grandes sociétés qu’ils embauchent. »
L’assurance des brevets, en matière de propriété intellectuelle, devient alors un véritable transfert de risque à l’assureur, illustre Mme Le Hong. En plus de couvrir la responsabilité de l’entreprise, on couvre les problèmes que la sortie du produit pourrait causer. Ce à quoi on ajoute les pertes d’exploitation, comme en assurance des cyberrisques, précise-t-elle.
Une grande société comme Facebook peut contourner l’achat d’une telle protection, parce qu’elle a les moyens d’embaucher ses propres avocats pour se défendre et protéger sa propriété intellectuelle. Cette protection devient plus pertinente pour un fournisseur de services infonuagiques, par exemple, dont la responsabilité n’a plus de limites. La souscription d’une assurance devient donc plus essentielle. Les entreprises québécoises de cet acabit sont encore trop petites pour avoir leur propre équipe d’avocats.
« Ça devient une question mathématique de transfert de risque, dit Mme Le Hong. Pour celui qui souscrit cette protection, le risque est de payer des primes et des primes, mais de ne jamais avoir de pertes à réclamer. Le bon côté de la médaille, c’est qu’il n’aura pas à payer 100 000 $ pour se protéger en cour. C’est une réflexion à faire à l’interne, qui permet au client de mesurer sa tolérance au risque. Il y a un cout juste pour avoir la soumission. »
La pénétration de l’assurance de la propriété intellectuelle demeure limitée au Québec. Mais comme l’économie du savoir prend une place de plus en plus importante dans la province, son apport pourrait être non négligeable dans l’avenir, estime Mme Le Hong.