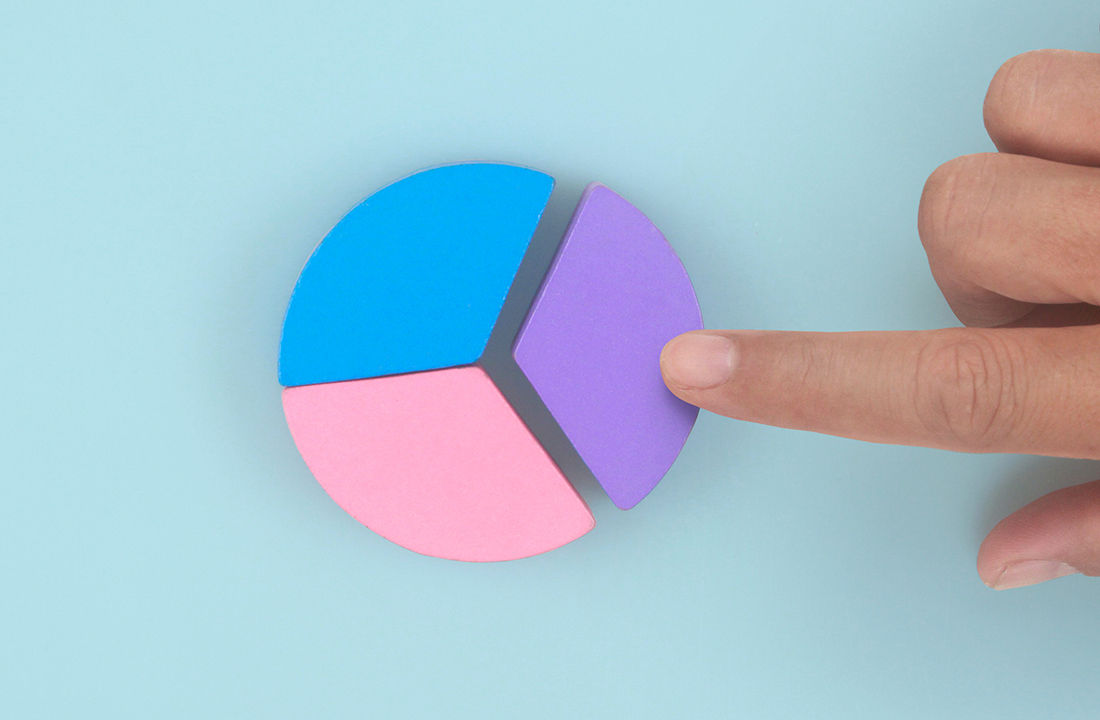Selon Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, les gouvernements doivent imposer des règles strictes aux constructeurs pour augmenter l’offre de véhicules électriques (VÉ) aux consommateurs. M. Breton a fait le portrait de la situation lors d’une conférence présentée au Salon du véhicule électrique de Québec.

En imposant des règles contraignantes et en se dotant d’une loi sur la carboneutralité, le Canada pourra encourager les constructeurs à produire plus de VÉ au pays et à commander plus de ces composantes.
Beaucoup d’emplois et de carrières d’avenir seront créés par l’électrification des transports, ajoute Daniel Breton. Toutes les entreprises membres de Mobilité électrique Canada sont déjà à la recherche de personnel.
Peu de contraintes
La vaste majorité des VÉ présentés dans les salons tenus un peu partout au Québec cet automne sont très difficiles à obtenir. Les délais d’attente se comptent en mois, et non plus en semaines. Il faut même attendre plus d’un an parfois avant de prendre possession du véhicule commandé. « Ça n’a pas de bon sens », s’indigne M. Breton.
Ces délais découlent de l’absence de mesures forçant les constructeurs à offrir des VÉ. Cette loi est inexistante au gouvernement fédéral, et celle en vigueur au Québec est « trop laxiste », selon M. Breton. En conséquence, les constructeurs dirigent les VÉ vers les États où les lois sont les plus contraignantes.
En août 2021, à peine 5 % des véhicules neufs vendus au Canada étaient des VÉ, comparativement à 87 % en Norvège, « pays qui n’est pourtant pas doté d’un climat tropical, on s’entend », dit-il. En Europe, le marché des VÉ compte pour 25 % des ventes de véhicules neufs.
En 2011, les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont subventionné Toyota pour qu’elle construise des RAV-4 électriques en Ontario, à hauteur de 140 millions de dollars. Comme il y avait une mesure contraignante en Californie, c’est là où tous ces véhicules ont été écoulés.
On sait déjà que Ford, General Motors et Chrysler se préparent à modifier leurs usines ontariennes pour y fabriquer des VÉ. Comme une quinzaine d’autres États américains ont adopté des mesures similaires à celles déjà en vigueur en Californie, Daniel Breton prévoit que la production ontarienne finira par être vendue dans ces mêmes États si le Canada n’adopte pas des règles strictes en la matière.
Député durant le mandat du gouvernement de Pauline Marois de septembre 2012 à avril 2014, Daniel Breton rappelle que les constructeurs promettaient déjà d’offrir plus de VÉ au Québec et refusaient toute nécessité d’imposer des règles contraignantes à cet égard. « Il faut forcer les constructeurs à en vendre plus ici, par règlement. Sinon, on n’aura que des miettes », dit-il.
Les concessionnaires avouent eux-mêmes ne pas suffire à la demande, et les vendeurs qui ont des objectifs à atteindre en viennent à dissuader les acheteurs de se procurer un VÉ en invoquant les délais d’attente. « La commission du vendeur lui est versée quand le véhicule est livré, et non pas vendu. On ne peut le blâmer de vouloir vendre une auto qu’il peut livrer la semaine suivante, et non pas dans six mois », indique Daniel Breton.
Plus de véhicules plus gros
Le Canada a, depuis avril 2021, un objectif encore plus ambitieux en matière d’émissions de GES. Il cible une réduction de 40 % à 45 % en 2030 comparativement aux émissions de 2005. De 2005 à 2019, le Canada a à peine réussi à réduire ces mêmes émissions de GES de 1 %. « On a du pain sur la planche, c’est le cas de le dire », note Daniel Breton.
Depuis 1990, le nombre de véhicules légers immatriculés au Québec a augmenté à un rythme trois fois plus élevé que celui de la croissance démographique.
Aux heures de pointe du matin, au Québec, il estime qu’il y a l’équivalent de 25 millions de sièges inutilisés, comme chaque véhicule transporte en moyenne 1,1 personne.
En 1990, quelque 76 % des véhicules légers vendus au Canada étaient des voitures. En 2020, cette proportion a chuté à 20 %. Les véhicules présents sur les routes sont donc de plus en plus gros et consomment de plus en plus de combustibles fossiles.
À 206 grammes par kilomètre parcouru, le parc automobile du Canada trône au sommet de la planète pour le volume de CO2 émis dans l’atmosphère. Les États-Unis sont au deuxième rang (198 grammes). « On peut dire qu’il y a place à amélioration », dit-il.
S’il importe de réduire ces GES pour ralentir le réchauffement du climat, il importe aussi de le faire pour améliorer la qualité de l’air. « On ne parle pas assez de la pollution atmosphérique », poursuit M. Breton.
Une étude de Santé Canada rapporte que les coûts de santé associés à la pollution atmosphérique représentent 120 milliards de dollars par année. « C’est un coût gigantesque et méconnu », note M. Breton en ajoutant que 61 % des émissions de monoxyde de carbone proviennent des transports, des véhicules hors route et des équipements mobiles.
De bonnes nouvelles
Au Québec, la production d’électricité provient presque entièrement de sources d’énergie renouvelable (98 %), mais ce n’est pas le cas ailleurs au Canada. Néanmoins, les émissions de GES associées à la production électrique au Canada ont baissé de 48 % de 2005 à 2019, à la suite de la fermeture de centrales thermiques, rapporte M. Breton.
Le parc énergétique canadien est l’un des plus propres au monde, avec 82 % provenant de sources d’énergie renouvelable. À titre comparatif, les États-Unis sont à 34 %, la Chine, à 28 %, et l’Inde, à 19 %. Le Canada a donc tout intérêt à augmenter ses efforts d’électrification des transports, puisque la grande majorité de son électricité est produite sans émissions et l’est de plus en plus chaque année. Même l’Alberta fermera ses dernières centrales au charbon en 2023.
Si on compare le cycle de vie complet du véhicule, même pour les pays où la production d’électricité n’est pas aussi verte, il y a tout de même un écart entre les émissions de GES d’un VÉ et celles d’un véhicule à essence comparable, et elles seront toujours plus basses, insiste Daniel Breton.
« Est-ce plus écologique d’acheter une Honda Fit ou une Tesla Model S ? Dans la vraie vie, personne ne se pose une telle question », dit-il. S’il est vrai que la Tesla est plus grosse, plus chère et comporte plus de matériaux chers à extraire, personne ne fait le choix entre une auto de 25 000 $ et une autre de 125 000 $.
Cet article est un Complément au magazine de l'édition de décembre 2021 du Journal de l'assurance.