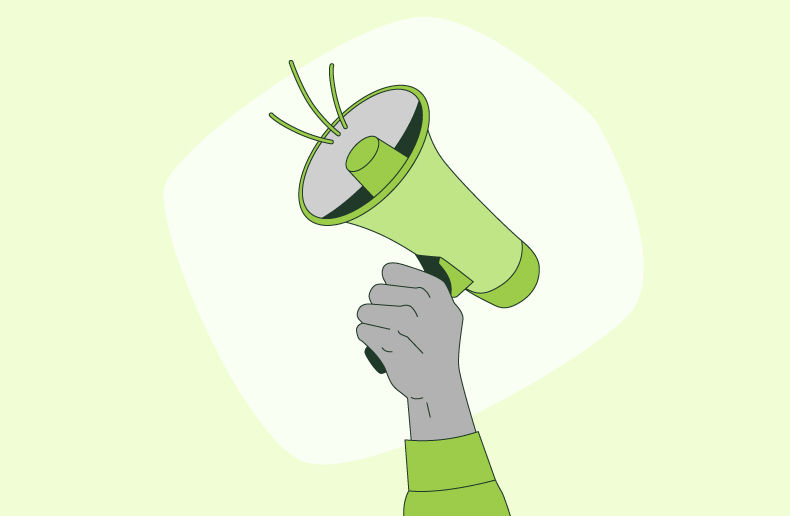L’Institut canadien des actuaires a publié un nouveau rapport sur les régimes à prestations cibles (RPC), qui combinent les caractéristiques des régimes à prestations déterminées (PD) et des régimes à cotisations déterminées (CD) pour créer des arrangements financiers relativement uniques et qui sont de plus en plus populaires au Canada.
Dans le rapport intitulé Étude du risque intergénérationnel dans les régimes à prestations cibles : un exercice d’équilibriste, les auteurs examinent l’équité financière dans les régimes, le transfert des coûts, l’accumulation des prestations au sein d’une même génération, les transferts de coûts entre générations et la résolution des disparités de paiements des prestations. Ils abordent également le lissage des prestations et les conséquences des hypothèses incorrectes dans l’évaluation.
« Le concept de partage des risques intergénérationnels est central dans les RPC », écrivent-ils, ajoutant que les cotisations et les investissements sont mis en commun pour créer des revenus de retraite stables. « Toutefois, cette approche soulève des préoccupations en matière de justice, d’équité et d’interfinancement entre les générations », poursuivent-ils.
Compréhension du risque intergénérationnel
« Ce document examine trois types d’interfinancement entre les générations inhérents aux RPC, à savoir les transferts implicites de coûts, les fluctuations du risque d’investissement et l’interfinancement temporel. Notre objectif est d’approfondir la compréhension du risque intergénérationnel lié à ces régimes, d’éclairer l’élaboration de politiques législatives et de faciliter la conception de régimes transparents et équitables », écrivent les auteurs du rapport.
Dans le cadre d’un RPC, ajoutent les auteurs, les cotisations des employeurs et les responsabilités sont limitées à des niveaux prédéterminés. Les déficits sont abordés collectivement par les retraités et les employés par des augmentations de cotisations ou des réductions de prestations. « Fait à noter, les risques d’investissement et de longévité associés aux RPC sont collectivement partagés entre tous les participants, ce qui les distingue des régimes CD, selon lesquels chaque participant et participante assume ses propres risques », indiquent-ils. « En cas de sous-capitalisation, l’organe directeur du régime peut décider de réduire l’indexation, d’abaisser les taux futurs d’accumulation des prestations ou de diminuer les prestations constituées. »
Modèle de régime de retraite à risque partagé
Ils notent que le Nouveau-Brunswick a été la première province à introduire un modèle de régime de retraite à risque partagé en 2012. « Plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique, ont emboîté le pas en promulguant des lois et des règlements sur les RPC de 2012 à 2015. Toutefois, les deux plus grandes instances au chapitre des pensions de retraite, soit l’Ontario et l’administration fédérale, n’ont pas pleinement mis en œuvre ces mesures », ajoutent-ils.
Le document se conclut sur un avertissement : les RPC nécessitent une gestion prudente des risques intergénérationnels.
« Le partage intergénérationnel des risques joue un rôle crucial dans le fonctionnement des RPC, mais demeure un sujet de discorde. Ces régimes opèrent une redistribution des risques des participants et participantes âgés vers les participants et participantes plus jeunes, ce qui leur permet d’appliquer des stratégies d’investissement agressives, tout en protégeant les participants et participantes âgés contre la variabilité qui en découle », selon l’Institut. « La phase de décroissance des RPC exige une attention particulière. À mesure que le régime gagne en maturité et que le nombre de participants et participantes actifs diminue, les efforts doivent porter sur la protection des prestations constituées de tous les participants et participantes. Les décideurs devraient examiner les mécanismes de transfert de risque pour garantir le versement des prestations constituées par les participants, même dans des conditions économiques difficiles. »