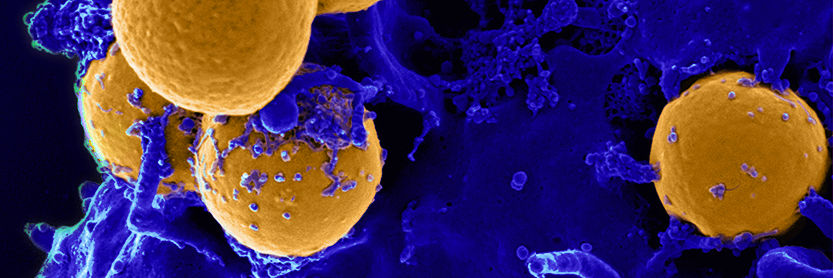« Est-ce qu’il y a un marché pour les assureurs privés à vouloir couvrir les maladies rares et les médicaments orphelins ? Ma réponse, c’est non. »
Professeur à la School of Public Policy and Administration de l’Université Carleton, à Ottawa, et chercheur pour le Edmond J. Safra Center for Ethics de l’Université Harvard, Marc-André Gagnon est d’avis que pour les assureurs, les patients atteints d’une maladie rare sont par définition de mauvais risques dont il faudrait se départir le plus rapidement possible.
« Ce que demande l’ACCAP, c’est que le gouvernement prenne en charge ces mauvais risques en mettant en place un régime universel pour les médicaments onéreux. Ce serait le rôle du fédéral de remplir les trous et de prendre en charge les médicaments qui coutent très cher. Le concept d’assurance, c’est aussi d’assurer les mauvais risques. Si on construit le régime public uniquement comme poubelle à mauvais risques pour servir les intérêts commerciaux des assureurs, on a un problème. »
Des blockbusters aux nichebusters
Les progrès de la pharmacologie dans le traitement de plusieurs maladies ont conduit au développement d’une industrie pharmaceutique puissante dont le marché s’élève à plusieurs centaines de milliards de dollars. Marc-André Gagnon croit que les fabricants ont vu dans la médecine personnalisée et les médicaments orphelins un nouveau créneau lucratif à exploiter.
Dans les années 2000, décrit-il, on a assisté à un changement du modèle d’affaires dominant, qui était alors basé sur les médicaments blockbusters – des antidépresseurs ou des inhibiteurs de la pompe à protons, qui ne coutaient pas très cher, mais qui étaient vendus à une large population.
Mais, souvent, les petites « évolutions » de ces médicaments ont été refusées par les organismes d’évaluation parce qu’elles n’ajoutaient pas de bénéfice thérapeutique réel. De plus, plusieurs de ces médicaments ont été copiés par d’autres fabricants ou ont fait l’objet de génériques. À cause du recul des blockbusters, les sociétés pharmaceutiques, aidées par des mesures fiscales, ont commencé à se tourner vers le développement de nouveaux marchés que sont les médicaments très pointus pour de petites clientèles.
Éviter le marketing
À partir de là, ajoute M. Gagnon, on a pu observer une certaine restructuration de l’industrie vers les médicaments plus payants et un modèle d’affaires qu’il surnomme les nichebusters, soit des médicaments de niche pour une petite population, mais pour lesquels on peut demander des prix extrêmement élevés et qui ne nécessitent pas une mégacampagne de marketing.
« On a un médicament qui coute extrêmement cher et pour lequel on a un immense taux de profit. On n’a pas besoin d’aller visiter l’ensemble des bureaux de médecins au Canada pour les faire connaitre. On peut se concentrer sur une poignée de médecins et créer un succès commercial avec ce médicament ».
Le développement de la pharmacogénomique, ajoute-t-il, permet aux chercheurs et aux sociétés pharmaceutiques d’identifier des maladies d’origine génétique – par exemple, un taux cholestérol élevé chez des gens ayant un gêne particulier. Et quand on a trouvé une nouvelle maladie, on développe un médicament approprié.
« Ça fait partie des stratégies d’affaires des fabricants d’aller chercher la désignation de médicaments orphelins en disant que ça répond à une niche spécifique de patients, indique Marc-André Gagnon. Ça fait un bel argumentaire pour dire : “Il faut rembourser notre produit même s’il coute très cher, car c’est le seul existant pour cette maladie rare spécifique.” On crée la maladie en même temps qu’on crée le médicament. On peut alors demander des prix beaucoup plus élevés, car il n’y a pas de traitements alternatifs pour cette maladie qu’on vient d’identifier à partir d’un gène. »
Une explosion de recherches à l’horizon
Depuis le début des années 2010, dit-il, les médicaments orphelins sont devenus le nouveau modèle d’affaires de la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques, et on se dirige vers une explosion de recherches. Les mécanismes d’évaluation fonctionnaient relativement bien quand on comparait une nouvelle statine par rapport à une autre sur le marché, mais « quand on arrive avec un médicament de niche pour une maladie rare pour laquelle il n’y a pas d’autre traitement disponible, l’évaluation devient plus compliquée ». On ouvre la porte à une plus grande générosité et à des paiements de 100 000 $, 200 000 $, 500 000 $, s’objecte Marc-André Gagnon.
Des données publiées par le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés vont dans ce sens. De plus en plus de nouveaux médicaments possèdent une désignation orpheline, ce qui signifie qu’ils visent le traitement de maladies rares. En 2017, 45 % des nouveaux médicaments au Canada ont été qualifiés d’orphelins. Les trois quarts d’entre eux coutent plus de 10 000 $ par année de traitement, le plus onéreux se détaillant 944 800 $ par an, rapportait La Presse canadienne, en février dernier.
Le risque, dit Marc-André Gagnon, « quand on a des systèmes qui acceptent de payer n’importe quoi à n’importe quel prix, c’est d’envoyer aux pharmaceutiques le message que même s’ils font de la scrap qui n’apporte pas d’avantages thérapeutiques et ne bénéficient pas aux patients, on va le payer quand même ».
De très mauvais risques
Ce partisan avoué d’un régime d’assurance médicaments public et universel estime que les assureurs privés n’ont aucun intérêt à couvrir les maladies rares.
« Pour eux, soutient-il, c’est un immense casse-tête. Si vous gérez un régime privé, que vous avez une entreprise qui compte 200 employés et que l’un d’eux demande un traitement qui coute 500 000 $, ça fesse dans le portefeuille parce que les primes seront redistribuées sur l’ensemble des employés. Ça commence à être cher par personne. Ce que ça crée au niveau des régimes privés, ce sont des assurés qui deviennent des ultra mauvais risques, ce qui va à l’encontre de la nature des assureurs qui vont essayer de tasser les mauvais risques et de ne retenir que les bons. »
Selon lui, les groupes de patients de maladies rares sont parmi les plus militants contre un régime public et universel, car les régimes privés sont les seuls qui acceptent de tout rembourser, peu importe le prix, alors que les régimes publics font de la discrimination et ne vont pas automatiquement rembourser le produit.
« Les assureurs privés s’opposent à un régime public universel, car ils perdraient une bonne partie du marché. Donc, on veut rester amis avec les groupes de patients de maladies rares ; mais, d’un autre côté, c’est un méga casse-tête d’essayer de couvrir ces gens-là », croit le professeur.
Peu importe ce que disent les assureurs privés, ajoute-t-il, au Canada, les employeurs ne peuvent pas se permettre d’avoir un ou plusieurs employés qui suivent des traitements de 700 000 $ par année. « Les employeurs ont subi une très forte augmentation des primes, ces dernières années, et ce n’est pas sur le point de se résorber. Ça les oblige à mettre en place une série de mesures pour contenir les couts. Autrefois, ces médicaments de niche représentaient de 3 à 4 % de la facture. Actuellement, nous sommes à 25 %, et on estime que ça va monter à 40 % d’ici les cinq prochaines années. »