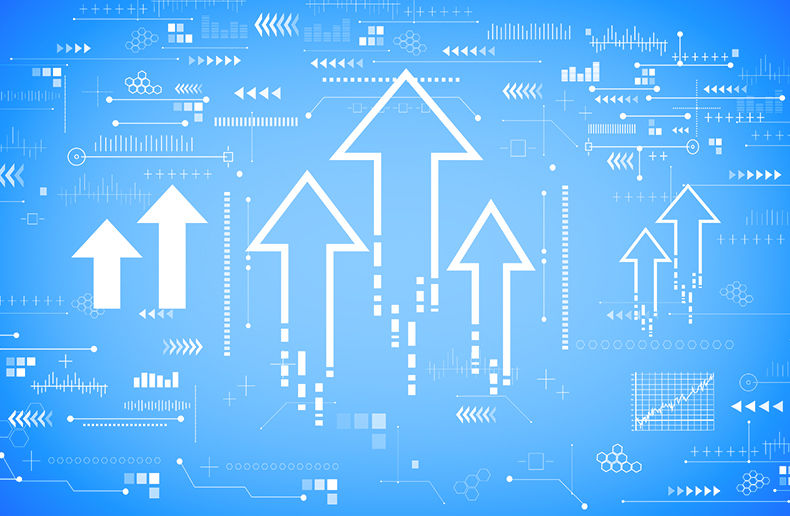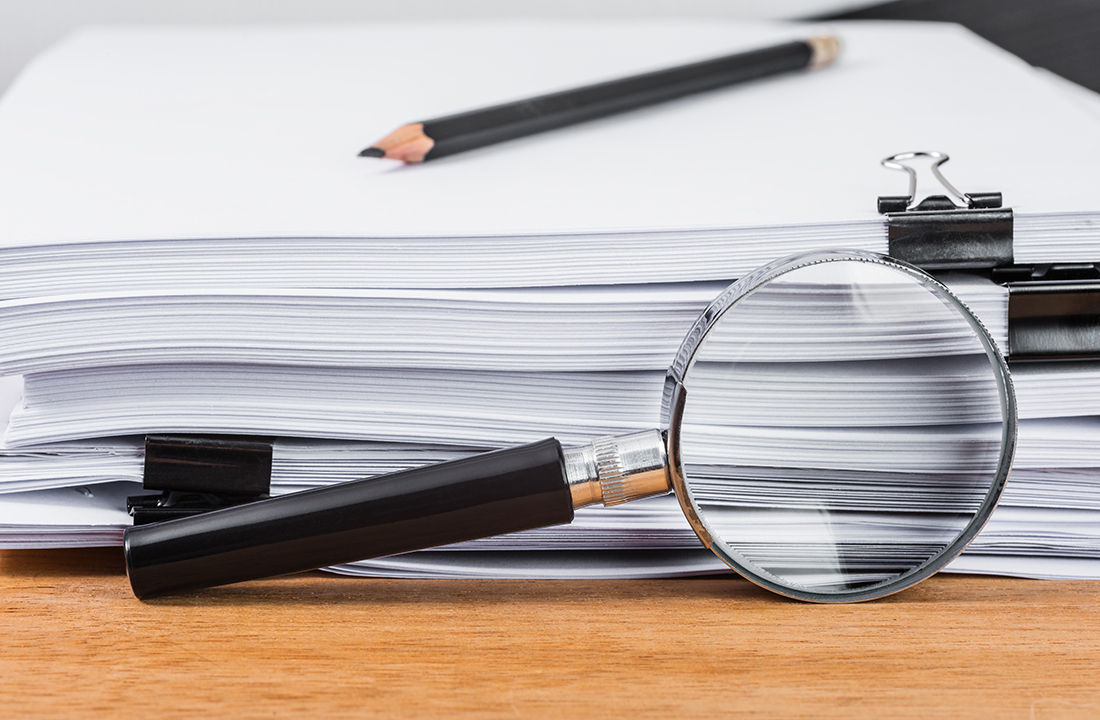« La conduite avec facultés affaiblies constitue un problème majeur de sécurité routière au Canada », constate une vingtaine de chercheurs canadiens qui ont étudié l’étendue de la consommation de substances psychoactives chez les conducteurs accidentés à travers le pays.
Selon leurs observations, dans un échantillon de 8 328 conducteurs blessés qui ont été traités dans un centre de traumatologie canadien après un accident, près de 55 % ont été testés positifs à une substance nocive.
Ces substances pouvaient être l’alcool (16,1 %), des dépresseurs (28,4 %), le tétrahydrocannabinol ou THC (16,3 %), les stimulants (12,7 %) et les opioïdes (10,9 %). La prévalence variait en fonction de l’âge, du sexe, de la ruralité, du type de collision et de la région.
« Bien que la présence d’une substance nocive ne signifie pas nécessairement que les facultés du conducteur étaient affaiblies, nos résultats sont préoccupants », commentent les auteurs.
Tout comme les dépresseurs, les opioïdes et les stimulants, le cannabis est associé à un risque accru d’accident de la route.
Les résultats de leur analyse, intitulée Prevalence of Impairing Substance Use in Injured Drivers, ont été publiés le 22 avril 2025 dans le Jama Network Open, une publication médicale américaine reconnue.
15 centres de traumatologie de huit provinces
Des échantillons de sang de conducteurs blessés traités dans 15 centres de traumatologie de huit provinces ont été analysés. Les chercheurs ont mesuré les taux sanguins d’alcool, de THC, le principal composé affaiblissant du cannabis, de stimulants, d’opioïdes et de dépresseurs de janvier 2019 à juin 2023.
Ils ont identifié les conducteurs de véhicules (automobiles, utilitaires sport, camionnettes, fourgonnettes, poids lourds et motocyclettes) dont le sang avait été prélevé dans les six heures suivant un accident de la route.
Ceux qui étaient décédés sur les lieux ou aux urgences et les blessés qui présentaient des blessures mineures n’ayant pas nécessité de prise de sang ont été exclus de l’étude.
Près de 55 % des conducteurs testés positifs
Le bilan global démontre que les facultés affaiblies jouent encore un rôle majeur dans l’origine des accidents de la route au Canada. Sur 8 328 conducteurs blessés, soit 5 605 hommes et 2 723 femmes, 4 568 (54,9 %) ont été testés positifs à une substance affaiblissante et 1 798 (21,6 %) l’ont été à deux classes de substances ou plus.
Les dépresseurs, substances qui ralentissent l’activité du système nerveux central, constituaient la classe de substances affaiblissant les facultés la plus fréquemment détectées (28,4 % des conducteurs).
Les deux tiers des collisions (5 369) ont eu lieu un jour de semaine et 3 373 (40,5 %) étaient des accidents à un seul véhicule.
Faits majeurs de l’étude canadienne
- Le THC était la substance la plus fréquemment relevée. Elle a été trouvée que 16,3 % des conducteurs blessés. C’est davantage que l’alcool (16,1 %). Cependant, la présence de THC n’indique pas forcément une consommation récente de cannabis.
- Les chercheurs ont détecté des stimulants chez 12,7 % des chauffeurs blessés, des opioïdes chez 10,9 % et des dépresseurs chez 28,4 %.
- Les tendances en matière de substances varient en fonction de l’âge. Le THC était deux fois plus répandu chez les conducteurs âgés de 19 ans à 24 ans, probablement, croient les auteurs, parce que les jeunes pensent qu’ils peuvent conduire en toute sécurité après avoir consommé du cannabis et que le risque d’être pris par la police est faible.
- L’alcool était plus répandu chez les 19 à 34 ans.
- Les stimulants ont été principalement observés chez les 35 à 44 ans.
- Les opioïdes étaient surtout présents chez les 55 à 64 ans.
- Les dépresseurs ont été plus constatés chez les 65 à 74 ans, ce qui reflète probablement une plus grande consommation de médicaments sur ordonnance chez les plus âgés.
- Les hommes étaient plus susceptibles que les femmes d’avoir bu, d’être positifs au THC ou d’avoir davantage pris des stimulants, mais moins d’avoir consommé un dépresseur
- La présence des dépresseurs était plus répandue chez les femmes.
- Un conducteur sur 8 avait un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %.
- Les moins de 19 ans étaient moins susceptibles d’avoir un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %. Cependant, 7,6 % dépassaient cette limite. « Cette constatation, écrivent les chercheurs, contraste avec les enquêtes routières canadiennes, qui n’ont révélé pratiquement aucune consommation d’alcool chez les conducteurs de moins de 19 ans. »
- La consommation de substances psychoactives et la polytoxicomanie étaient plus fréquentes chez les conducteurs ayant une adresse rurale (64,3 %) que chez ceux ayant une adresse urbaine (52,9 %), en particulier pour l’alcool.
- Les conducteurs ruraux étaient plus susceptibles d’avoir bu, d’avoir consommé des stimulants, des dépresseurs, des opioïdes, toute substance ou plusieurs classes de substance que ceux ayant une adresse urbaine.
« Les statistiques, commentent les chercheurs, suggèrent que, bien que davantage de conducteurs soient testés positifs au THC, l’alcool reste la plus grande menace pour la sécurité routière au Canada. »
Résultats par régions au Canada
La prévalence de la consommation de substances nocives chez les conducteurs accidentés varie d’une région à l’autre :
- C’est dans les provinces de l’Atlantique que la consommation de substances est la plus répandue. Les deux tiers des conducteurs ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage d’une substance affaiblissant les facultés.
- C’est en Colombie-Britannique qu’elle est la plus faible. La moitié des conducteurs a reçu un résultat positif à un test de dépistage.
- Les conducteurs de l’Alberta étaient plus susceptibles d’avoir consommé des opioïdes.