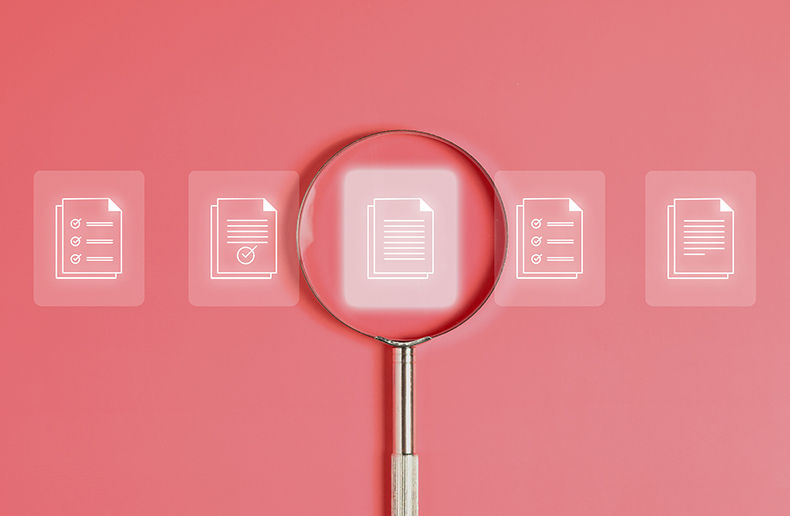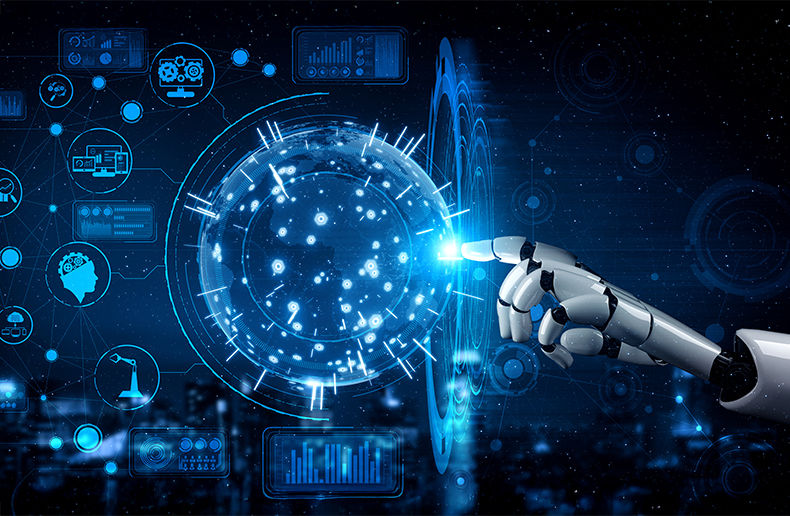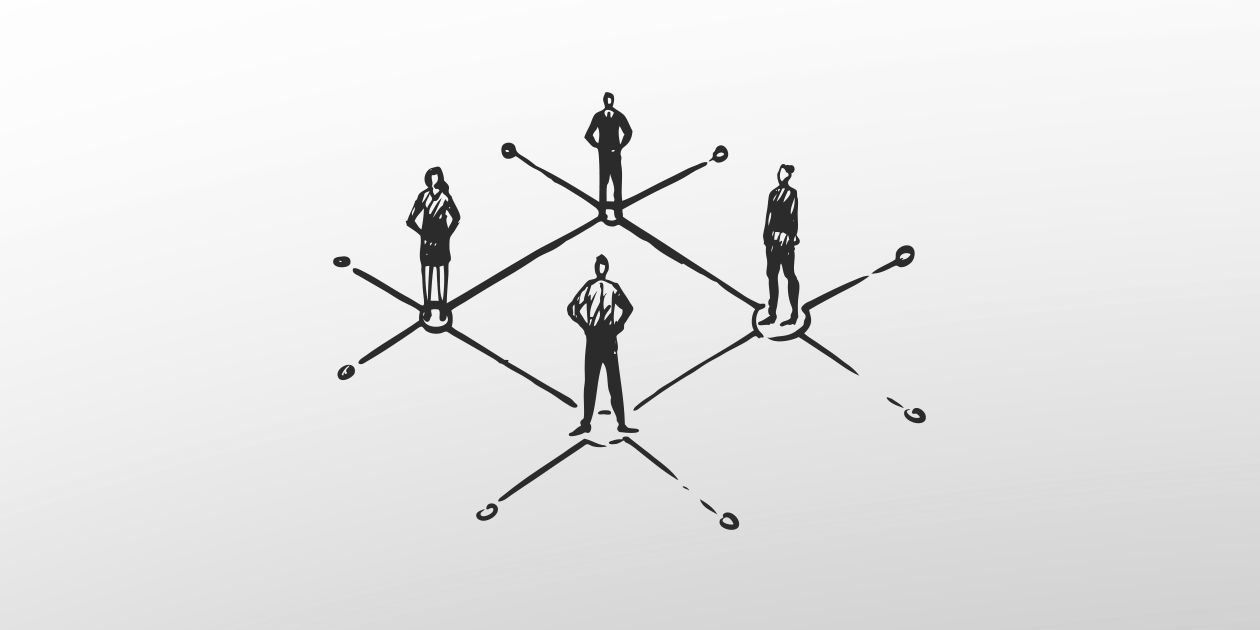L’arrivée imminente des véhicules automatisés et connectés, aussi appelés VAC, forcera les assureurs à revoir leurs modèles de tarification. C’est ce qu’indiquent les conclusions publiées par le Conseil canadien des responsables de la règlementation d’assurance (CCRRA) au terme de discussions sur les VAC et leurs répercussions sur le marché de l’assurance automobile.
Pour assurer une gestion adéquate des risques associés aux VAC, les décideurs et les organismes de règlementation pourraient être forcés de passer d’un régime de responsabilité individuelle fondé sur la faute ou la négligence du conducteur à un régime de responsabilité civile produits, indique le CCRRA.
Les assureurs n’auront d’autre choix que d’adapter leurs modèles à la technologie présente dans les véhicules et aux améliorations qui y sont apportées au fil des années. Les risques devront être évalués de manière globale. « Les éléments à prendre en considération pour établir et évaluer un régime de responsabilité relatif aux VAC sont complexes et nécessiteront des compromis [de part et d’autre] », dit le CCRRA.
Les difficultés liées aux tentatives d’adaptation de la législation actuelle risquent d’entrainer des années d’incertitude pour les conducteurs et les personnes blessées à mesure que l’utilisation des VAC se répand.
Une police unique pour couvrir tout le monde ?
Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) a demandé, dans le cadre des discussions sur les VAC, si l’élaboration d’une police d’assurance unique était réalisable dans toutes les provinces canadiennes. La plupart des répondants estiment que le recours à une police unique couvrant la négligence du conducteur et la technologie automatisée serait une bonne solution pour le Canada. Mais les avis restent mitigés quant à l’application d’une telle police à toutes les provinces canadiennes, en particulier au Québec.
Les VAC pourraient changer la façon de déterminer la responsabilité en matière d’assurance dans la plupart des provinces canadiennes ayant un régime de common law imputant la responsabilité au conducteur, au contraire du régime sans égard à la responsabilité en vigueur au Québec. Quand les véhicules entièrement automatisés prennent la route avec, à leur bord, des « utilisateurs » plutôt que des « conducteurs », la responsabilité d’un accident pourrait être imputée aux constructeurs plutôt qu’aux utilisateurs-conducteurs si, par exemple, l’accident est causé par un bogue du logiciel qui contribue au fonctionnement du VAC ou par des choix de programmation.
Le cadre proposé par le BAC couvrirait aussi les personnes blessées lors d’une collision causée par une cyberattaque. Ce cadre ne précise pas à quels niveaux il fait référence quand il est question de couvrir la « technologie automatisée ». Toutefois, il prévoit que l’assureur pourra récupérer une certaine somme, après déduction d’une franchise, auprès de la partie responsable du dysfonctionnement du véhicule. C’est-à-dire, si la technologie utilisée dans le VAC est responsable de la collision ou de l’intrusion, ou si le propriétaire ou l’exploitant a omis de maintenir un logiciel essentiel à la sécurité.
La détermination de la prime applicable aux VAC dépend de la collecte d’une énorme quantité de données. La technologie joue un rôle primordial en ce qui concerne la sécurité des VAC et les couts d’assurance. Les constructeurs et les fournisseurs de logiciels devraient partager les données avec les assureurs lorsqu’un véhicule automatisé est impliqué dans un accident, ont mentionné la plupart des répondants au sondage.
À l’heure actuelle, les assureurs sont souvent incapables de déterminer la nature complexe de la technologie intégrée aux véhicules et la manière dont elle est déployée. Il serait aussi important que la réflexion et la recherche concernant les VAC ne se fassent pas en vase clos, croit le CCRRA.
Certains de ces véhicules sont déjà à l’essai sur les voies publiques du Canada. Les responsables de la règlementation d’assurance sont déjà en pourparlers. Le CCRRA entend poursuivre le dialogue avec les concepteurs de VAC et les secteurs du droit et de l’assurance afin d’étudier les multiples questions et risques en jeu et de cerner conjointement les besoins règlementaires futurs.