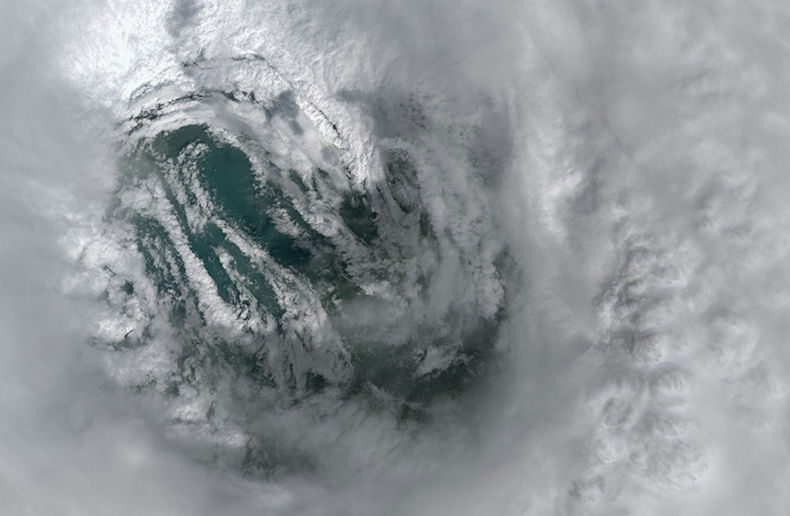L’industrie canadienne de la construction représente un secteur clé de l’économie canadienne. Une étude récente vise à estimer la valeur socio-économique de l’utilisation des cautionnements dans les projets publics d’immobilisation au Canada. Les primes payées pour des cautionnements d’exécution et de paiement contribuent à garantir la sécurité financière et la réalisation des projets, selon les auteurs de l’étude.
Intitulé Le cautionnement au Canada : Avantages économiques et sociaux, ce rapport de recherche a été commandé par l’Association canadienne de caution (ACC). L’étude a été produite par le Centre canadien d’analyse économique (CANCEA) et rendue publique à la fin de juillet. La traduction en français a été mise en ligne plus récemment.
Le Centre avait publié en 2016 une étude sur les conséquences économiques découlant des retards dans les projets d’infrastructure.
« Les risques de crédit et d’exploitation dans le secteur de la construction sont fortement influencés par les fluctuations des taux d’intérêt, les ralentissements économiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, le poids de l’endettement et les périodes de restriction du crédit », précisent les auteurs.
« Notre analyse démontre que le recours aux garanties de cautionnement, conjugué à la rigueur des vérifications préalables qu’elles impliquent, génère systématiquement des effets positifs dans divers scénarios », écrivent-ils.
Selon Paul Smetanin, président et chef de la direction de CANCEA, « les cautionnements allient la garantie financière et la responsabilité de projet, assurant l’achèvement des travaux, le paiement des travailleurs et la pleine valeur des fonds publics, quelle que soit la conjoncture économique ».
De son côté, Steve Ness, président de l’ACC, indique que le rapport de CANCEA « démontre clairement que tous les travaux publics devraient être garantis par des cautions d’exécution et de paiement ».
Faillites moins fréquentes
À l’échelle nationale, les taux d’insolvabilité dans l’industrie de la construction atteignent un creux historique (excluant la période de la pandémie), avec une moyenne de 2,5 faillites par 1 000 entreprises depuis une décennie, indique le Centre. Ce taux est presque six fois inférieur à celui déclaré dans les années 1990, qui atteignait 17,7 faillites par 1 000 entreprises.
En étendant le recours à tous les projets d’immobilisation, et pas seulement aux projets d’infrastructures, le rendement économique demeure positif, affirment les auteurs. Par contre, les projets non liés aux infrastructures n’ont pas le même impact sur la productivité systémique du secteur en cas de retard. Un bâtiment commercial qui n’est pas livré à temps ne représentera pas les mêmes coûts systémiques comparativement à une infrastructure publique d’écoulement ou d’assainissement des eaux.
Les chiffres rapportés par le CANCEA couvrent tout le Canada, mais des estimations similaires ont été faites pour six grandes régions : Ontario, Québec, Colombie-Britannique, Alberta; les provinces de l’Atlantique ont été regroupées, tout comme le Manitoba et la Saskatchewan.
Parmi les faits saillants rapportés dans l’étude, on constate qu’une entreprise de construction qui n’a pas de cautionnement est 10 fois plus susceptible de devenir insolvable que les entreprises qui ont obtenu cette garantie.
Le secteur de la construction est le troisième en importance au Canada, où il représente 7,7 % du PIB — et 7,3 % dans le PIB du Québec. Le nombre d’emplois atteint 1 327 000 et la très grande majorité de ces gens travaillent dans des entreprises comptant moins de 20 employés.
150 000 dossiers
Sept compagnies d’assurance ont participé à l’enquête du CANCEA en transmettant des données, lesquelles ont été traitées de manière confidentielle : Aviva, Intact, Liberty Mutual, Travelers, Trisura, Western et Zurich.
Ensemble, ces sociétés souscrivent plus de 85 % des cautionnements dans le marché de la construction, rapporte le Centre. Les données provenant de quelque 150 000 projets de construction avec cautionnement sur une période de 10 ans ont été utilisées aux fins de ce rapport.
Même si ce sont des assureurs qui offrent les garanties associées au cautionnement, il ne faut pas confondre le produit avec l’assurance. « La société de caution s’engage avec ses propres ressources pour garantir l’exécution d’un projet. Cela s’apparente davantage à une extension de crédit, reposant sur l’idée qu’il n’y aura pas de perte, comme lorsqu’on cosigne un prêt », précisent les auteurs
« Si le risque est jugé trop élevé, la société refuse simplement de garantir. Les primes servent à couvrir les frais d’analyse, pas à indemniser des pertes. Garantir un entrepreneur trop risqué peut coûter très cher. »
La combinaison
La combinaison des cautionnements d’exécution et de paiement est recommandée dans le rapport, comparativement au seul cautionnement d’exécution. « Garantir le paiement aux sous-traitants leur permet de maintenir les activités et de réduire les risques qu’ils ne puissent achever d’autres projets », ajoutent-ils.
Le cautionnement d’exécution permet à l’entrepreneur de garantir à l’éventuel bénéficiaire, soit le propriétaire de l’ouvrage, que le contrat sera réalisé. En cas de défaillance, le bénéficiaire peut se tourner vers la caution pour couvrir les coûts d’achèvement du contrat et les frais connexes.
Le cautionnement de paiement de la main-d’œuvre ou des matériaux, aussi signés par l’entrepreneur et la caution, garantit que les ouvriers, les sous-traitants et les fournisseurs seront payés dans le cadre d’un contrat donné. En cas de non-respect des obligations de paiement par l’entrepreneur, ces derniers seront rémunérés par la caution.
Les scénarios étudiés
Cette valeur socio-économique a été estimée en fonction de deux scénarios, soit celui du statu quo et celui à haut risque. Le premier scénario est fonction d’un niveau similaire du risque d’insolvabilité qui est similaire à celui des dernières années, en excluant la période pandémique, tandis que le second scénario reflète les niveaux atteints dans les années 1990 en matière d’insolvabilité.
Les auteurs ont ainsi évalué l’impact du cautionnement sur le produit intérieur brut (PIB), la protection du bien-être des personnes et les finances de l’État.
Scénario à faible risque : « Si 100 % des projets d’infrastructure publique sont assortis de ces cautionnements, on protège 3,85 millions de dollars (M$) du PIB pour chaque million de dollars de primes versées. 29,4 emplois par million sont préservés chaque année, assurant une stabilité pour les employés et les employeurs. Les retombées sur le bien-être dues à la réduction des insolvabilités et à la protection de l’activité économique représentent une valeur sociale équivalente à 1,32 M$ par million de primes. »
Scénario à haut risque : « Si 100 % des projets d’infrastructure publique sont assortis de cautionnements, 27,24 M$ du PIB sont protégés par million de primes versées. Cela découle à la fois de la baisse des faillites d’entreprises et des bénéfices systémiques liés à l’achèvement des infrastructures dans les délais. Les retards étant plus probables en l’absence de cautionnement, un portefeuille plus large de projets est exposé, amplifiant l’impact des cautionnements. 207,6 emplois par million de primes sont ainsi protégés. Les bénéfices sur le bien-être équivalent à 9,36 M$ par million de primes payées. »