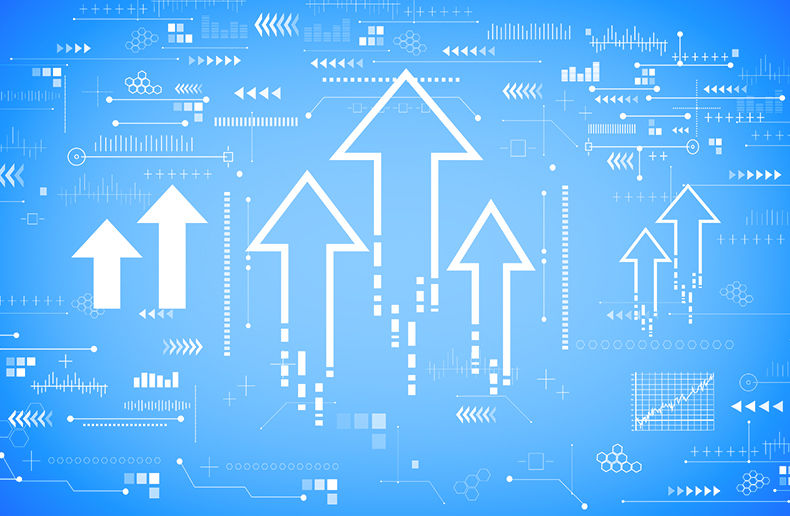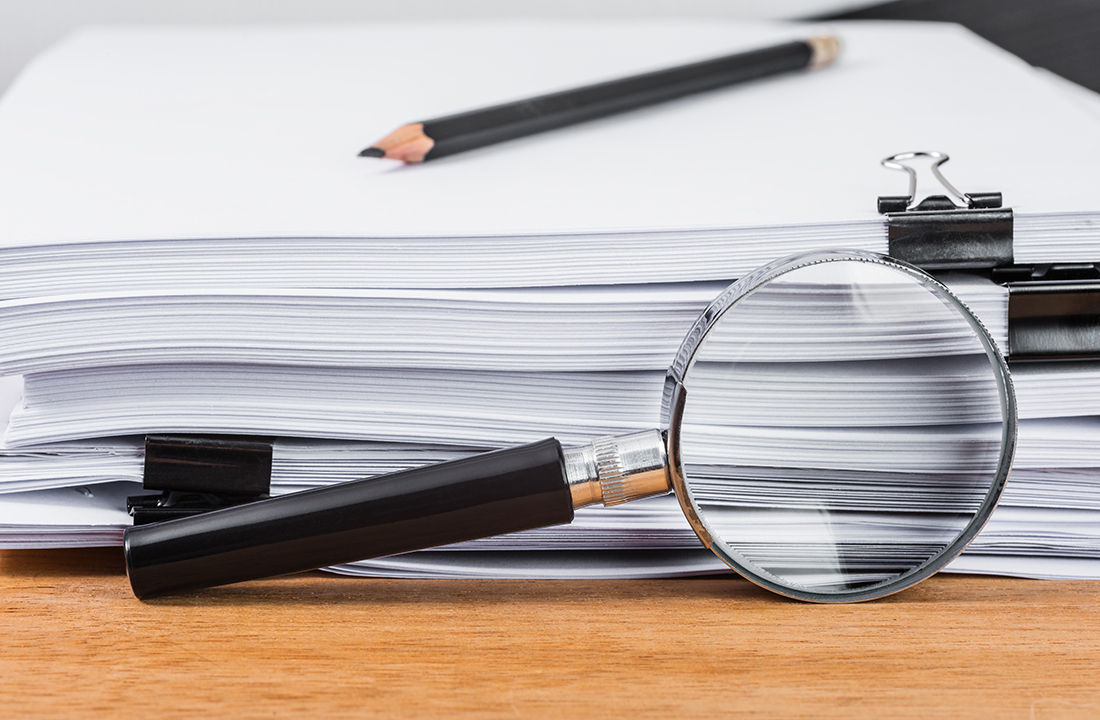Les défenderesses Desjardins sécurité financière, compagnie d’assurance vie et l’Alliance pour la santé étudiante du Québec (ASEQ) ont porté en appel le jugement rendu le 31 juillet 2025 qui autorisait l’action collective à aller de l’avant. L’affaire découle des cotisations payées aux associations étudiantes qui incluent des couvertures d’assurance collective en santé ou en soins dentaires pour lesquelles le consentement des adhérents n’est pas requis.
Arielle Nagar et Giovana Feth, étudiantes des universités Concordia et McGill, sont les demanderesses dans cette action collective. Tous les étudiants inscrits ou qui étaient inscrits depuis le 19 décembre 2019 et qui ont été automatiquement inclus à un régime d’assurance santé, médicale ou dentaire pour lesquels ils ont payé les primes d’assurance aux défenderesses ou à leur bénéfice, sont visés par l’action.
Le 4 août 2025, le cabinet d’avocats qui mène cette première action collective, LPC Avocats, en a également déposé une autre au nom d’un autre groupe d’étudiants représenté par la demanderesse Yael Segalovitch. Les défenderesses ciblées sont les cégeps et les autres universités où l’ASEQ distribue les mêmes garanties collectives aux associations étudiantes qui sont offertes par Desjardins.
Le 24 septembre dernier en Cour supérieure du Québec, le juge Martin Sheehan a accueilli la demande de suspension temporaire de l’instance soumise par les procureurs de la demanderesse. Comme les faits au soutien de cette autre action collective sont les mêmes que dans le dossier Concordia, la demanderesse suggère de suspendre le présent dossier jusqu’à ce que la Cour d’appel du Québec se soit prononcée dans le dossier Concordia.
« L’issue de l’appel dans le dossier Concordia aura une incidence directe sur l’issue de la présente affaire », reconnaît le juge Sheehan. L’avocat du groupe s’est engagé à informer la cour de toute évolution majeure du dossier Concordia qui pourrait avoir une incidence sur le déroulement de la présente action collective.
L’affaire est donc suspendue jusqu’à l’expiration du délai de 30 jours après que l’appel dans le dossier Concordia soit devenu final.
Les deux établissements anglophones
Dans le cas de l’action collective menée contre les deux universités anglophones de Montréal, le jugement du 31 juillet 2025 a été prononcé par la juge Florence Lucas. La demande pour obtenir la permission d’exercer une action collective contre les défenderesses a été autorisée « en partie ».
L’ASEQ est une filiale de Corporation People, joueur majeur dans les régimes collectifs offerts par l’entremise des associations étudiantes au niveau collégial ou universitaire. Les étudiants adhèrent au régime en payant leur cotisation à l’association étudiante. En théorie, ils disposent d’un délai déterminé pour s’en retirer. Les universités jouent le rôle de mandataires des associations étudiantes, car elles collectent les primes d’assurance au moment de payer les droits de scolarité. Les sommes perçues sont ensuite remises aux associations.
La demanderesse Nagar, qui étudie à Concordia, a réussi à deux reprises, en 2018-2019 et en 2019-2020, à déposer une demande de retrait du régime et à se faire rembourser la prime. Elle disait ne pas avoir besoin du produit, étant bénéficiaire d’une couverture par l’entremise du régime de l’employeur de sa mère.
À la session de l’automne 2020, elle tente à nouveau de s’exclure du régime, mais l’ASEQ refuse sous prétexte que le délai est échu. Au semestre de l’hiver 2021, l’option de retrait n’est offerte qu’aux étudiants qui commencent leur cycle d’études. Mme Nagar présente des réclamations d’assurance pour des soins paramédicaux durant les mois qui suivent, mais ne fait aucune réclamation pour l’assurance dentaire.
Dans le cas de la demanderesse Feth, elle étudie à temps partiel à l’Université McGill au semestre de l’hiver 2024. Dans son cas, la demande de remboursement pour être exclue du régime collectif est demeurée sans réponse.
Cinq reproches
Les demanderesses reprochent cinq choses à l’ASEQ, à l’assureur et aux universités :
- Le caractère illégal de l’adhésion automatique à un régime collectif.
- Le défaut d’informer les membres du caractère facultatif de l’assurance collective.
- L’imposition du délai abusif et arbitraire pour s’exclure de l’assurance collective.
- Le silence sur le droit de retrait et l’exigence d’une somme pour un service à un consommateur sans que ce dernier l’ait demandé.
- L’atteinte à la vie privée des membres dont certains renseignements personnels ont été transmis sans leur consentement à l’assureur.
Les défenderesses s’opposent à la demande d’autorisation de l’action collective en alléguant l’absence d’une cause d’action défendable, comme prescrit par l’article 574 (2) du Code civil du Québec. Elles affirment que les deux représentantes ont été dûment informées et qu’elles n’ont pas de cause d’action personnelle.
L’ASEQ souligne notamment qu’elle est étrangère au contrat d’assurance collective au cœur du litige. De leur côté, les établissements d’enseignement disent ne pas être responsables, car ils agissent comme simples mandataires des associations étudiantes en facturant et en collectant les primes, lesquelles sont remises intégralement aux mandants.
Critères d’analyse
Pour exercer une action collective, l’autorisation du tribunal est requise. Quatre critères énoncés à l’article 575 du Code civil servent à l’analyse. Le deuxième prescrit notamment que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Si les quatre conditions sont satisfaites, le juge doit autoriser l’action collective.
La juge Lucas résume la jurisprudence des tribunaux supérieurs. Celle-ci a précisé qu’au stade de l’autorisation, les demandeurs doivent démontrer le préjudice, et non pas le prouver. Il faut établir une apparence sérieuse de droit, une cause défendable ou soutenable.
L’apparence de droit est l’élément le plus critiqué par les défenderesses et le tribunal s’y attarde plus longuement. Selon ces dernières, le contrat-cadre peut « légalement prévoir l’adhésion automatique à l’assurance collective découlant de l’adhésion au groupe au bénéfice duquel il a été conclu ». Ainsi, il « s’applique automatiquement à un adhérent de par la simple appartenance au groupe ».
Cette interprétation des défenderesses est basée sur le livre L’assurance collective en milieu de travail de Michel Gilbert, publié en 2006. Ce dernier souligne que le choix du terme « adhérent » par le législateur « évoque une démarche volontaire et autonome de la part de cet adhérent, une forme de ratification des termes de l’entente conclue entre le preneur et l’assureur ».
Par ailleurs, « la nature de la relation juridique unissant les membres du groupe au preneur ne semble pas avoir été définie par la jurisprudence », indique la juge Lucas au paragraphe 37. Dans son livre, Michel Gilbert soulève un questionnement concernant le pouvoir de représentation du groupe par le preneur au moment de conclure le contrat d’assurance collective. Il écrit que ce pouvoir semble tributaire des faits propres à chaque espèce.
L’auteur propose l’existence d’une obligation précontractuelle de renseignement qui pourrait lier les associations et l’assureur, mais aussi les intermédiaires.
Le tribunal indique : « Ni la jurisprudence ni la doctrine (soumises) ne vient confirmer la légalité de l’adhésion automatique à une assurance collective. » Au stade de l’autorisation, la juge estime défendable de prétendre que l’adhésion à une association ne serait pas suffisante à elle seule pour lier les étudiants à l’assurance collective.
Par ailleurs, les demanderesses ne réclament pas la nullité du contrat, mais elles sollicitent des conclusions du tribunal pour qu’il mette fin « à cette pratique illégale » et, le cas échéant, d’obtenir le remboursement des primes payées.
Concernant le deuxième reproche sur le caractère facultatif de l’assurance collective et le caractère vicié du consentement, le tribunal estime que dans le cas de la demanderesse Nagar et de Concordia, les renseignements relatifs au caractère facultatif de l’assurance collective n’apparaissent pas sur la facture des frais de scolarité. La situation est différente pour la demanderesse Feth à McGill, où la mention d’une possibilité de s’en extraire (opt-out) est mentionnée. En revanche, la date-butoir pour demander son exclusion n’est pas indiquée.
Par ailleurs, les demanderesses « peuvent raisonnablement soulever l’incongruité de refuser que les étudiants inscrits au semestre d’automne puissent se retirer au semestre d’hiver suivant ». Elles allèguent aussi que le mécanisme d’exclusion est complexe et que l’ASEQ ne répond pas toujours aux demandes.
Le tribunal analyse ensuite l’applicabilité de la Loi sur la protection des consommateurs (LPC) aux universités, un sujet qui n’a pas encore été traité par la jurisprudence et qui devra être tranché par le juge du fond.
La juge Lucas estime également que les demanderesses ont démontré que leurs renseignements personnels ont été communiqués à un tiers. Elle détermine également que les deux représentantes ont démontré leur intérêt suffisant à contester la validité de l’assurance collective automatique.
Rôle des intermédiaires
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle allègue, l’ASEQ joue un rôle de premier plan dans la négociation et la mise en place des régimes d’assurance collective automatique au sein des associations étudiantes, ajoute le tribunal. Les demanderesses peuvent raisonnablement invoquer sa responsabilité extracontractuelle, dont le mérite sera aussi tranché par le juge du fond après enquête et audition.
Le même raisonnement est applicable aux établissements d’enseignement qui agissent comme mandataires des associations « quand les factures ne divulguent pas les limites de leur mandat ».
La Cour supérieure du Québec devra se pencher sur ces questions, conclut la juge Lucas en autorisant l’action collective. L'appel sur ce jugement sera entendu par la Cour d’appel dans les prochains mois.
Tous les contrats d’assurance collective conclus après le 19 décembre 2019 sont visés par l’action collective. Dans la nouvelle demande déposée le 4 août 2025, LPC Avocats invoque le nombre de 400 000 étudiants couverts par l’ASEQ durant une année donnée.