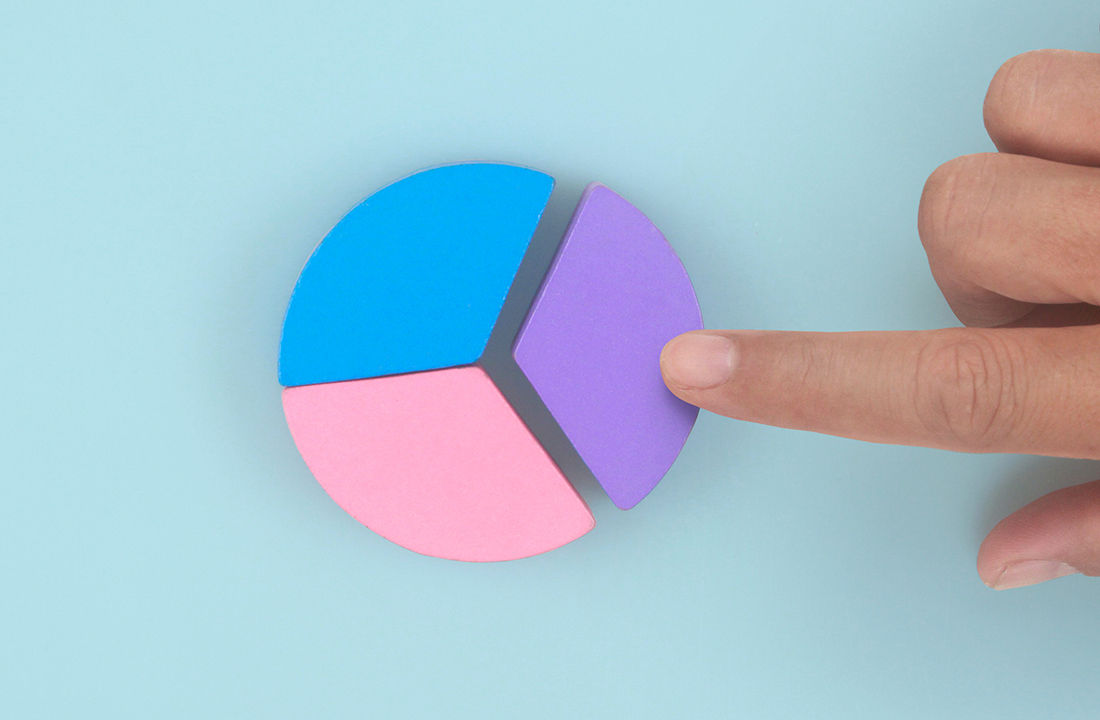Le modèle d’affaires selon lequel la croissance est alimentée par les acquisitions n’est pas la voie à prendre pour la réussite, a affirmé Barry F. Lorenzetti, président fondateur du cabinet de courtage BFL Canada, lors d’un déjeuner-causerie organisé par la Caisse de dépôt et placement du Québec.
« Des entreprises comme Hub International et Arthur J. Gallagher, qui comptent sur les acquisitions pour croitre, paient des multiples incroyables pour les cabinets qu’ils acquièrent. Ça peut parfois aller à trois ou quatre fois la valeur de l’entreprise. C’est que ces cabinets sont soutenus par beaucoup de capitaux privés », pense M. Lorenzetti.
Il précise toutefois ne pas être fermé aux acquisitions. Or, il dit regarder la valeur de l’entreprise qu’il veut acquérir et de ses employés, et refuse de payer les multiples des revenus. « Nous n’avons pas fait beaucoup d’acquisitions, mais lorsqu’on en a fait, nous l’avons fait pour recruter du monde. Si on a de jeunes entrepreneurs et des leadeurs de l’industrie qui regardent pour de bonnes opportunités, BFL en offre assurément. »
Il ne porte pas non plus le modèle des sociétés de capital-investissement dans son cœur. « Je ne souhaite pas acquérir une entreprise pour la “flipper” trois ou quatre ans plus tard. C’est bien si ça te convient, mais notre modèle d’affaires est axé sur rendre nos employés actionnaires de l’entreprise, de créer de la valeur pour eux. Je crois que c’est là où l’industrie est à l’envers. Des compagnies comme Marsh, Aon et BFL ne prennent pas part à ce type de stratégie-là », ajoute M. Lorenzetti.
Miser sur les employés
BFL, qui compte aujourd’hui 825 employés répartis dans 18 bureaux à travers le Canada, mise sur un modèle qui prône l’actionnariat de la part de ses employés. Ainsi, le cabinet compte 118 actionnaires qui sont aussi à son emploi. C’est ce que M. Lorenzetti appelle son blue ocean strategy, puisque lors de la fondation de BFL Canada en 1987, « c’était un modèle complètement unique et différent dans notre domaine et même aujourd’hui c’est marginal ».
Il appuie ses dires en révélant que depuis 32 ans, BFL connait une croissance annuelle de ses revenus dans les deux chiffres. « Parce que nous croyons que la concurrence va continuer à faire des acquisitions en série, nous sommes persuadés que nous aurons davantage d’opportunités avec les employés qui en font les frais », souligne M. Lorenzetti.
Il ajoute que les entreprises publiques peinent à obtenir l’engagement de leurs employés et que leur modèle d’affaires en est la cause.
C’est notamment la raison qui pousse Barry Lorenzetti à vouloir que ses concurrents continuent à mener une foule d’acquisitions. « La consolidation est parfaite pour BFL, même si nous ne voulons pas en faire partie. Parce que ça crée un sentiment chez les jeunes employés de ces cabinets qui se demande “qu’est-ce que j’en tire ? Je travaille d’arrachepied pour cette entreprise depuis un certain nombre de temps, et les propriétaires quittent.” Ce sont donc de bonnes occasions de recrutement pour nous. »
Ce modèle d’affaires a aussi permis à BFL Canada, dont la culture est en majeure partie basée sur son fondateur, de son propre aveu, de planifier la succession. Barry Lorenzetti a réussi à cibler trois vice-présidents avec qui il travaille depuis de nombreuses années pour potentiellement prendre sa place le temps venu de quitter ses fonctions de président.
« C’est tout un défi, admet-il. Il n’y a qu’un seul fondateur. Au début de l’année, nous avons formé un comité des chefs de l’exploitation, un bureau du président si on veut. Parmi les membres de ce comité, on trouve les trois personnes qui pourraient occuper les fonctions de président. Elles connaissent vraiment le modèle d’affaires et le style de l’entreprise. »
La genèse de l’investissement de la Caisse
C’est après avoir vu que la Caisse avait investi dans un important cabinet de courtage américain que Barry Lorenzetti s’est dit que « ce serait intéressant d’avoir un éléphant qui pèse 300 milliards de dollars derrière nous, avec toutes les opportunités que cela peut nous offrir ».
« Après une réunion du conseil d’administration, nous étions inquiets de la perpétuité de notre succès, dont nous étions victimes. La valeur de l’entreprise augmentait, mais nous craignions de voir si l’entreprise aurait les liquidités pour racheter les parts de la Caisse plus tard. Nous avons la capacité d’emprunt pour le faire au besoin », souligne-t-il.
Bien qu’il tenait mordicus à ne pas se départir de ses parts, il en a laissé quelques-unes et a cherché des employés qui souhaitaient vendre les leurs pour que celles-ci soient acquises par la Caisse. « Cette façon de faire n’a pas encombré les plus jeunes actionnaires de dettes et c’était aussi une façon de planifier la succession de l’entreprise », explique M. Lorenzetti. La Caisse a d’ailleurs demandé à ce que l’un de ses représentants soit présent dans le comité de succession de l’entreprise.
Il a révélé avoir mis en place douze conditions à respecter pour que l’investissement se concrétise, dont que la participation de la Caisse soit minoritaire. BFL et ses actionnaires ont ainsi conservé 67 % des parts de l’entreprise.
En tout, l’entente a nécessité une année de négociations pour finalement se concrétiser le 1er juillet 2018. « Depuis, la Caisse s’est avérée être une bonne partenaire, qui n’est pas active dans le management, mais plutôt dans le monde des affaires. Elle a investi dans 715 entreprises canadiennes et est impliquée dans des dossiers de gestion de risques. Cela nous ouvre des portes, comme nous pouvons lui en ouvrir. Dans chaque accord, il faut que 1 + 1 = 3. Il faut que chacune des parties y trouve son compte et que tout le monde en retire un plus », conclut M. Lorenzetti.