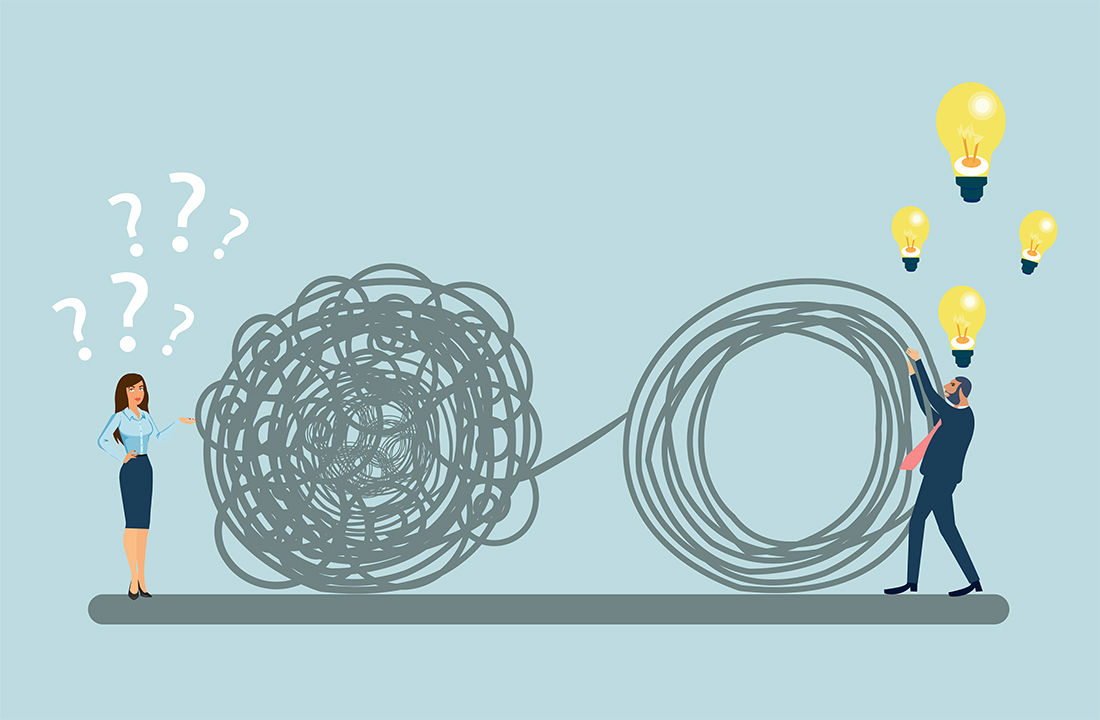L’espérance de vie augmente au Canada. Selon Statistique Canada, l’espérance de vie des Canadiens qui ont atteint l’âge de 65 ans entre 2020 et 2022 se situe en moyenne à 85,8 ans. En 2023, l’espérance de vie moyenne des Canadiens est passée à 85,9 ans, comparativement à 79,9 ans en 1971, d’après des données de l’Institut de la statistique du Québec.
Bonne nouvelle en soi, cette tendance pèse pourtant sur les obligations qu’ont les régimes de retraite à prestations déterminées envers leurs retraités, futurs ou actuels. Pour honorer la promesse de payer à vie une rente de retraite à l’employé, les promoteurs de ces régimes devront jouer de prudence.
Dans son bulletin Perspectives de janvier 2025, la firme d’actuariat Eckler écrit que les promoteurs devront accepter l’incertitude dans leurs hypothèses sur la longévité des participants de régimes de retraite.
Eckler fait référence à Recherche sur l’amélioration de la mortalité, une étude canadienne de l’Institut canadien des actuaires (ICA) sur l’amélioration de la mortalité, publiée en avril 2024. Il s’agit du rapport Recherche sur l’amélioration de la mortalité, qui recommande une nouvelle échelle pour jauger l’amélioration de la mortalité à long terme au Canada.
Appelée APCI par l’ICA, la nouvelle échelle amène des hypothèses de longévité plus élevée, ce qui pourraient avoir un impact sur le passif des régimes qui les utiliseront, estime Eckler. L’ICA recourt à d’autres échelles plus anciennes pour comparer ses nouveaux taux d’amélioration, dont CPM-B (publié en 2014) et MI-2017 (publié en 2017).
Grande incertitude
Les taux futurs d’amélioration de la mortalité sont très incertains, écrivent les auteurs de l’étude de l’ICA. Ils recommandent aux actuaires de régimes de retraite à prestations déterminées d’ajuster leurs hypothèses selon un taux d’amélioration de la mortalité à long terme de 1,3 %.
« Cela signifie qu’à long terme, les taux de mortalité diminueront de 1,3 % par an et que, par conséquent, l’espérance de vie augmentera », commente Eckler dans son bulletin. La firme d’actuariat précise que l’ICA a fixé ce taux en utilisant des modèles sur les données historiques de la population canadienne, et en les projetant dans l’avenir.
Utiliser le passé pour prédire l’avenir est un exercice difficile et incertain – Bulletin Perspectives de Eckler
Dans son étude, l’ICA mentionne une fourchette de variantes à l’hypothèse de base de 1,3 %. L’hypothèse pourrait ainsi varier entre 1,0 % et 1,9 %. Eckler estime la fourchette raisonnable, mais propose toutefois de ramener sa limite inférieure à 0,8 %. Cela permet selon Eckler de tenir compte du taux d’amélioration de la mortalité à long terme utilisé sous l’échelle CPM-B (0,8 %). La firme justifie que c’est l’hypothèse d’amélioration la plus couramment utilisée par les régimes de retraite canadiens.
Eckler souligne qu’une série d’hypothèses alternatives au taux de 1,3 % devient plausible avec la fourchette définie par l’ICA. « Cela démontre également combien il est difficile d’élaborer une hypothèse d’amélioration de la mortalité. Même avec des données portant sur des dizaines de millions de Canadiens, utiliser le passé pour prédire l’avenir est un exercice difficile et incertain », peut-on lire dans le bulletin d’Eckler.
Impact sur les régimes
Le tableau qui suit montre que choisir l’hypothèse d’amélioration de la mortalité à long terme la plus élevée de la fourchette, soit 1,9 %, aura un impact considérable. Surtout dans les régimes avec une grande proportion de participants de 45 ans et moins.
Dans ce tableau, Eckler rebaptise le modèle ACPI de l’Institut canadien des actuaires en MI-CAN-2024, parce qu’il juge cet acronyme plus intuitif. Il y ramène aussi à 0,8 % la partie inférieure de la fourchette, ce qui lui permet d’inclure le taux d’amélioration à long terme utilisé sous l’échelle CPM-B. Eckler explique que cette hypothèse est la plus couramment utilisée par les régimes de retraite canadiens
Eckler observe qu’adopter un taux d’amélioration de la mortalité de 1,9 % mène à des augmentations significatives de l’espérance de vie attendue. C’est le cas même chez les participants âgés de 65 ans, ajoute la firme. Elle remarque également que l’incidence des différents taux sur l’espérance de vie est beaucoup plus prononcée chez les participants plus jeunes.
Placement réfléchi et cotisations supplémentaires
Le choix du taux d’amélioration de la mortalité à long terme aura aussi une incidence sur le passif d’un régime, soit ses obligations envers les participants quant à la rente de retraite. L’incidence sera davantage prononcée sur les régimes les moins matures, souligne Eckler. Il s’agit de ceux dont la proportion des participants actifs est plus élevée que celle des participants retraités.
Choisir une hypothèse aura aussi une incidence sur les prestations que le régime s’attend à verser dans le futur. Les actuaires de retraite utilisent souvent l’exemple d’un régime hypothétique pour démontrer. La projection porte souvent sur une période de 100 ans. Eckler a choisi un régime hypothétique dont environ 45 % des participants sont actifs, et dont les prestations de retraite augmentent de 2 % par année.
Dans cet exemple, les flux de trésorerie prévus au cours des 100 prochaines années atteignent 6,3 milliards de dollars (G$) selon l’hypothèse la plus conservatrice de 0,8 %, comparativement à 7,4 G$ selon l’hypothèse extrême de 1,9 %. « Si le taux d’amélioration de 1,9 % se confirmait dans la pratique, le milliard de dollars supplémentaire devrait être financé par des rendements de placement futurs ou par des cotisations supplémentaires », soutient Eckler.