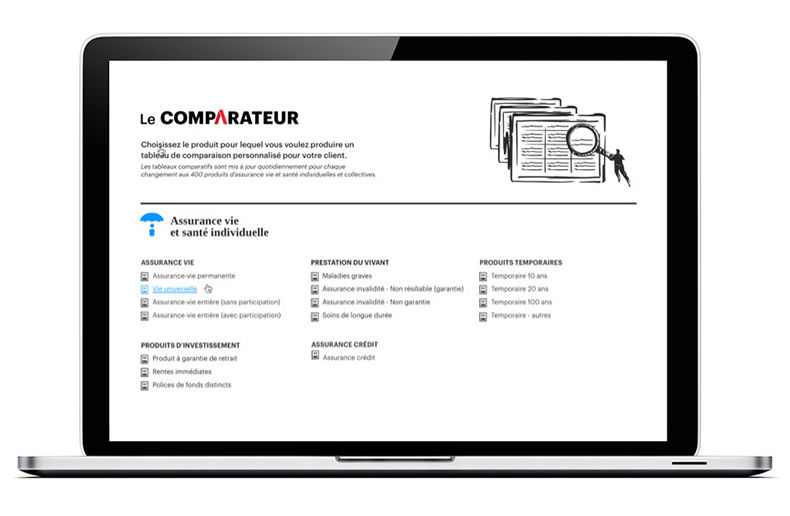Coût croissant des soins de santé et des médicaments, désengagement de l’État, pression financière accrue sur les PME, honoraires professionnels en hausse… le portrait de l’avenir de l’assurance collective est tout sauf rose!L’industrie de l’assurance collective ne vit pas en vase clos, a rappelé Claude Di Stasio, vice-présidente aux affaires québécoises à l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP). Elle subit les mêmes pressions qui affectent l’ensemble de l’assurance vie : bas taux d’intérêt, réforme des normes comptables (IFRS), exigences de capital grandissantes des régulateurs, effondrement des marchés financiers en Europe, crise de la dette souveraine de nombreux pays, mouvement accru pour la protection du consommateur… « Heureusement, la distribution sans représentant n’a pas encore frappé l’industrie de l’assurance collective », a-t-elle lancé lors du colloque Solareh.
Sur une période de 10 ans, dans la foulée de l’arrêt Chaouli, l’assurance santé est désormais couverte à 55 % par les régimes privés. « Dans l’assurance collective, pour les soins complémentaires, prévoyez que le secteur public continuera de réduire sa contribution et que les dépenses en cette matière seront refilées aux régimes privés. »
Selon le récent rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), l’augmentation du cout de l’assurance médicaments n’a été que de 4 % en 2011 comparativement à 2010. L’impact du médicament générique n’est donc pas négligeable, dit-elle.
Toutefois, l’accès mur à mur aux nouveaux médicaments représente un défi qui confronte l’industrie, insiste Mme Di Stasio. Si les preneurs ne veulent plus payer, on entre dans la catégorie des régimes catastrophes. Si les employeurs maintiennent les avantages sociaux, ils devront couper ailleurs. Selon un sondage mené par l’ACCAP auprès des PME, dont les résultats ont été publiés le printemps dernier, un employeur sur trois se dit prêt à réduire la couverture offerte par le régime collectif si les primes liées à l’assurance médicaments augmentent encore de 25 %.
Il n’y a pas qu’au Québec où l’on se préoccupe des couts du système de santé. La commission Drummond a récemment soumis son rapport à la province de l’Ontario. Là aussi, on constate que le système de gestion de la santé est inefficace, qu’il est nécessaire de remettre en question l’efficacité dans la livraison des services, et qu’il est temps de sortir tous les services des hôpitaux. Mais aucune recommandation ne porte sur la nécessité de superviser la transition ou la continuité des soins lorsque le patient sort de l’hôpital. Le patient continue de voyager seul, souligne-t-elle.
L’économie du Québec a elle aussi ses problèmes, comme on a pu le voir au dernier congrès de l’Association des économistes du Québec, du 2 au 4 mai dernier. Il a alors été question de l’assiette fiscale et du financement du système de santé. Les économistes disent que de nombreux indices montrent que le système public craque. « On ne peut même pas comptabiliser ce que coute un épisode de soins dans le public, alors que le système privé arrive parfaitement à le faire », déplore Mme Di Stasio.
Le ministre de la Santé du Québec est fier de l’impact de la politique du médicament, laquelle a permis de maintenir à 2,6 % la hausse du régime d’assurance médicaments de la RAMQ, en 2011. Ce qu’il ne dit pas, c’est que la différence a été absorbée par les preneurs, car la baisse du prix des génériques a été récupérée par les pharmaciens. Les besoins d’assurance par tranche de 100 $ de revenus ne sont plus les mêmes.
L’industrie a constaté en avril dernier qu’il existait un écart de 15 % entre le prix du médicament, prescrit par le même médecin et acheté dans la même pharmacie, selon qu’il est remboursé par le régime public de la RAMQ ou par le régime privé. Les assureurs ont des problèmes avec l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) depuis des années, précise Claude Di Stasio. Les pharmaciens sont des gens d’affaires et il est nécessaire de comprendre qu’ils agissent comme grossistes, dit l’AQPP aux assureurs.
Mais c’est seulement au Québec que la loi prévoit que seul un pharmacien peut être propriétaire d’une pharmacie, fait-elle observer. L’AQPP a fait la démonstration que pour certains médicaments, le régime public paie plus cher que les régimes privés. Mais les assureurs affirment que plus le médicament coute cher, plus l’écart au détriment des régimes privés s’accentue. « Le gouvernement ne paie pas assez cher », dénonce alors l’AQPP.
Manque de transparence
Les assureurs constatent qu’il existe un manque de transparence à l’égard des honoraires professionnels réclamés par les pharmaciens. « Quand on leur parle de cela, l’AQPP menace de facturer des services connexes aux assurés. Nous leur répondons : allez-y, et ce sera au consommateur de décider s’il paie ou pas pour obtenir ces services », précise-t-elle. « À l’ACCAP, nous pensons que s’il est possible de magasiner pour tous les services, pourquoi est-ce impossible de le faire dans ce secteur? », dit-elle.
Il est temps de d’abolir le prix usuel coutumier (PUC) qui régit la facture dans les pharmacies du Québec, dit-elle. Des économies sont possibles en améliorant le réseau de distribution des médicaments les plus couteux, de manière à éviter que les pharmaciens les gardent trop longtemps en stock. L’industrie de l’assurance aurait alors de meilleurs arguments pour discuter de la question des honoraires professionnels et des marges de profit des pharmaciens, voire de contribuer à une entente impliquant les gouvernements provinciaux sur le prix des médicaments.
Tous ces échanges avec l’AQPP soulèvent la pertinence de tout offrir à tout le monde et gratuitement, avance Claude Di Stasio. Si cette réflexion est entamée pour les soins couverts par le régime public, il est opportun de la poursuivre pour les soins dont le cout doit être absorbé par le privé. « Dans les régimes collectifs, les preneurs décident de couvrir leur actif, qui est leur employé. Mais est-il nécessaire d’offrir tous les soins complémentaires à la famille? Si on commence à couper dans les soins, ça contrevient à l’objectif de couverture des soins complémentaires », dit-elle.
Tout cela aura une incidence sur les conseillers, les entreprises et les assureurs.