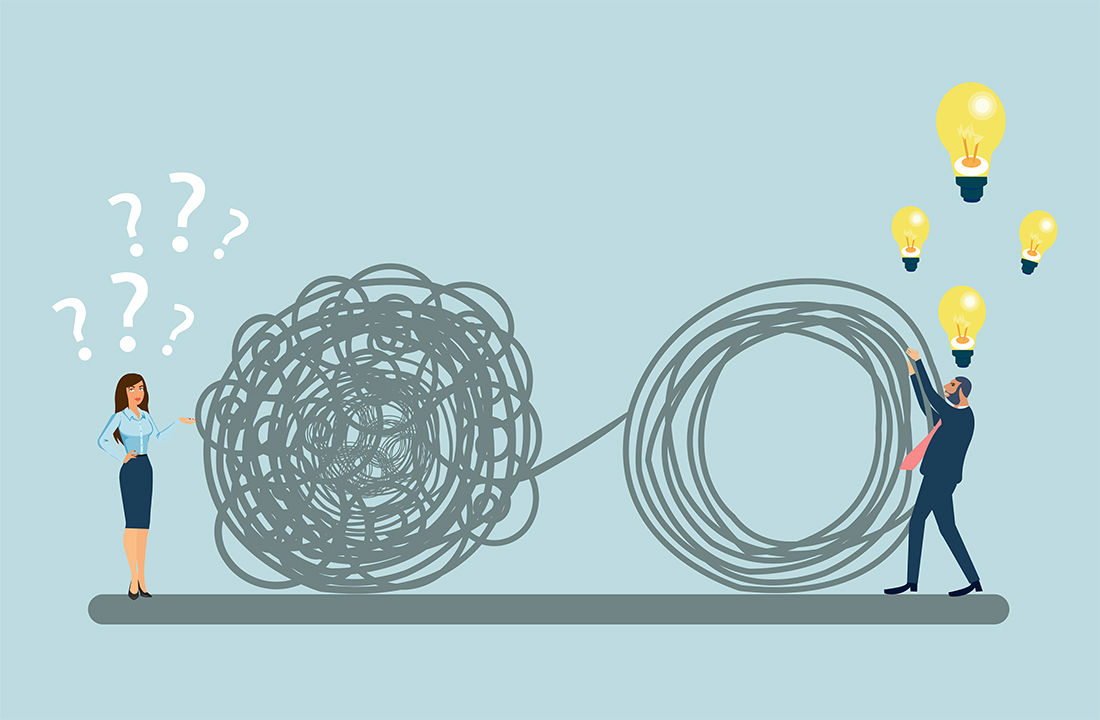Deux rapports de Statistique Canada révèlent que le syndrome métabolique (ou SM) touche plus d’un Canadien sur quatre âgé de 18 à 79 ans et que sa prévalence augmente avec l’âge.
Le syndrome métabolique est défini par la présence d’un ensemble de facteurs augmentant le risque de maladie du cœur et de diabète de type 2. Ils peuvent inclure l’obésité abdominale, l’hypertension artérielle, une glycémie élevée, un faible taux de cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL, ou « bon » cholestérol), ainsi qu’un taux élevé de triglycérides, explique Statistique Canada.
Dans la première étude, intitulée Syndrome métabolique chez les adultes canadiens, 2007 à 2019, les chercheurs précisent que la présence de ce syndrome double le risque de maladies cardiovasculaires et multiplie par cinq le risque de développer un diabète.
« La prévalence du SM était similaire chez les hommes (27%) et chez les femmes (25%), mais elle augmentait considérablement avec l'âge pour passer de 11% chez les jeunes adultes (âgés de 18 à 39 ans) à 30% chez les adultes de 40 à 59 ans et à 44% chez les personnes plus âgées (de 60 à 79 ans), rapporte Statistique Canada. Dans le groupe des personnes plus âgées, le SM était plus fréquent chez les hommes (51%) que chez les femmes (38%). Dans l'ensemble, la prévalence du SM chez les adultes canadiens est restée à peu près la même de 2007 à 2019. »
L’obésité abdominale
L’étude démontre que l’obésité abdominale était le facteur de risque le plus courant lors de sa quête de données entre 2016 et 2019, touchant 90% des Canadiens atteints du syndrome. Une glycémie élevée concernait 70,6% d’entre eux, tandis qu’un faible taux de cholestérol HDL affectait 65,8% des personnes touchées.
« La prévalence de l’hypertension artérielle était plus élevée chez les hommes (73,0 %) que chez les femmes (60,1 %), tandis que la prévalence des triglycérides plasmatiques élevés, de l’hyperglycémie à jeun et du faible taux de cholestérol LHD ne différait pas selon le sexe », précise d'ailleurs le rapport.
La prévalence de l’obésité abdominale était plus élevée chez les femmes que chez les hommes et variait peu selon les groupes d’âge, comme le démontre le tableau suivant tiré de l’étude de Statistique Canada.
Le rapport entre la santé métabolique et le poids
La seconde étude, Phénotypes de santé métabolique et d’indice de masse corporelle chez les adultes, met en évidence un lien étroit entre une mauvaise santé métabolique et un indice de masse corporelle (IMC) élevé.
Une personne était considérée comme « en mauvaise santé métabolique » si elle présentait au moins trois des cinq critères suivants : un taux de triglycérides élevé, un faible taux de cholestérol HDL, un tour de taille élevé, une hypertension artérielle et une glycémie à jeun élevée.
« L'inflammation systémique était plus courante chez les adultes en surpoids ou atteints d'obésité, quel que soit leur état de santé métabolique. Toutefois, les adultes en mauvaise santé métabolique et en surpoids ou atteints d'obésité étaient encore plus susceptibles de présenter de l'inflammation que leurs homologues en bonne santé métabolique », rapporte Statistique Canada. « Ces constatations donnent à penser que l'examen conjoint de la santé métabolique et de l'IMC peut permettre de mieux identifier les risques pour la santé. »
L’étude note que moins de 4% des adultes ayant un poids normal étaient en mauvaise santé métabolique, comparativement à 24% des adultes en surpoids et à 54% des adultes obèses.
Les chercheurs précisent que les différences entre hommes et femmes dans l’échantillon étaient minimes. « La prévalence d’une mauvaise santé métabolique dans toutes les catégories d’IMC était plus élevée dans les groupes plus âgés », notent les chercheurs dans leur rapport.