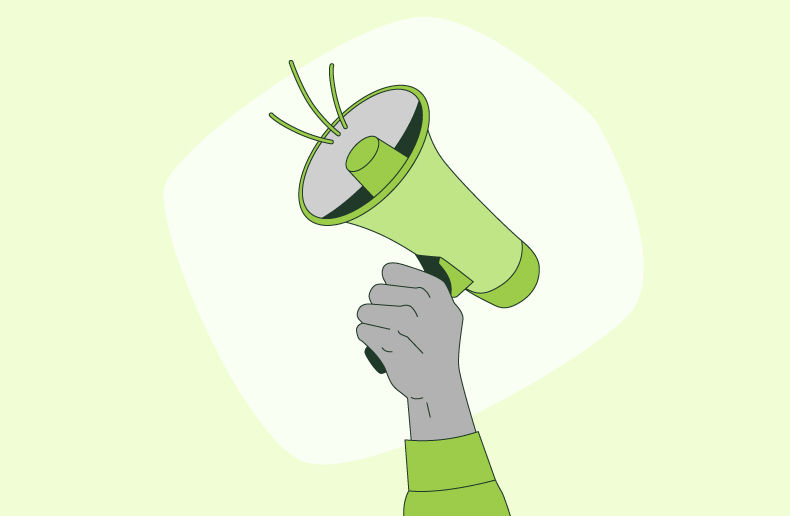Le projet de loi 28 du gouvernement du Québec a englobé une multitude de mesures changeant la législation. L’une d’entre elles pourrait avoir des impacts sur les assureurs vie et leur recours aux médicaments génériques.
Les assureurs vie québécois sont réputés pour être quelque peu frileux quand vient le temps de prescrire des médicaments génériques. Pour preuve, le niveau d’utilisation des médicaments génériques est de 74 % à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Dans le secteur privé, terrain de jeu des assureurs vie, ce taux oscille présentement entre 56 % et 57 %.
Au total, le taux d’utilisation des médicaments génériques au Québec est de 68 %. À titre comparatif, aux États-Unis, il est de 86 %.
La clause 28.2* du projet de loi 28 pourrait toutefois inciter les assureurs à faire davantage appel aux médicaments génériques, croit l’Association canadienne des médicaments génériques. Cette clause vient changer certains principes dans la façon de rembourser les médicaments au Québec. Comme ils sont généralement moins couteux, les médicaments génériques pourraient en bénéficier et voir leur taux d’utilisation grimper. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur en octobre.
Daniel Charron, directeur du Québec pour l’Association canadienne des médicaments génériques, affirme que les dispositions précédentes étaient un frein important à l’utilisation des médicaments génériques dans le secteur privé au Québec. « Il était important de le faire et il s’agit d’un changement remarquable », a-t-il confié en entrevue au Journal de l’assurance.
M. Charron dit toutefois que le Québec a grandement changé ses façons de faire en la matière. Ayant longtemps été en milieu de peloton quant à son taux d’utilisation par rapport aux autres provinces, le Québec est désormais le deuxième plus grand consommateur de médicaments génériques au Québec.
Le tout est attribuable au fait que le régime public a emboité le pas. Ce que le secteur privé n’a pas fait encore, même si beaucoup de travail a été fait, dit M. Charron. L’écart d’utilisation entre le secteur public et le secteur privé demeure important, mais il s’attend à le voir rétrécir. D’autant plus que des regroupements d’assureurs ont demandé au ministre des Finances du Québec de revoir ses façons de faire, ce que le projet de loi entérinera.
Des doutes persistent toutefois quant à l’usage des médicaments génériques. Lors du Colloque Solareh 2014, Jean-Louis Brazier, professeur émérite en pharmacologie à l’Université de Montréal, avait créé une certaine commotion en affirmant que l’alternative thérapeutique que présentent les médicaments génériques est un risque pour certains patients. Le mauvais dosage dont ils peuvent être victimes est susceptible de couter cher en soins, avait-il affirmé. Il rappelait par ailleurs que certaines études révèlent que l’usage de médicaments génériques peut réduire l’adhésion au traitement des patients.
M. Charron affirme que M. Brazier a droit à son opinion, mais que des organismes comme Santé Canada et de l’Institut national de la santé publique du Québec ont émis des avis en faveur des médicaments génériques. Il ajoute par ailleurs que les patients ont toujours le choix de prendre le médicament générique ou pas. « Il peut payer la différence. Le médecin peut aussi le requérir. Le système actuel fait en sorte que le patient peut être assez confiant dans ce qui lui est offert », dit-il.
Les anciennes dispositions limitaient à 32,5 % le co-paiement du patient.
– Daniel Charron
M. Charron se dit surpris que les assureurs n’aient pas embarqué dans le train avant, vu les économies de cout qu’amènent les médicaments génériques. Il serait plus surpris encore si les assureurs manquaient le bateau cette fois-ci.
« Les anciennes dispositions limitaient à 32,5 % le co-paiement du patient. Comme le cout des médicaments était moins élevé, la problématique se posait moins. Cette mesure visait aussi à aider les patients moins fortunés. La baisse du cout des médicaments génériques change la donne. La différence peut aller jusqu’à 87 % avec le médicament d’origine. Avec le remboursement public de 18 %, ça veut dire que l’assureur doit rembourser 67,5 %. Comme le prix des médicaments a changé, l’avantage de recourir aux médicaments génériques est plus grand que jamais, tant pour l’assureur que pour le client. On vise à offrir le système le plus compétitif possible », dit-il.
Le nombre de molécules reproduites génériquement a aussi augmenté, notamment pour les médicaments pour le cholestérol, comme le Lipitor et Crestor. Le volume de prescriptions pour ce type de médicaments a aussi augmenté.
Un troisième facteur, plus irrationnel celui-là selon M. Charron, entre en ligne de compte. Les chances d’obtenir un médicament générique sont très fortes. « Dans le régime public, 70 % des médicaments prescrits sont des génériques. Dans les hôpitaux, ce ne sont quasiment que des médicaments génériques qui sont donnés. Le nombre de traitements générécisés est ainsi en hausse, sauf dans certaines disciplines, comme l’oncologie, mais même là, les couts s’amenuisent. Dans tous les champs thérapeutiques, il y a des médicaments génériques, notamment en santé mentale, où les avancées continuent », dit-il.
*Le libellé de la clause 28.2
Lorsqu’une personne admissible choisit un médicament prescrit dont le cout dépasse le montant minimum de paiement couvert par le régime général ou lorsque le cout du médicament prescrit dépasse ce montant, la différence entre ce montant et le prix payé doit être assumée par la personne admissible, n’est pas incluse dans la contribution payable par celle-ci et n’entre pas dans le calcul de sa contribution maximale.