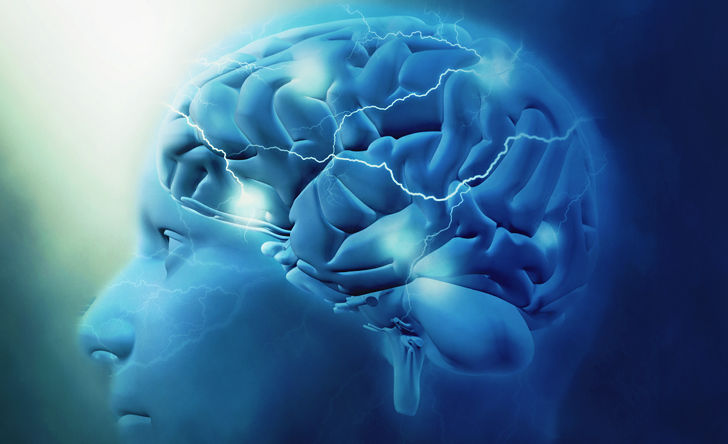S’il veut réduire l’écart qui sépare son niveau de vie de celui de la moyenne d’un groupe de 19 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Québec doit favoriser l’entrée en jeu des forces de la concurrence et améliorer la compétitivité du régime fiscal des petites entreprises, ce qui sera de nature à hausser la productivité de la province, croient des chercheurs de HEC Montréal.
Le 13e bilan annuel Productivité et prospérité au Québec, publié à la mi-mars par le Centre sur la productivité et la prospérité — Fondation Walter J. Somers (CPP), dresse encore cette année le portrait d’un Québec qui, sans surprise, continue d’accuser un retard économique notable si on compare son niveau de vie à la moyenne de celui d’un groupe de 19 pays membres de l’OCDE.
Les auteurs, Robert Gagné, directeur du CPP, et ses collègues chercheurs Jonathan Deslauriers, directeur exécutif du CPP, et Jonathan Pagé, tous de HEC Montréal, établissent qu’en 2021 un écart de niveau de vie de 11 957 $ par habitant séparait le Québec de cette moyenne. Il s’agit d’un retard de plus de 20 % sur la moyenne OCDE19, alors que cet écart n’était que de 5,8 % en 1981.
Le niveau de vie est défini comme étant le produit intérieur brut (PIB) en dollars canadiens de 2021, par habitant, à parité des pouvoirs d’achat.
Point positif, l’écart de niveau de vie entre la moyenne OCDE19 et le Québec s’est très légèrement rétréci depuis 2018, malgré la récession de 2020, peut-on observer dans le bilan 2022 du CPP.
La productivité, le seul levier
Le CPP réitère encore cette année que hausser la productivité est le seul levier qui reste au Québec pour accroître le niveau de vie et espérer se rapprocher de la moyenne OCDE19.
Les auteurs rappellent qu’en 2019 le retard de productivité au travail du Québec « expliquait 116 % de l’écart de niveau de vie avec la moyenne OCDE. » L’intensité du travail, qui mesure le nombre d’heures travaillées par emploi, était plus élevée au Québec que dans le groupe OCDE19, et le taux d’emploi, semblable. Il y a donc peu de marge de manœuvre quant à ces deux derniers leviers.
Tout en observant que « l’horizon économique du Québec s’est progressivement éclairci » depuis 2016, le CPP sonne l’alarme : « Le défi qui attend le Québec n’en demeure pas moins colossal », écrivent-ils dans leur bilan annuel. C’est que le Québec, estiment-ils, est « à la croisée des chemins ».
Une réforme en profondeur des politiques fiscales et de soutien aux entreprises s’impose plus que jamais, plaident-ils. Sans quoi, appréhendent-ils, « la province risque de s’enliser dans la même spirale qui entraîne l’économie canadienne vers le bas depuis 2015. »
Rattraper l’Ontario : possible, mais insuffisant
Pour l’heure, si le Québec maintient un rythme de croissance supérieur à l’Ontario comme cela a été observé entre 2016 et 2019 – 1,74 % par année, contre 1,17 % —, la province rattrapera le niveau de vie de sa voisine vers 2039, à peine trois ans plus tard que l’objectif que s’est donné le gouvernement du Québec.
Il s’agit toutefois d’un « seuil minimal à atteindre si le Québec souhaite réduire le retard économique cumulé aux économies du groupe OCDE19 », estime le CPP.
« À l’instar de l’ensemble du Canada, l’Ontario est en perte de vitesse par rapport à la moyenne OCDE19, explique le coauteur Jonathan Paré au Portail de l’assurance. Autrement dit, le rattrapage sur l’Ontario n’est pas nécessairement un gage de succès à l’échelle de l’OCDE si on se fie à leurs projections à long terme. »
La concurrence pour stimuler l’innovation et l’efficacité
« Pour hausser la productivité, peut-être qu’après avoir essayé 40 000 affaires, la seule chose qui reste, c’est de favoriser la concurrence », lance Robert Gagné.
Contacté par le Portail de l’assurance au sujet de l’accent mis cette année par le CPP sur l’enjeu de la concurrence, le chercheur est d’avis que « laisser les entreprises se concurrencer entre elles devrait entraîner plus d’innovation et éventuellement plus de productivité, ce qui aura un impact sur le niveau de vie ».
Forts de leur analyse portant sur l’enjeu de la concurrence au Canada publiée l’automne dernier, les auteurs consacrent deux des cinq chapitres de leur bilan annuel à cet aspect de l’économie.
Ils mettent en relief que le cadre de la concurrence intérieure canadien continue de donner priorité à la protection des emplois et à la croissance de la taille des entreprises.
Il y a bien eu la Loi sur Investissement Canada en 1985, la Loi sur la concurrence en 1986 et l’Accord de libre–échange Canada–États-Unis en 1989, qui ont stimulé l’économie et accentué la présence canadienne sur les marchés étrangers après la récession du début des années 1990, rappelle le CPP, mais les entreprises, surfant sur un taux de change avantageux, n’ont pas été incitées à innover et à investir.
« Mal outillées, les entreprises canadiennes n’ont pas été en mesure de s’imposer dans des marchés de plus en plus intégrés, et plusieurs secteurs ont été pris de court lorsque la concurrence des économies émergentes s’est intensifiée au début des années 2000 », constatent les auteurs.
Une situation qui perdure, selon le CPP, sur fond de politiques publiques qui priorisent la protection des emplois et la croissance des entreprises. « Les enjeux de concurrence demeurent relégués au second rang des priorités en matière de développement économique », déplorent les auteurs.
Le CPP publie dans son bilan le classement des pays selon l’indice de réglementation des marchés de produits (RMP) de l’OCDE. Cet indice évalue le degré de restriction des politiques publiques d’un pays en matière de concurrence.
« C’est sans équivoque, constate le CPP. Le Canada impose davantage de contraintes à l’égard de la concurrence que les autres pays. »
Plusieurs indicateurs, selon le CPP, laissent croire que l’intensité de la concurrence n’est pas suffisante, notamment pour pousser les entreprises à se démarquer à préserver ou augmenter leurs parts de marché, investir davantage et augmenter leurs activités de R et D.
Au Québec, par exemple, le poids des exportations dans le PIB est plus faible que dans les économies de plusieurs pays de l’OCDE de taille similaire.
Des crédits d’impôt stériles
Si la stratégie fiscale du Québec, au cours des années 2000, a permis d’appuyer la transition de l’économie et création d’emplois dans des créneaux d’avenir — industrie du jeu vidéo, par exemple — elle a été « maintenue loin au-delà de sa vie utile », juge le CPP. Elle a de plus créé des distorsions sur le plan de la concurrence, soutiennent-ils.
Et la mécanique fiscale avait le défaut, rappellent-ils, d’être fondée sur des crédits d’impôt qui finançaient une partie des salaires afférents, au lieu de financer les investissements en machines et matériel.
La politique fiscale du Québec demeure aujourd’hui « profondément ancrée autour de l’enjeu de l’emploi », déplore le CPP.
Résultat : les chercheurs évaluent que le gouvernement du Québec a renoncé à des revenus d’environ 20 milliards de dollars (G$) au cours des années 2010, la stratégie fiscale et ses crédits d’impôt n’ayant pas produit les résultats escomptés sur le plan de la productivité. En 2021, la somme des crédits d’impôt offerts aux entreprises s’élève à 2,4 G$.
En outre, certains crédits, par exemple celui pour la production de titres multimédias, « cannibalisent des ressources humaines qui pourraient être employées plus efficacement dans des entreprises ou des secteurs d’activité potentiellement plus productifs, innovateurs ou créateurs de valeur ajoutée », estiment les auteurs.
Les auteurs font aussi valoir qu’une bonne partie des crédits d’impôt instaurés il y a plusieurs années est « sédimentée » : plusieurs entreprises « profitent d’une aide récurrente sur une longue période sans que l’État ait une quelconque garantie de résultats ». Et cette aide bénéficie majoritairement aux grandes entreprises, démontrent-ils, qui profitent ici d’un avantage concurrentiel qui selon eux n’est plus justifié et n’est pas de nature à augmenter la productivité.
Le CPP estime que le coût de la stratégie fiscale du Québec est, toute proportion gardée, de deux à trois fois plus élevé qu’en Ontario.
« On demande donc au gouvernement d’en faire moins, avec pour résultat que ça va lui coûter moins cher, résume Robert Gagné. Il va pouvoir ainsi libérer de l’espace fiscal pour les entreprises, pour qu’elles puissent se concurrencer davantage. »
De l’oxygène, c’est urgent !
Le CPP rappelle que les petites entreprises, minoritaires dans le lot des entreprises qui ont profité des crédits d’impôt ces 25 dernières années, ont eu un taux d’imposition plus élevé qu’en Ontario durant la majeure partie des décennies 2000 et 2010. Il ajoute que si elles ont un taux d’imposition aujourd’hui semblable à leurs voisines ontariennes, elles doivent néanmoins cotiser au fonds des services de santé (FSS), une taxe prélevée sur la base de leur masse salariale « dont les taux excèdent largement ceux de l’Ontario ».
« Plutôt que proposer des crédits d’une autre époque à un faible nombre de petites entreprises, le gouvernement obtiendra assurément de meilleurs résultats en réduisant le fardeau fiscal qu’elles supportent », concluent les auteurs.
Ils affirment que les exempter de cotisation au FSS pourrait leur permettre d’innover et d’investir. Un soutien financier direct aux investissements serait aussi de nature, selon eux, à améliorer la productivité du travail.