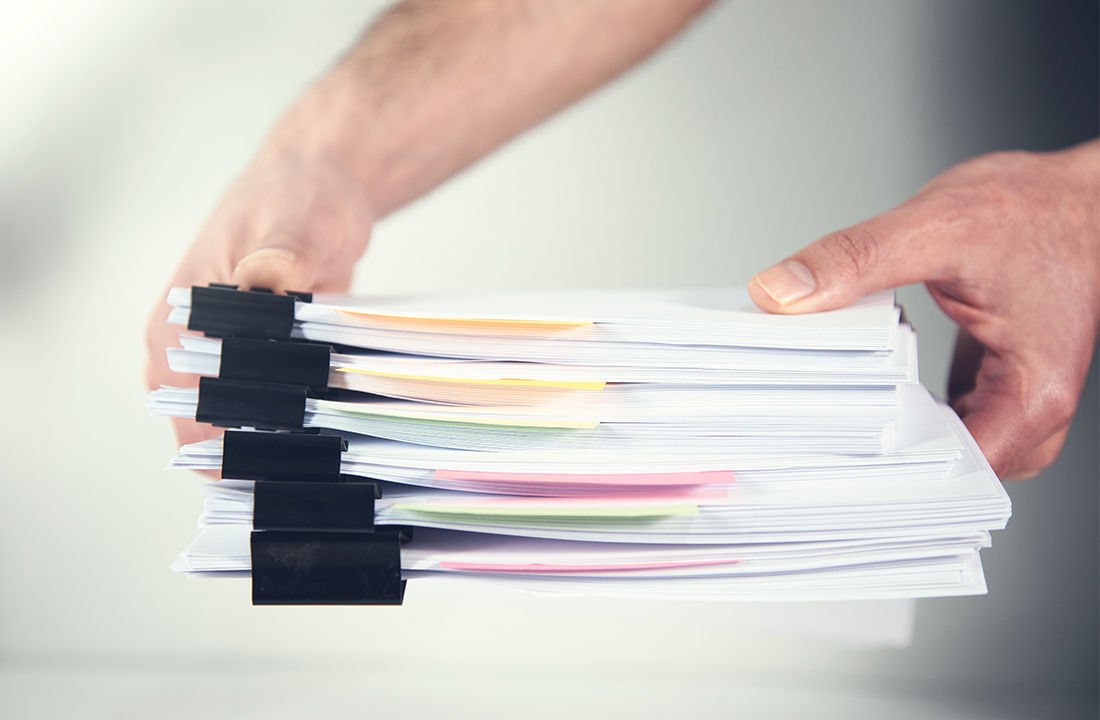L’utilisation des tests génétiques dans la souscription d’assurance vie et santé constitue depuis plusieurs années un sujet de débat clé — et même l’objet d’un recours devant la Cour suprême du Canada — au sein de l’industrie. Un nouveau rapport de Swiss Re,affirme que les assureurs ont besoin d’accéder à ces informations, interdites par la loi au Canada, pour maintenir les avantages sociaux et financiers des assurances vie et santé.
Les auteurs du rapport, intitulé Genetic testing in the Life & Health insurance industry, soulignent que le coût du séquençage complet d’un génome humain est passé de 10 millions $ US en 2007 à moins de 500 $ aujourd’hui. En 2003, le premier brouillon du génome humain aurait coûté 3 milliards $.
Cette évolution a favorisé l’expansion rapide des tests génétiques pour diverses fins médicales et de bien-être personnel, indiquent les auteurs du rapport. Le prix des tests disponibles directement pour les consommateurs varient entre 99 $ et plus de 1 000 $. Ces tests ne sont généralement pas couverts par les régimes d’assurance maladie.
Les risques liés à la sélection adverse
Les auteurs mettent en garde contre l’asymétrie de l’information, où les consommateurs connaissent leurs prédispositions génétiques alors que les assureurs, limités par les réglementations, ne peuvent pas utiliser ces données. Cela peut déséquilibrer le bassin de risques, entraîner des réclamations et des coûts plus élevés que prévu pour les assureurs, tandis que les individus à haut risque paient des primes plus basses qu’ils ne le devraient.
« Pour gérer la sélection adverse, les assureurs pourraient augmenter les primes pour l’ensemble des assurés, ce qui risquerait de décourager les individus à faible risque de souscrire une assurance, aggravant ainsi le problème et, dans certains cas, rendant l’assurance inabordable ou insoutenable », avertissent-ils.
De plus, ils notent que l’adoption généralisée des tests pourrait accélérer les diagnostics, ce qui entraînerait potentiellement une augmentation des réclamations pour des produits comme l’assurance maladies graves et le remboursement des frais médicaux. « Les assureurs pourraient observer des changements inattendus dans l’incidence des maladies, le stade des diagnostics et les probabilités de survie. Ces facteurs devraient être pris en compte lors de la tarification des nouvelles polices, en particulier pour les garanties à long terme », précisent les auteurs du document.
Le risque de surdiagnostic
Ils mettent également en garde contre le surdiagnostic lié à l’utilisation accrue des biopsies liquides et d’autres tests génétiques qui identifient des affections qui pourraient ne jamais devenir symptomatiques ou entraîner une mort prématurée. En plus de conduire à des traitements inutiles, le surdiagnostic peut avoir un impact significatif sur l’expérience globale des portefeuilles des compagnies d’assurance.
Pour atténuer ces risques, ils recommandent de resserrer les définitions, de réduire la durée des produits d’assurance maladies graves à long terme ou d’offrir des primes non garanties.« Les récents progrès des technologies génomiques, des bases de données plus vastes et des algorithmes améliorés ont considérablement accru la précision des tests génétiques », ajoutent les chercheurs.
« Cette tendance pourrait intensifier l’exposition des assureurs vie et santé à la sélection adverse. »
La législation canadienne
La Loi sur la non-discrimination génétique, adoptée en 2017, interdit aux assureurs d’exiger un test génétique ou la divulgation de ses résultats en échange de biens ou de services. « Les contestations relatives à la constitutionnalité de cette loi ont été réglées en juillet 2020, et l’industrie continue de se conformer à la loi telle qu’elle est rédigée », indiquent les auteurs.
Avant l’adoption de la loi, en 2016, l’Institut canadien des actuaires avait mené sa propre recherche, suggérant que l’interdiction d’accès aux informations génétiques prédictives pourrait augmenter les coûts des réclamations en assurance vie de 12 % et ceux en assurance maladies graves de 26 %.