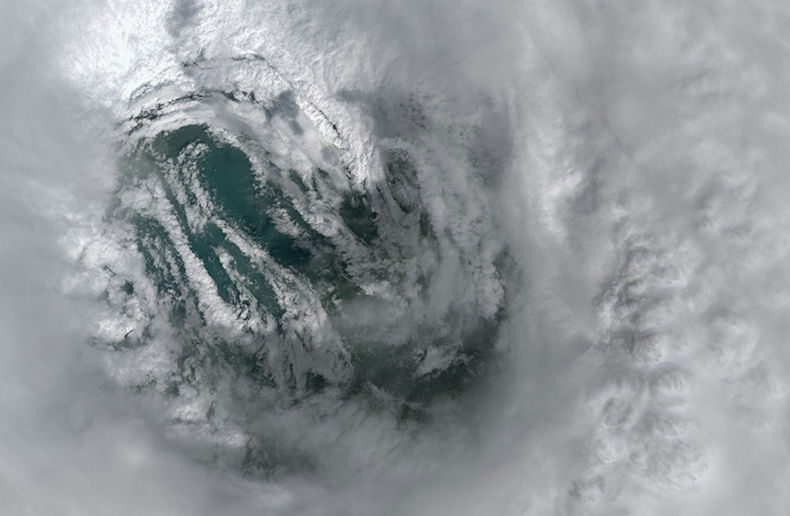En 2018, 27 % des consommateurs canadiens de cannabis disaient avoir au cours de la dernière année conduit leur véhicule dans les deux heures suivant la consommation de cannabis (fumé/vapoté) ou dans les quatre heures après en avoir ingéré. Cette proportion est maintenant de 18 %, selon Santé Canada.
Des études font toutefois état d’une hausse de la proportion des automobilistes qui, hospitalisés des suites d’un accident de la route, affichent des taux sanguins de tétrahydrocannabinol (THC) supérieurs aux limites légales permises.
« Après la légalisation du cannabis, la prévalence des conducteurs modérément blessés avec un niveau de THC d’au moins 2 ng/ml dans les centres de traumatologie participants en Colombie-Britannique a plus que doublé. L’augmentation a été la plus importante chez les conducteurs âgés et les hommes », établit une étude réalisée dans cette province de l’Ouest et publiée dans The New England Journal of Medecine en 2022.
En septembre 2023, une nouvelle étude révélait qu’en Ontario la légalisation du cannabis à des fins non médicales est associée à une augmentation de 94 % du nombre de visites aux urgences à la suite d’un accident de la route impliquant la consommation de cannabis par rapport à la période de huit ans précédant la légalisation. Une hausse de 223 % a été également été observée en Ontario entre les périodes 2010-2018 et 2020-2021, cette dernière coïncidant avec la phase de commercialisation du cannabis, lancée en mars 2020.
Si les effets de la pandémie de COVID-19 et de ses couvre-feux peuvent avoir influencé la conduite automobile, le Dr Daniel Myran, l’auteur principal de l’étude, met aussi en parallèle que le nombre de visites aux urgences suivant un accident impliquant l’alcool est resté stable dans la même période.
Mieux sensibiliser aux risques
« La hausse du nombre de blessures de la route impliquant la consommation de cannabis que nous avons constatée reflète une tendance plus large en matière de conduite avec facultés affaiblies par le cannabis », déclare le Dr Myran, qui, associé notamment à d’autres chercheurs d’Ottawa, a eu accès à 950 000 dossiers de patients hospitalisés aux urgences en Ontario entre 2010 et 2021.
Tout en se gardant bien de conclure à un lien direct de causalité entre consommation de THC et accidents routiers, l’urgentologue Éric Mercier, du CHU de Québec, appelle à une sensibilisation accrue des jeunes et des hommes quant aux risques de la conduite après avoir consommé du cannabis. « Malheureusement, une certaine banalisation existe », a déploré le Dr Mercier lors d’une intervention dans les médias. M. Mercier a notamment participé à une étude pancanadienne qui révélait le printemps dernier que la présence de THC a été détectée chez 18 % des 7000 accidentés de la route chez qui il a été possible de faire des analyses sanguines. Les données sur la conduite sous facultés affaiblies par le cannabis sont souvent présentées comme étant sans impact sur les accidents, déplore M. Mercier. Il estime essentiel de prendre conscience qu’on est très mauvais juge de son niveau d’intoxication et de ses capacités réelles à conduire un véhicule.
Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la probabilité d’être reconnu responsable de la collision est plus élevée chez les consommateurs de cannabis que chez les non-consommateurs.
Cet article est un Complément au magazine de l'édition d'octobre 2023 du Journal de l'assurance.