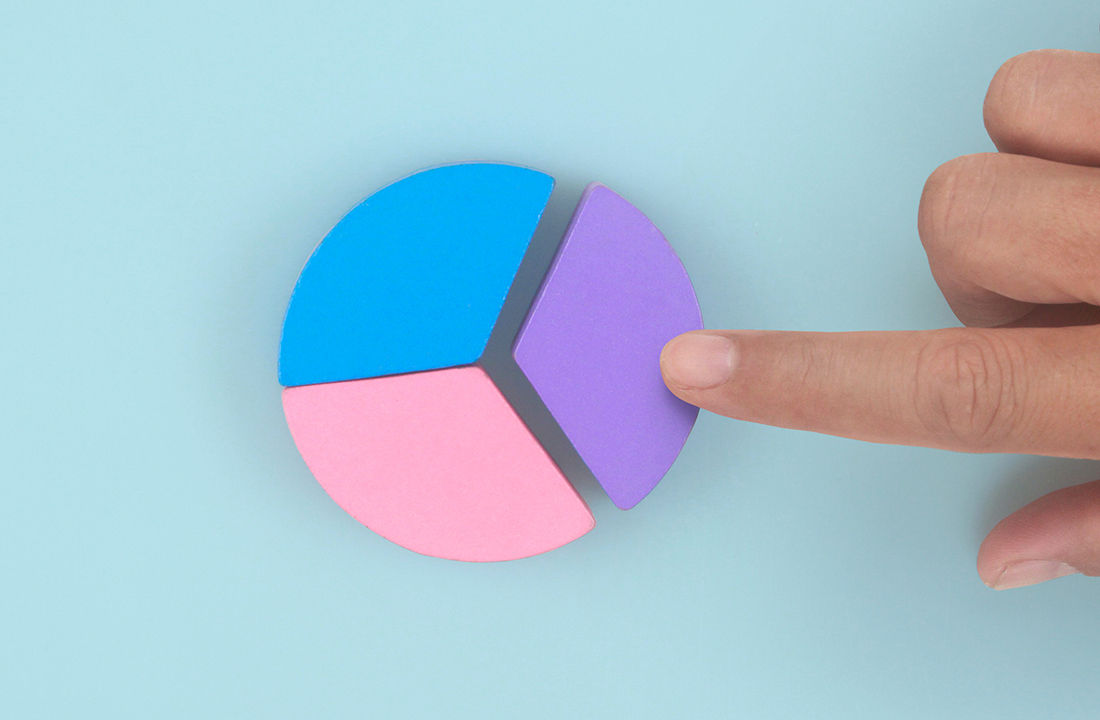Pas besoin d’être grabataire pour obtenir une indemnité d’assurance-prêt même si la condition est d’être totalement invalide, a statué la Cour des petites créances dans une cause qui a opposé un assuré à Desjardins Sécurité financière.
La Cour du Québec, division des petites créances, district de Terrebonne, a accordé au demandeur sa réclamation de 15 000 $. Si la cause avait été entendue par un tribunal régulier, le montant aurait pu atteindre 23 698 $. Le demandeur a diminué sa réclamation pour bénéficier d’une audience devant les petites créances.
Âgé de 52 ans au moment du jugement en septembre 2016, le demandeur est porteur depuis 2007 d’un diabète de type II, avec atteinte polyneuropathique affectant essentiellement les membres inférieurs. Il ne peut occuper d’emploi rémunérateur. Une tentative de retour au travail se solde par un échec. Le demandeur a adhéré à une assurance-prêt de type collective qui stipule que l’assuré ne peut être indemnisé que si sa maladie l’empêche d’exercer chacune des activités normales d’une personne du même âge. Dans sa défense, Desjardins avance que cette incapacité n’est que partielle, intermittente, et qu’elle ne répond pas à la définition de la police.
Se fondant sur la jurisprudence et une abondante preuve médicale, le juge Denis Lapierre voit les choses autrement. Dans son jugement, il indique qu’une invalidité totale signifie ne pouvoir occuper aucun emploi rémunérateur et non être incapable de quoi que ce soit.
Selon l’avocat spécialisé en droit de l’assurance, Maurice Charbonneau, de la firme Charbonneau avocats conseils, le juge n’a pas voulu se limiter à l’interprétation littérale de la définition d’invalidité totale prévue au contrat de l’assureur. Dans un bulletin destiné à sa clientèle, et dont le Journal de l’assurance a obtenu copie, il rapporte que le juge Lapierre a estimé plus prudent d’élargir cette analyse et de la confronter aux autres méthodes d’interprétation élaborées par la jurisprudence en matière d’assurance.
« Pour le juge, il est clair que la police est à la fois un contrat d’adhésion comme le définit le Code civil du Québec. En application de ce principe, il faudrait donc a priori préférer une interprétation favorable à l’assuré. Cette règle accompagne et complète la seconde, soit l’interprétation large de la couverture et restrictive de l’exclusion. Quant à la règle des attentes raisonnables de l’assuré, le tribunal ne peut pas se résoudre à considérer que le bénéfice de l’assurance ne sera acquis qu’en cas d’incapacité totale à exercer toute et chacune des activités non seulement rémunératrices, mais normales d’une personne », commente Me Charbonneau.
C’est l’utilisation du mot « normales » qui permet de mettre de côté la prétention de l’assureur pour adopter une interprétation qui donnera à la clause un effet conforme à la jurisprudence et aux attentes raisonnables d’un assuré, qui n’aura pas à être complètement grabataire pour bénéficier de l’assurance qu’il a contractée et dont il a payé les primes depuis sa délivrance, ajoute l’avocat. « Le qualificatif normales accolé au terme activités dans la police ne fait pas que référer à une description ou à une énumération. Les activités ainsi qualifiées doivent pouvoir être faites de façon normale en quantité, en qualité et en durée. Une personne qui ne peut exercer que quelques activités, sur de très courtes périodes de temps et d’une manière qu’affecte son état, n’exerce pas chacune des activités normales d’une personne de son âge, selon l’avocat. Ce n’est pas tant la capacité de faire la cuisine ou les courses qui importent que celle de générer un revenu permettant minimalement au demandeur de rembourser le prêt assuré. »
Preuve écrasante
La preuve médicale est écrasante : chaque intervenant, qu’il ait rencontré ou non le demandeur, estime que la condition du demandeur est limitante, invalidante ou incapacitante. Chacun reconnait que le demandeur est restreint dans ses activités. Seule la conception de la notion d’invalidité totale diffère d’un spécialiste à l’autre, tantôt en référence à la définition contenue au contrat, tantôt non. Mais un tribunal n’est jamais lié par l’opinion des médecins qui interprètent une clause contractuelle, a précisé Maurice Charbonneau. « Si l’on ajoute à la preuve médicale le témoignage du demandeur, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante conduit à la conclusion que le demandeur s’est acquitté de son fardeau de preuve et qu’il a démontré qu’il est invalide au sens de la police d’assurance », écrit-il.
Pour en arriver à sa décision, le juge Denis Lapierre s’est aussi appuyé sur la jurisprudence existante. Il a référé à un jugement de la Cour Suprême du Canada, qui a statué que l’on ne doit pas utiliser le sens littéral lorsque cela entrainerait un résultat irréaliste ou qui ne serait pas envisagé dans le climat commercial dans lequel l’assurance a été contractée.
« Lorsque des mots sont susceptibles de deux interprétations, la plus raisonnable, celle qui assure un résultat équitable, doit certainement être choisie comme l’interprétation qui traduit l’intention des parties. On doit éviter une interprétation d’une clause contractuelle ambiguë qui rendrait futile l’effort déployé par l’assuré pour obtenir la protection d’une assurance », a statué le plus haut tribunal du pays. Le juge Lapierre a pour sa part ajouté dans sa décision que les tribunaux doivent se montrer réticents à appuyer une interprétation qui permettrait à l’assureur de toucher une prime sans risque.