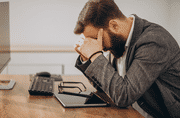La Ville de Montréal et la compagnie d’assurance Aviva ne semblent pas faites pour s’entendre. Elles peinent même à convenir des délais à respecter dans la mésentente qui les oppose depuis juillet 2018.
À l’issue du premier jugement dans ce litige, publié le 24 octobre 2019, une ordonnance de convenir d’un protocole d’ici le lendemain (25 octobre) avait été prononcée. Le 27 juillet 2021, un jugement a officialisé la présomption qu’Aviva s’était désistée. La question qui a amené les parties à croiser le verbe en audience pour la quatrième fois ne porte donc pas encore sur les millions de dollars (M$) que l’une et l’autre se réclament. Ce jugement d’appel, publié, le 30 mai 2023, est plutôt venu statuer sur la décision précédente.
Alors, sur quels éléments les juges Gagnon, Mainville et Hamilton ont-ils appuyé leur conviction qu’Aviva, qui n’avait toujours pas achevé de régler sa preuve, presque deux ans plus tard, persistait toujours dans son intention de régler la cause?
Manœuvres dolosives d’un assuré
Pour le comprendre, il faut remonter à l’époque de 2000 à 2018 où Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. recevaient de nombreux contrats de la Ville. En début 2014 une convention d’indemnisation vient lier l’entrepreneur à la compagnie d’assurance Aviva. Les affaires de l’entrepreneur allant de plus en plus mal, Aviva s’approprie l’entreprise de construction au moment de sa faillite et, le 18 juin, envoie un avis de retrait à la Ville pour recevoir les 4M$ dus à Jeskar.
Après un premier paiement en juin, la Ville annonce qu’elle cessera les paiements parce qu’elle tient Jeskar et son président responsables de « manœuvres dolosives à son égard » selon la Loi 26, adoptée dans le cadre de la lutte contre la corruption dans les contrats publics.
La Ville annonce prévoir de retenir les montants en vue d’une éventuelle poursuite. Aviva intente alors, en Chambre commerciale, sa poursuite pour les sommes dues, avec 1M$ en dommages compensatoires et un autre en dommages punitifs pour ces arrêts de paiement.
La Cour supérieure est-elle convenable?
Le 24 octobre 2019, les représentants de la Ville viennent soumettre une demande à la Chambre commerciale de la Cour supérieure pour que leur cause soit transférée à la Cour Civile. Ceux-ci soutiennent que la Chambre commerciale n’a pas la compétence pour juger de cette cause complexe, puisqu’elle serait gérée de façon qu’elle qualifie « d’expéditive ».
Par ailleurs, les procureurs de la Ville soulignent que les débats à venir ne statueront pas sur la faillite elle-même, mais sur les poursuites civiles qui en découlent. Cet argument n’ébranlera en rien la conviction du juge Michel A. Pinsonnault selon qui les sommes dues à l’acquéreur relèvent de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Qui plus est, le juge soutient qu’une décision pour statuer sur une requête associée à la Loi 26 s’inclut tout à fait dans la définition de « toute autre instance de nature commerciale » de l’article 209 c des Directives de la Cour supérieure pour le district de Montréal. Il concède néanmoins à la Ville que la complexité du cas requiert un protocole écrit.
Des retards qui s’accumulent
Ce protocole est présenté par les parties et entériné par le juge Martin Castonguay, le 2 décembre 2019. La Ville demandera alors de prolonger le temps accordé pour en réaliser les démarches jusqu’au 15 décembre 2021, ce qui lui est accordé. Aviva, elle, ne réclame pas de prolongation.
Plusieurs mésententes embourbent toutefois l’application du protocole au point où, le 15 janvier 2020, le juge Pinsonneault décide d’intervenir, par un nouveau jugement, afin d’y préciser l’ordre des démarches attendues. Comme toutes ces étapes dépendent des précédentes, il impose un délai de 30 jours pour l’examen de la preuve par la défense, mais indique que l’ensemble des étapes devra être achevé « sine die », ce qui signifie « sans date déterminée ».
Il invite aussi les parties à communiquer avec lui directement, par courriel s’il le faut, afin de régler les obstacles qu’ielles rencontrent. L’une et l’autre feront d’ailleurs appel au juge dans leurs différends subséquents, avant qu’un verdict de présomption de désistement, réclamé par la Ville, ne soit posé.
Pour la prescription, allez à l’article 177
Le juge Gary D.D. Morrison est donc venu appliquer les articles 173 et 177 du Code de procédure civile, selon lesquels le demandeur doit avoir rassemblé et rendu un dossier complet avant la date dite « de prescription » : six mois après le dépôt du protocole. S’il ne le fait pas, la présomption de désistement s’impose d’elle-même, à moins qu’une impossibilité d’agir soit démontrée.
Les juges en appel se réfèrent cependant aux Directives de la Cour supérieure pour le district de Montréal pour nuancer cet impératif. Son article 215.3 précise en effet qu’à la Chambre commerciale, seul un recours en oppression, c’est-à-dire une accusation de faire appel à un pouvoir abusif pour obtenir gain de cause, oblige d’emblée l’utilisation d’un protocole. Il ne peut en être question dans ce litige, trancheront les juges.
Il n’en demeure pas moins qu’un protocole avait été demandé par le juge Pinsonnault et que les correspondances entre les parties ont démontré, au moins au début, leur souci de respecter certaines échéances. Quant à savoir si, pour ce juge, exiger un protocole écrit correspondait à imposer des dates précises pour le réaliser, rien n’est moins certain, à l’avis des trois juges de l’appel.
« Sine die », disait le juge…
Ceux-ci évoquent la mention « Sine die », par le juge Pinsonnault, mais ne s’y limitent pas. Ils ajoutent que ce dernier n’a pas prononcé « expressément » l’obligation de respecter des délais, malgré le prolongement des procédures. Il a plutôt proposé un soutien plus informel. Les juges de l’appel mentionnent au passage que la Ville elle-même a déjà demandé, et s’est vu accorder, un délai allant bien au-delà de 6 mois dans cette affaire.
Ils concluront en ajoutant que ce jugement, quoique n’étant pas de la plus grande précision, demeurait alors assez cohérent avec les pratiques de la cour en affaires commerciales. Dans ce milieu, expliquent les juges de l’appel, les multitudes de contraintes rendent le respect des délais pratiquement inapplicable et obligent souvent à renoncer à la rigidité de l’application des délais de mise en matière civile.
Ils emploieront plus précisément les termes « unmanageable and impractical» dans leur annonce de l’annulation de désistement, puisque, mis à part ses quelques termes latins, c’est en anglais que ce jugement sans frais judiciaires a été prononcé.