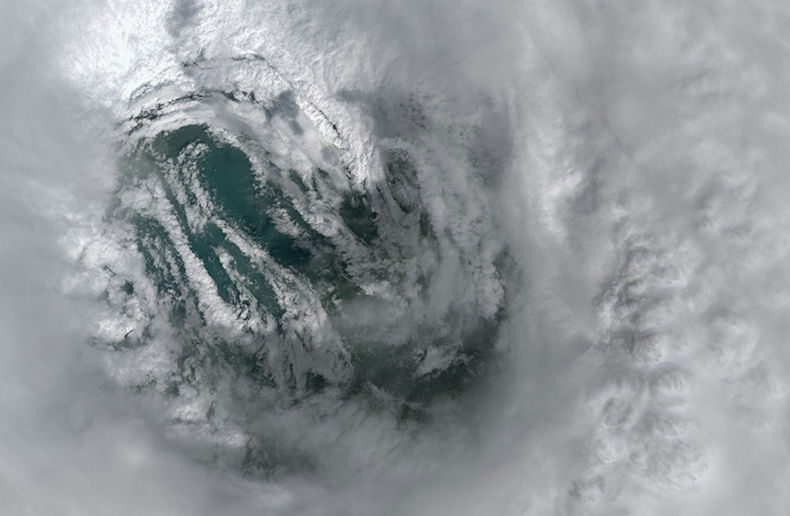Dès le 23 novembre dernier, Bonnie Martin, représentante au développement des affaires chez Intergroupe, écrivait au Journal de l’assurance pour exprimer son opposition au projet de loi no 96 modifiant la Charte de la langue française.
Lors d’un entretien avec Bonnie Martin, réalisé en décembre, le président d’Intergroupe, Bernard Laporte, participait à la conversation, à la demande de Mme Martin.
Bonnie Martin explique : « Le contrat doit être rédigé en français, et si les parties le souhaitent, ils peuvent en accepter la version anglaise. Et l’assurance, ce sont des contrats. C’est notre vie, littéralement. Et le mot à mot est très important. Dès qu’on parle de contrat, on doit être capable de prendre nos propres décisions de manière autonome. ».
Elle fait part des difficultés des courtiers à trouver une police même « pour de beaux dossiers où il n’y a jamais eu de réclamations, le client fidèle au même assureur depuis 20 ans. Parfois, on est en magasinage et on ne trouve pas de marché », précise-t-elle.
Selon Bernard Laporte, il arrive souvent que l’assureur décide de ne plus couvrir un risque particulier, ce qui force le courtier à sonder le marché. « Nous sommes contraints d’aider le client à trouver une autre capacité, et c’est le gros problème. Dans tous les pays multilingues, il y a des limitations importantes et des surcoûts importants », constate Bernard Laporte.
Le mot à mot est normalement assez standard pour les grands risques classiques, et les souscripteurs à Londres les ont traduits. Mais pour les risques spécialisés, comme c’est le cas pour beaucoup de polices en assurance des entreprises, la police ne sera pas traduite. « La police va coûter plus cher. C’est là où l’on doit dire à nos clients d’accepter le texte en anglais, et en général, c’est oui », indique M. Laporte.
Les assureurs étrangers ne vont pas traduire la police pour un seul risque, poursuit Bernard Laporte. « Ils ne vont pas traduire trois pages d’un mot à mot très technique, pour ensuite le faire analyser par des spécialistes du droit, ça va coûter une fortune pour une seule police. »
« On a aussi des courtiers qui sont eux-mêmes anglophones et dont les clients sont anglophones, il faut qu’on leur donne des polices en anglais. On est déjà limités par le nombre d’assureurs et c’est une contrainte de plus », souligne le président d’Intergroupe.
Bonnie Martin raconte le cas d’un contrat qu’elle vient de renouveler avec l’assureur AIG. « C’est la filiale américaine qui a dû prendre la relève, car les spécialités sont là. La rédaction du contrat a été faite manuellement, car c’était un risque très particulier. Alors, leur demander de le rédiger en français qui sera la bonne version, pour un seul client? C’était déjà difficile d’obtenir cette garantie », raconte Bonnie Martin.
Même si l’assureur accepte d’en fournir une version française, le libellé précise qu’en cas de litige, le texte original (en anglais) a préséance. « Le souscripteur rédige son libellé en fonction du risque qu’il perçoit. Si son intention concerne quelque chose de très spécifique, il faut vraiment que ça soit appliqué en loi, pas pour nuire à l’assuré, mais pour que l’assureur soit capable de tarifer le risque en conséquence et de conserver sa rentabilité », ajoute-t-elle
Risque de fermeture
« Le travail du courtier est de bien conseiller son client et d’expliquer la police, les limitations, mais en fin de compte, on est pris avec l’offre qu’on a. Ce n’est pas comme si le client se retrouve dans la situation où il a moins de couvertures que ce qu’il pensait avoir. C’est vraiment une question de pouvoir l’assurer et lui permettre de continuer ses activités », explique Bonnie Martin.
Selon elle, des compagnies ont dû fermer ou ont été forcées de ralentir leur développement à cause d’un renouvellement de police qui tardait ou d’une hausse trop importante de leurs primes. « Ce n’est pas comme si on avait beaucoup d’options avec des assureurs locaux », dit-elle.
Le PL-96 « change la façon dont on aborde les contrats et les services juridiques, les liens contractuels, les relations entre les entreprises et le gouvernement », insiste Colin Standish, président du Comité spécial sur la politique linguistique. La compréhension des contrats sera diminuée par les changements proposés, selon lui.
« Je dirais que, dans 95 % des cas, les polices sont en français et on peut les fournir. On peut aussi les fournir pour de grands risques connus en lignes personnelles et en lignes commerciales, on peut les fournir en anglais et en français. Mais dès qu’on arrive sur des polices un peu plus délicates, un peu plus précises, ça va être plus compliqué », indique Bernard Laporte.
Les réclamations
Les litiges sur l’interprétation de la police surviennent à la suite d’une réclamation découlant d’un sinistre. « J’ai déjà vu une situation où quelqu’un m’a demandé d’annuler une des protections prévues au contrat. Au moment de la réclamation, il a regretté puis il a nié avoir demandé l’annulation de la protection. Rendu là, il fallait faire la preuve que le client avait accepté le contrat », explique Bonnie Martin.
Pour certains segments, comme l’assurance qui couvre les restaurateurs ou les couvreurs, il y a fort peu de concurrence et encore moins d’assureurs locaux, selon Mme Martin.
Bernard Laporte confirme le potentiel d’augmentation des litiges à l’étape des réclamations. « Quelqu’un qui est anglophone à qui l’on soumet une police en français, il pourra dire : “Je n’ai pas compris que c’était ça, la police d’assurance. Je pensais que j’étais couvert pour tel ou tel sujet. Vous ne m’avez pas donné la possibilité de comprendre le contrat dans ma langue.” Aussi bien dire aux non-francophones qu’ils n’ont plus le droit de mettre les pieds au Québec », dit-il.
Pouvoirs d’inspection
Mme Martin milite également au sein du Comité spécial sur la politique linguistique aux côtés de Colin Standish. Les deux se disent particulièrement inquiets du renforcement des pouvoirs des inspecteurs de l’OQLF. Le PL-96 accorde des pouvoirs aux inspecteurs de l’Office en matière de perquisition et de saisie.
Les articles 166 à 177 de la Charte ont été réécrits. Le titre est évocateur : « Plaintes, dénonciations, mesures de protection, inspections, enquêtes et mesures de redressement. »
L’article 107 du projet de loi 96 insère un nouveau chapitre en ajoutant de nouvelles dispositions touchant les plaintes, les dénonciations et les mesures de protection. Sept nouvelles dispositions touchant les plaintes deviendront les articles 165.15 à 165.21 de la Charte.
Concernant les inspections et les enquêtes, l’article 174 permettait déjà à l’inspecteur de l’Office d’accéder à tout lieu accessible au public durant les heures d’ouverture, d’examiner tout produit ou tout document et de tirer des copies, en plus d’exiger tout renseignement pertinent.
Le projet de loi 96 prévoit que l’inspecteur pourra prendre des photos de l’établissement. Le troisième alinéa précise que la personne qui fait l’inspection peut « faire utiliser par toute personne présente qui y a accès tout ordinateur, tout matériel ou tout autre équipement se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données ».
Le dernier paragraphe du nouvel article 174 prévoit que « toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une inspection et lui en faciliter l’examen ».