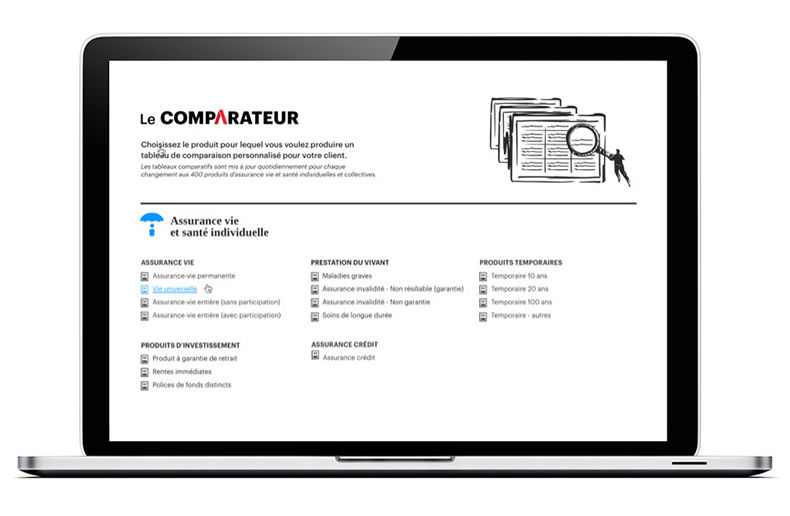Un nouveau rapport de l’Institut C.D. Howe met en lumière deux constats : d’une part, les Canadiens aux revenus modestes ont difficilement accès à des conseils financiers, et d’autre part, l’accumulation de règlements sans véritable analyse de ses retombées pourrait aggraver cette tendance.
« La faible participation financière des ménages a des répercussions économiques plus larges : la faible résilience financière des ménages, la réduction de l'épargne nationale et la diminution de la formation de capital freinent la croissance économique et la productivité au Canada », affirme Gary Edwards, cofondateur et associé principal chez Golfdale Consulting, dans la publication (en anglais) intitulée Regulatory Reset: A Policy Roadmap for Expanding Financial Advice to Middle and Lower Income Canadians.
Ce document analyse le lien entre une réglementation cumulative et non coordonnée et l’élargissement du fossé en matière de conseils financiers au pays.
« Dans de nombreux champs de compétence qui se chevauchent, les réglementations, en particulier dans le secteur des services financiers, continuent de se multiplier à un rythme tel que les coûts deviennent disproportionnés par rapport aux gains, ce qui a un effet néfaste sur la croissance économique et la productivité », écrit-il.
Une offre de conseils fragmentée
Le rapport détaille le manque d’accès aux conseils financiers pour les ménages disposant de peu d’actifs à investir. S’appuyant sur des recherches menées pour le compte de Primerica Canada sur les expériences des Canadiens à revenu modeste ou moyen, M. Edwards note une tendance claire : « J’ai constaté un mode de prestation fragmenté des conseils financiers, particulièrement auprès des ménages détenant peu d’actifs. ». « Les résultats suggèrent que même si des conseils existent, ils ne parviennent pas aux Canadiens de manière équitable ou cohérente », poursuit-il.
Sur le plan réglementaire, M. Edwards examine plusieurs autres juridictions et constate que le Canada n’a toujours pas évalué de manière adéquate l’impact cumulatif de ses réglementations financières. Le rapport recense plus de vingt-cinq autorités de réglementation des services financiers à travers le pays. Et même si certaines ont adopté des lignes directrices fondées sur des principes visant à offrir une certaine souplesse, l’auteur souligne que ces approches peuvent engendrer des obligations de conformité cumulatives malgré tout, « particulièrement lorsqu’elles se superposent à de multiples régimes et cadres réglementaires », écrit-il.
Éliminer les obstacles à l’innovation
« Bien que les Canadiens aient historiquement bénéficié d’un meilleur accès aux conseils financiers que leurs homologues du Royaume-Uni et de l’Australie, où des excès réglementaires ont entraîné l’effondrement des services de conseil destinés aux clientèles intermédiaires, le Canada n’échappe pas à cette tendance », note M. Edwards. « Une révision systémique, fondée sur des données probantes, de l’ensemble de la réglementation financière, axée sur l’élimination des exigences désuètes ou redondantes et des obstacles à l’innovation et à l’accessibilité, pourrait aider le Canada à inverser cette tendance et à améliorer l’accès aux conseils pour tous les niveaux de revenu. »
Le rapport recommande que des analyses coûts-bénéfices soient menées lors de l’introduction de nouvelles règles ; celles-ci n'ont généralement pas lieu ou ne sont pas publiées dans le cas contraire, d’après l’auteur.
Dans son papier, l'Institut C.D. Howe suggère également que le Canada adopte de meilleures pratiques internationales en matière de réglementation, notamment par le recours à des examens par les pairs structurés, un contrôle parlementaire et des comités interorganismes. « Cette approche rigoureuse et fondée sur des données probantes devrait s’appliquer non seulement aux lois et règlements officiels, mais aussi aux règles d’autoréglementation et même aux lignes directrices non contraignantes », indique l’auteur.
Le rapport insiste : « Il faut une définition claire et fondée sur les données des problèmes que visent à résoudre les règlements, y compris les préjudices mesurables pour les consommateurs et l'impact sur l'industrie. Il ne suffit plus, à l’ère des données, d’invoquer des préoccupations générales comme les conflits d’intérêts ou un préjudice potentiel perçu. Toute nouvelle règle, interdiction ou obligation de conformité devrait être introduite selon une méthode fondée sur des preuves, et non sur une intuition ou une préférence pour un certain modèle d’affaires. »