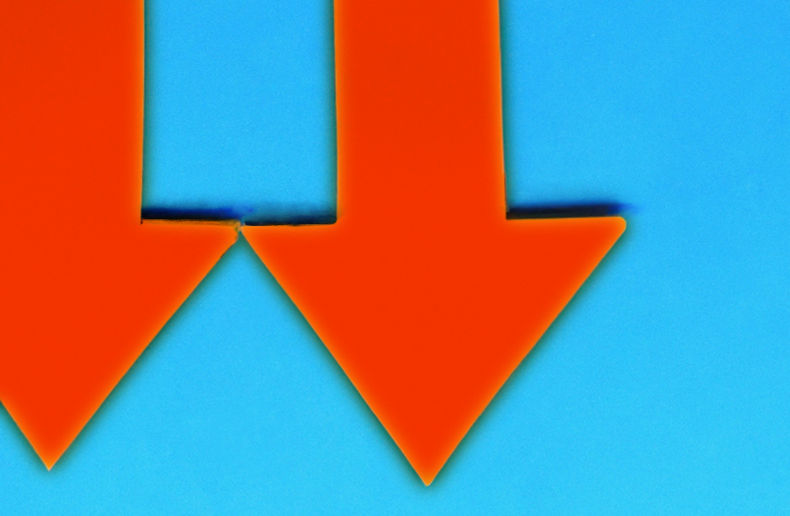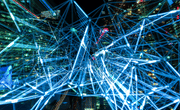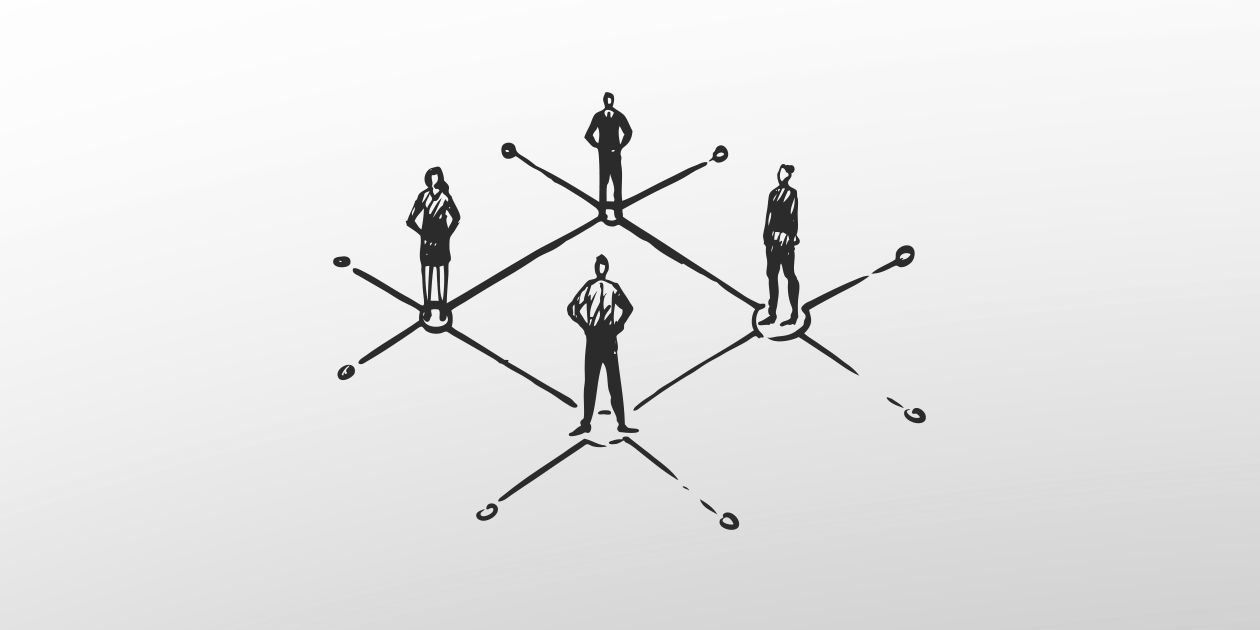D’après le raisonnement du juge Éric Dufour, de la chambre civile de la Cour Supérieure du Québec, on peut déclarer vacant un immeuble ayant été reconnu occupé par un précédent juge, pour la même période, sans qu’il n’y ait là ni contradiction ni remise en question du précédent jugement.
Dans l’argumentaire de son jugement, déposé le 15 mai 2023, dans la cause 9191-3004 Québec Inc. c. Aviva, compagnie d’assurance du Canada, le juge Dufour reprend l’expression de la jurisprudence « Vide du côté usage » pour désigner cette situation où les habitants des lieux et le propriétaire (qui a souscrit de l’assurance chez Aviva) ne se trouvaient liés ni par un bail ni par une promesse de vente réciproque.
Le juge donne ainsi raison à Aviva, quant à son refus d’accéder à la demande de réclamation, pour des réparations effectuées sur un immeuble résidentiel de Repentigny, appartenant à la 9191-3004 Québec Inc.
Des habitants fantômes
Pour justifier son refus, Aviva a plaidé que Micheline Fortin, présidente et unique actionnaire de la compagnie, ne serait pas retournée dans son immeuble de Repentigny, entre le 17 septembre 2014 (ou peut-être le 15 ou le 16) et le 12 novembre 2014. Elle n’aurait d’ailleurs jamais prétendu vouloir y habiter. Cette absence de fréquentation ouvre alors la porte à l’application de la clause 24 de son contrat, qui vise à exclure les bâtiments d’habitation vacants depuis plus de 30 jours consécutifs.
Pourtant, il est démontré que le jour de la constatation du sinistre, le logement était bel et bien occupé par trois convives. De même, il est établi que Madame Fortin connaissait au moins l’un d’entre eux, Maxime Myrtil, pour lui avoir remis en main propre, le 19 septembre 2014, les clés du lieu, ainsi qu’un formulaire de promesse d’achat de l’Organisme d’autoréglementation de courtage immobilier du Québec (OACIQ), qu’elle a rempli et signé du côté du vendeur.
Ce formulaire de l’OACIQ, qui désignait deux acheteuses, dont une dénommée Rosette Simon, et monsieur Myrtil comme intermédiaire, ne fut toutefois jamais cosigné par les acheteuses désignées. Madame Fortin raconte au procès que, devant les explications de moins en moins convaincantes de Maxime Myrtil, elle décide de se rendre à l’immeuble de Repentigny, le 12 novembre 2014. Elle découvre que la serrure a été changée, que des travaux majeurs ont été entrepris et que Maxime Myrtil habite dans le logement avec un couple, Michella et Richard Joseph.
Les policiers, appelés sur place, n’osent pas intervenir, puisque Maxime Myrtil proclame leur droit d’y habiter. Micheline Fortin réclamera alors leur éviction devant la cour. Lors de ce premier procès, du 12 décembre 2014, Myrtil prétend y mandater des travaux de construction. Mais le déroulement du procès révèle qu’il y cohabite et qu’il cohabitait avec le couple Joseph même avant de se loger dans cet immeuble de Repentigny.
Le juge en conclura, le jour même, que le contrat, rempli unilatéralement, « a mystifié les policiers, mais pas le Tribunal ». Il ordonnera aux résidents de quitter les lieux « avec tous leurs effets personnels, ainsi que les meubles et effets mobiliers leur appartenant » dans les 72 heures.
L’ouvrage d’un ouragan
Les policiers appelés sur les lieux, le 12 novembre 2014, puis appelés à témoigner, le 12 décembre de cette même année, parleront de lieux qui auraient semblé avoir subi le « passage d’un ouragan ». Plus de huit ans plus tard, dans son jugement du 15 mai, le juge Éric Dufour empruntera plutôt l’image d’un « lendemain de tornade », pour résumer l’ampleur du désastre révélé par les photos sur lesquelles porte la demande d’indemnisation. Il le décrira aussi par « des débris de construction éparpillés, des murs abattus, des meubles décatis qui gisent çà et là, des déchets qui jonchent le sol ».
Rien ne prouve que ces réparations ayant causé des dommages réclamés à Aviva le 19 décembre 2014, à hauteur de 133 473,70 $, ont été réalisées à la demande de Micheline Fortin. Sans même chercher à contester la valeur ou l’état du sinistre, Me Éric P. Masse, procureur pour Aviva, se concentrera sur la clause d’exclusion pour une habitation vacante.
Mais Me James Leinhos, procureur de la demanderesse, plaidera que Micheline Fortin n’occupait pas sa maison, mais tentait activement de la vendre. En conséquence, il affirme que son inoccupation temporaire ne pouvait pas être assimilée à un abandon.
Un défi : définir le vide
Mais la définition de la vacance qu’a incluse Aviva dans son contrat d’assurance n’implique pas forcément cet élément d’abandon, puisqu’elle se lit ainsi : « l’état d’un bâtiment d’habitation, vide ou non de son contenu, dont tous les occupants sont partis sans intention de revenir y habiter, ainsi que celui de tout bâtiment d’habitation nouvellement construit entre la fin des travaux et le moment où les occupants y emménagent. »
Le juge Dufour tranchera que les clauses d’exclusion des polices doivent être interprétées au sens strict. Il retiendra néanmoins de la proposition du procureur d’Aviva d’autres aspects de la définition de la « vacance » qui apparaissent dans la jurisprudence, mais non dans ce contrat d’assurance. Dans d’autres causes, en effet, un immeuble a été conclu vacant lorsqu’il ne pouvait être « ni loué, ni vendu, ni habité ». Un lien direct était alors établi entre ces critères et la définition de n’« être utilisé à aucune fin » et donc « vide d’usage ».
Le juge rappelle également qu’au moment où la dernière locataire en bonne et due forme l’avait quitté, l’appartement était bel et bien vide, même de contenu matériel.
Par la suite, l’usage résidentiel illégitime du bâtiment, pas plus que les négociations pour l’achat ou l’impossibilité de parler d’une fin des travaux ne sont parvenus à combler ce vide, dans l’esprit du législateur.
Il revient donc à la compagnie demanderesse de payer les frais de justice, en plus des travaux qu’elle ne pourra jamais réclamer.