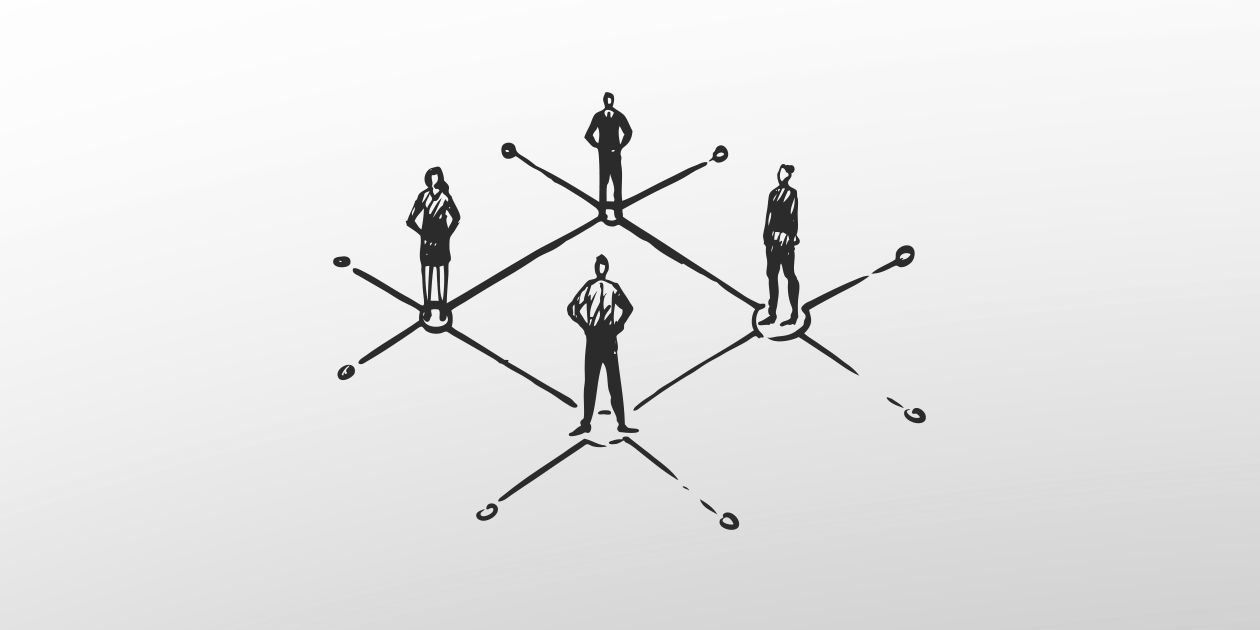Plusieurs villes ou municipalités québécoises menacées par les inondations provoquées par les changements climatiques ont comme réflexe de vouloir ériger des digues pour protéger leurs populations, les résidences et leurs infrastructures. Mais ces ouvrages peuvent offrir un faux sentiment de sécurité à leurs résidents.
Quand elles cèdent, les dégâts causés par les quantités colossales d’eaux qui s’engouffrent dans les rues et les résidences peuvent être plus considérables que ne l’aurait fait une montée passagère des eaux, comme l’a démontré le cas de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Dans la soirée du 27 avril 2019, la digue qui retenait les eaux du lac des Deux Montagnes a soudainement flanché dans un secteur et créé une brèche géante dans laquelle l’eau s’est précipitée pour envahir tout un quartier de la municipalité devant des citoyens médusés qui se croyaient à l’abri. Au final, le tiers de la municipalité a été inondée, une catastrophe sans précédent.
Cette rupture a forcé l’évacuation de 6000 personnes et inondé 2500 propriétés. Dans les jours qui ont suivi, TVA a estimé en se basant sur un site d’estimation immobilière que la valeur des propriétés affectées atteignait au total 600 millions de dollars.
Six mois après ce drame, les signes de ce déferlement d’eau sont aussi visibles sur le terrain qu’auprès des sinistrés eux-mêmes. Les impacts psychosociaux sont énormes, ont rapporté des médias : détresse psychologique, chocs post-traumatiques, dépression, divorces, pensées suicidaires, difficultés financières.
Certains résidents ont évoqué des suicides dans leur entourage. Le site consacré aux sinistrés développé par la ville de 18 000 personnes comporte d’ailleurs une référence pour un Centre de prévention du suicide.
L’éclatement de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et ses dommages ont entrainé l’un de plus vastes déploiements d’intervenants psychosociaux jamais vus au Québec. Des dizaines de maisons seront démolies, mais en octobre, des gens encore anéantis n’en pouvaient plus d’attendre l’aide promise par Québec alors que revenait la saison hivernale.
Le 15 novembre, le gouvernement a annoncé une aide additionnelle de 17 millions de dollars destinés à 1 400 sinistrés de la municipalité. Ce montant a été jugé insuffisant pour nombre d’entre eux, car ils ne récupéreront jamais la totalité de leurs valeurs perdues lors des inondations alors qu’ils se croyaient en sécurité derrière une digue.

Source : ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Pas la solution miracle
Une digue n’offre pas le niveau de protection d’un grand barrage. Elle peut donner un sentiment de protection artificiel aux populations.
Québec a autorisé Sainte-Marthe-sur-le-Lac à réparer et à solidifier sa digue actuelle afin d’éviter que des milliers de personnes ne soient délocalisées. Elle sera renforcée et rehaussée à un niveau tel, selon sa mairesse Sonia Paulus, qu’elle devrait être assez résistante pour faire face aux changements climatiques pour les 100 prochaines années.
L’avenir démontrera si madame Paulus avait raison ou avait tort sur l’efficacité et la solidité de sa nouvelle digue, mais même si le gouvernement a donné le feu vert à cette réfection, il admet que les digues ne représentent pas une solution efficace contre les changements climatiques.
Tout en soulignant que la reconstruction était la chose à faire dans le cas de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette, a déclaré lors de l’épisode du printemps 2019 que la réparation ou la construction de digues ne représentait pas la solution pour toutes les municipalités qui craignent les débordements de lacs et de rivières susceptibles de provoquer de fortes inondations ces prochaines années.
Même constat pour Alain Bourque, un scientifique qui se penche sur les changements climatiques depuis 25 ans et directeur général de l’organisme Ouranos. Pour lui, les digues ne forment pas une solution, a-t-il affirmé aux participants du Forum sur les inondations, tenu en novembre.
C’est pourtant la voie choisie par de nombreuses villes…
Deux-Montagnes, qui a vu un de ses quartiers inondés en avril 2017 même si elle n’avait aucun historique en la matière, a échappé à une nouvelle grande inondation en 2019 grâce à une digue temporaire. Elle est en voie de construire une digue permanente qui, espère-t-elle, la mettra à l’abri d’autres grandes crues dans le futur.
Selon une autre experte, Geneviève Cloutier, professeur à l’Université Laval et membre du Centre de recherche en aménagement et développement, les digues existantes sont essentielles. Encore faut-il qu’elles soient convenablement entretenues…
À Sainte-Marthe-sur-le-Lac la digue avait déjà été réparée à deux reprises et la municipalité attendait une subvention majeure pour la solidifier. L’argent n’est pas arrivé assez tôt et le mal est déjà fait pour des milliers de sinistrés.
Le Japon champion des digues… 42 ont lâchées en 2019…
Si pour plusieurs municipalités, les digues représentent une solution facile, Alain Bourque a peut-être refroidi les attentes de certains maires en indiquant à son auditoire que le Japon était le champion des digues, mais que l’an dernier, 42 avaient lâché. Le Québec l’a vécu à son tour en 2019 et en a pleinement réalisé les conséquences dramatiques à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Une digue crée-t-elle un faux sentiment de sécurité ? « Tout à fait, affirme M. Bourque, surtout dans un contexte où les gens ne sont pas informés qu’il a y a toujours une possibilité qu’une digue cède. Si les gens étaient mieux informés, j’aurais beaucoup moins de problèmes, mais là, ils l’ignorent. Des personnes ne savent pas qu’elles sont installées dans le fond d’un lac. Elles ne le sont pas à cause d’une digue, mais elles se trouvent quand même dans le fond d’un lac ».
Selon lui, on sort d’une ère où le génie a réalisé beaucoup d’ouvrages alors que le climat était stable. Maintenant qu’il devient instable, ces anciennes solutions peuvent devenir problématiques, car elles ont été conçues pour des périodes de 50 à 100 ans et elles n’ont pas de flexibilité pour gérer les risques qui changent avec le temps.
Alain Bourque croit que la première leçon que nous donne le cas de Sainte-Marthe-sur-le-Lac c’est d’éviter les digues pour tous les nouveaux développements.
« Il n’y a pas de raisons de se créer du risque, surtout de grande ampleur. On réduit le risque de moyenne envergure, mais on amplifie celui de grande envergure. »
Deuxième leçon, c’est la transition. Comment transiter d’un monde qui comptait sur les digues vers un monde qui va moins compter sur elles sans trop avoir d’impacts sur les populations ?
« Il y a des gens qui ont acheté des maisons dans des zones protégées par des digues et qui ignoraient qu’il y avait risque. Il est tout à fait légitime qu’ils disent : “Moi, j’ai tout fait dans les règles de l’art, pourquoi serais-je pénalisé ?” C’est un défi de transition. Il faudra que tout le monde s’assoie autour d’une même table et discute de la manière d’y faire face ».
D’autres options
Alors, si les digues ne représentent pas le remède miracle à la montée des eaux, vers quels moyens les municipalités doivent-elles se tourner pour assurer la protection de leurs citoyens et de leurs infrastructures face aux inondations ?
Agir uniquement sur les zones inondables ne sera pas suffisant non plus, selon les spécialistes. Il faut plutôt agir en amont.
« Il est important d’avoir des moyens d’adaptation flexibles. Il y a rarement une solution miracle pour contrer les inondations, mais une foule de pistes », dit Alain Bourque.
L’UMQ évoque des bassins versants, de la renaturalisation ou encore des ouvrages de protection. Il faudra aussi réfléchir à réintégrer la nature, voire des rivières dans des villes, comme on l’a fait en Europe…