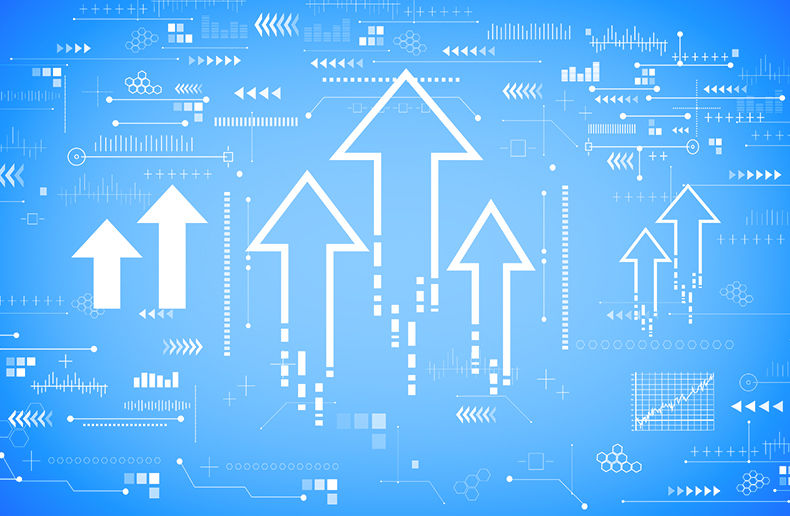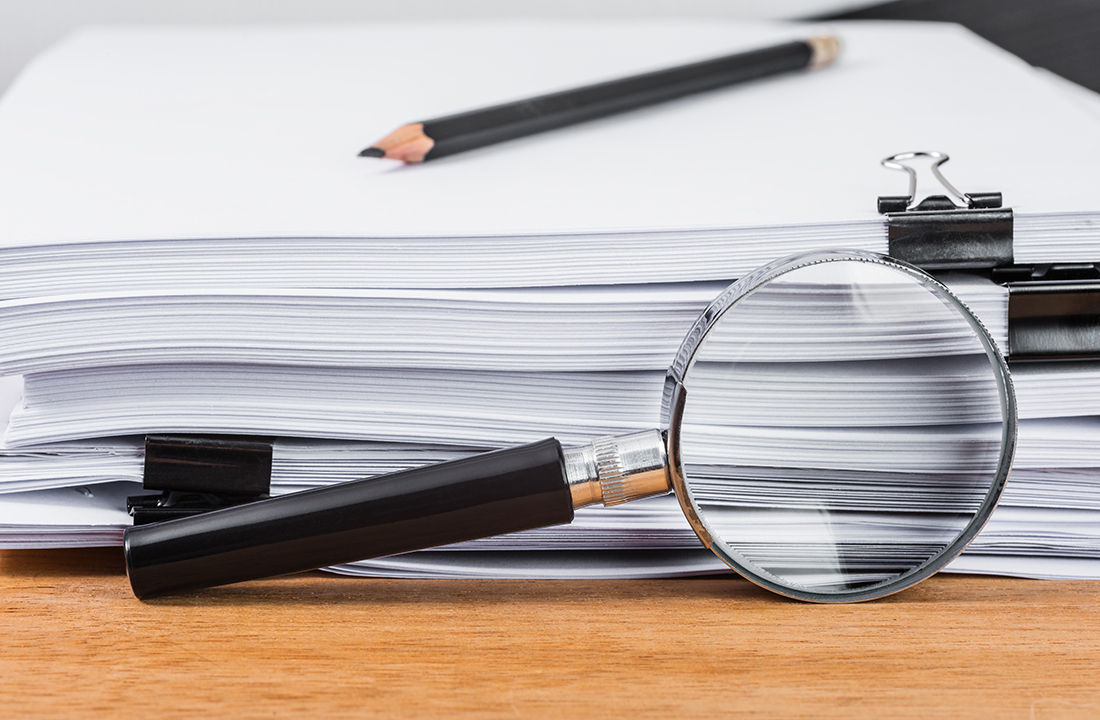Un projet de recherche mené en actuariat à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a obtenu le feu vert des organismes subventionnaires. La Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels (CARA) a obtenu une subvention de 850 000 $ pour son projet intitulé Adaptabilité des modèles en assurance incendie, accidents et risques divers (IARD).
Les deux tiers du financement, soit une somme de 566 711 $, proviennent du programme Alliance du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Le Groupe Co-operators, partenaire de CARA depuis son lancement au printemps 2018, octroie l’autre tiers du financement, soit 283 455 $.
La subvention est accordée au titulaire de la Chaire, Jean-Philippe Boucher, et à son collègue Mathieu Pigeon. « Les modèles mathématiques développés auront deux principaux objectifs. Sur le plan de la tarification, nous voulons que les modèles soient en concordance avec les risques, et qu’ils soient stables à travers le temps », souligne le professeur Boucher dans le communiqué de l’UQAM.
« Nous souhaitons aussi nous assurer que Co-operators ait toujours les liquidités pour payer les coûts des dommages liés à des catastrophes naturelles, comme les feux de forêt », ajoute-t-il.
De plus, Co-operators a fait une contribution de 500 000 $ pour le renouvellement de la Chaire jusqu’en 2029. CARA a pour mission de développer les programmes d’actuariat à l’UQAM, de contribuer à la science actuarielle et de former des professionnels qualifiés dans ce domaine.
La programmation 2024-2029 se concentre autour de trois axes, soit la standardisation et la réplication des données d’assurance, la rationalisation de la tarification et celle du provisionnement, soit les réserves que l’assureur doit mettre de côté pour régler les réclamations.

En entrevue avec le Portail de l’assurance, Jean-Philippe Boucher confirme que les organismes subventionnaires ont confirmé leur intention à la fin de l’année dernière. Des délais administratifs du côté de l’UQAM ont fait en sorte que l’établissement a mis un certain temps pour l’annoncer.
Le renouvellement de la Chaire a été retardé, car les fonds annoncés en 2018 n’avaient pas entièrement été dépensés en raison de la pandémie. « La quasi-totalité de l’argent qu’on reçoit sert à financer les projets, à payer les étudiants qui y participent et les activités connexes », précise M. Boucher.
Le titulaire de la Chaire Co-operators doit consacrer son temps à solliciter des fonds auprès des organismes qui subventionnent la recherche universitaire. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet financé par le CRSNG.
Le professeur précise que les résultats des travaux de recherche ne sont pas réservés à la compagnie d’assurance. Co-operators participe au comité directeur et y suggère des avenues de recherche. Les étudiants peuvent mener leurs travaux en étant accompagnés par des professionnels à l’emploi de l’assureur. Or, tout le contenu scientifique de même que les mémoires de maîtrise et de doctorat sont rendus publics et accessibles à l’ensemble de l’industrie.
Ainsi, un article portant sur la propagation des feux dans les bâtiments de ferme a été publié en 2021, un sujet qui intéresse une partie de la clientèle de la compagnie d’assurances générales du Groupe Co-operators. Les auteurs de l’article ont d’ailleurs été lauréats d’un prix décerné par la Casualty Actuarial Society (CAS).
Utilisation des données
Dans le cas de l’axe de recherche sur la réplication de données, une des avenues de recherche est l’élaboration de systèmes qui servent à anonymiser les données des assureurs afin de pouvoir les partager sans crainte avec d’autres chercheurs en science de l’actuariat. « Comme chercheur, on pourra partager davantage ce type de données avec d’autres chercheurs à travers le monde, ce qui peut vraiment aider à la collaboration plutôt internationale », dit-il.
Du côté de la tarification, les chercheurs vont tenter d’intégrer plusieurs éléments dans un modèle de tarification, au lieu d’utiliser différents modèles selon le contexte. La valeur client est un des éléments que les assureurs devraient considérer, suggère M. Boucher.
« Le client qui s’en va, ça coûte cher de le remplacer. Outre le temps que l’agent d’assurance devra consacrer pour tenter de le conserver, s’il faut en trouver un autre, il y a quand même un coût qui est plus élevé pour l’assureur », explique le professeur.
L’interfinancement entre les classes d’assurés est une chose normale dans un portefeuille, selon lui, mais cela ne devrait pas empêcher l’assureur de reconnaître la valeur d’un client fidèle en établissant la tarification « Si l’assureur perd le groupe d’assurés qui subventionnait un autre groupe, il n’est plus rentable. Le problème est qu’il n’est pas toujours simple de distinguer quel est le groupe qui finance les autres. Ça fait partie des modèles de segmentation qu’on essaie de produire », dit-il.
Applicabilité
L’équipe de la CARA se préoccupe particulièrement de produire des résultats applicables dans le quotidien des actuaires. « On propose des outils, mais il faut aussi trouver une manière de les intégrer dans la réalité quotidienne des assureurs. Ça prend du temps », indique M. Boucher.
La diffusion des résultats demeure un souci constant du professeur. « Ce qu’on veut en fin de compte, c’est que cela soit employé, expliqué aux assurés, aux dirigeants, aux administrateurs de la compagnie d’assurance ou encore aux autorités financières, explique M. Boucher. Il ne faut pas que ça reste un truc publié dans un journal scientifique sans que personne ne l’utilise par la suite. On essaie de diffuser les résultats pour expliquer et montrer que ça marche », insiste-t-il.
La recherche ou le travail
Le prolongement du mandat de la chaire jusqu’en 2029 de même que le financement du nouveau projet sont une bonne nouvelle pour la CARA, car le recrutement des chercheurs dans un domaine comme l’actuariat est une préoccupation constante.
« Les gens qui finissent leur baccalauréat se trouvent rapidement du travail et les employeurs offrent d’excellentes conditions. C’était déjà un défi quand j’ai fini mes études », note M. Boucher, qui est diplômé en actuariat de l’Université Laval en 1999. Par la suite, il a poursuivi ses études supérieures en France avant de devenir professeur au Département de mathématiques de l’UQAM en 2007.
L’esprit de la recherche dans une chaire d’innovation est justement de permettre de participer à des projets qui sont proches des besoins de l’industrie. « Nos étudiants sont intégrés dans les équipes, ils peuvent aller présenter la progression de leurs travaux aux membres de la direction de la compagnie », souligne Jean-Philippe Boucher. Des perspectives d’emploi en découlent, voire des promotions pour un actuaire qui désire pousser son expertise plus loin.
Certains des chercheurs qui participent aux travaux peuvent aussi devenir eux-mêmes professeurs en actuariat dans des établissements d’enseignement, au Québec ou ailleurs. « On en a formé qui sont désormais établis en Espagne, en Écosse, etc. », dit-il.
Assurance automobile
Jean-Philippe Boucher mentionne d’autres travaux plus récents qui sont axés sur le risque de vol de véhicules. Un étudiant qui produisait son mémoire de maîtrise « a travaillé à essayer de trouver des manières d’identifier plus rapidement un problème sur certaines portions du portefeuille ».
En évitant de constater avec trois mois de retard la fréquence des réclamations, l’assureur peut ajuster plus rapidement ses modèles actuariels. « Cela permet de sonner l’alarme plus rapidement, et on a fait des modèles statistiques là-dessus », ajoute-t-il.
L’utilisation des données télématiques en assurance automobile est un autre sujet de recherche sur lequel la CARA se penche. La technologie sur les véhicules permet d’alerter le conducteur d’un danger, ce qui réduit la fréquence des réclamations. « Par contre, la sévérité est en forte hausse, car un pare-chocs bourré de capteurs électroniques, ça coûte très cher à réparer quand il y a un dommage », dit-il.
Les professeurs Boucher et Pigeon ont d’ailleurs publié en 2024 un article dans la revue de la CAS intitulé Balancing Risk Assessment and Social Fairness : an Auto Telematics Case Study. Dans le sommaire exécutif, ils expliquent que « les données synthétiques issues d’un grand assureur canadien suggèrent que les technologies télématiques pourraient réduire la dépendance aux variables sensibles dans les modèles de tarification en assurance auto. Les actuaires utilisent encore fréquemment des facteurs comme l’âge, le sexe, le statut matrimonial ou la localisation. Or, ces variables sont parfois perçues comme discriminatoires, notamment lorsqu’elles sont corrélées à des données comme le revenu ou l’origine ethnique ».
Les données télématiques — telles que les freinages brusques, les accélérations soudaines, le kilométrage ou les jours de conduite — permettent de mieux capter le risque réel lié au comportement de conduite. Ces données peuvent, « dans certains cas, remplacer des variables sensibles tout en maintenant de bonnes performances prédictives dans les modèles de fréquence et de gravité des sinistres ».
Des obstacles freinent l’adoption de ces technologies : les coûts d’implantation, le respect de la vie privée et la complexité des modèles d’apprentissage machine, souvent difficiles à expliquer aux régulateurs. Les auteurs de l’étude concluent que « tester l’intégration de données télématiques pourrait permettre aux assureurs de développer des modèles plus équitables et mieux alignés avec les attentes sociétales actuelles en matière d’équité algorithmique ».