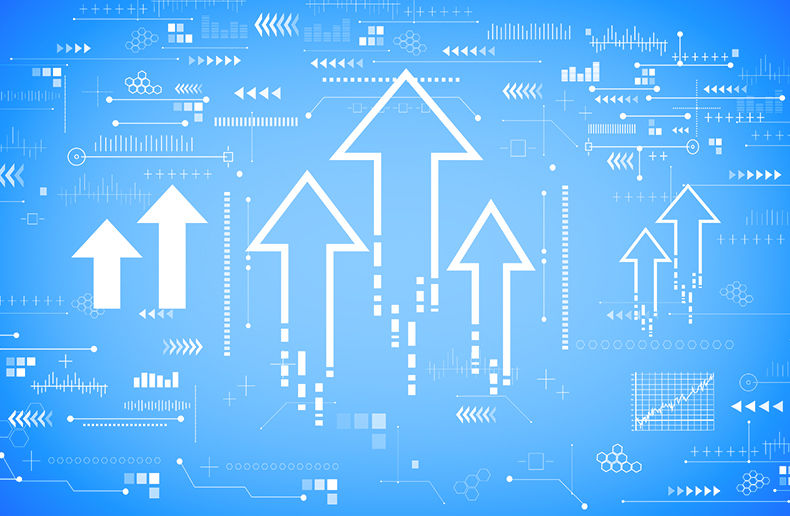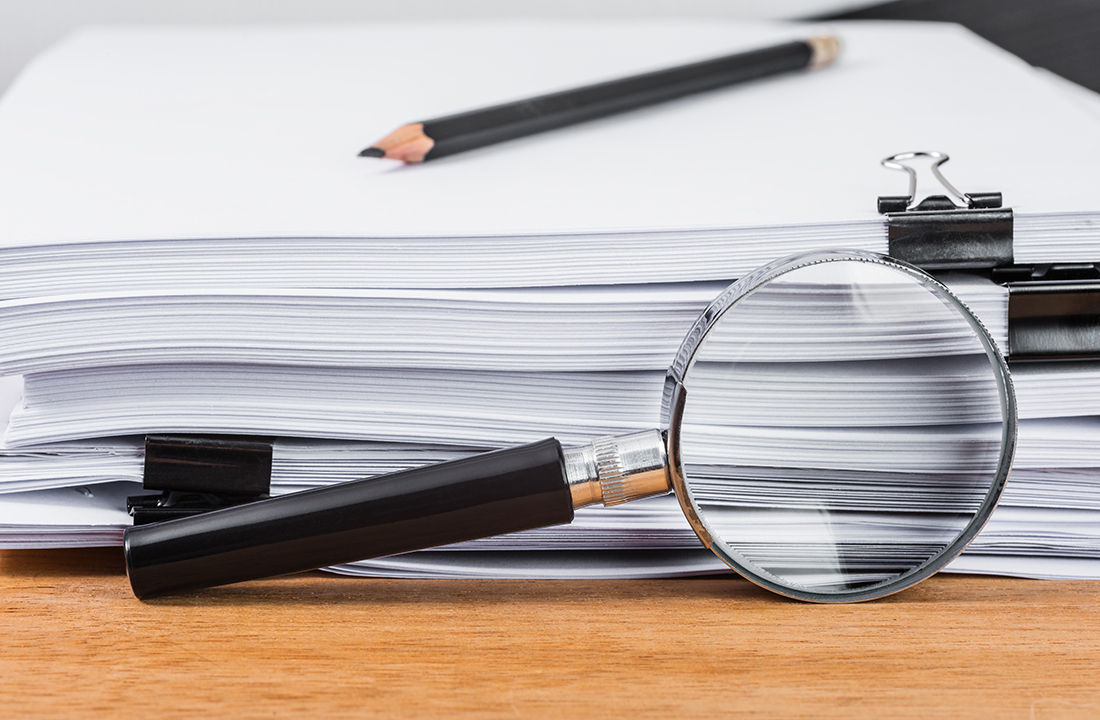L’employé d’une compagnie aérienne tombe malade au début de la pandémie de COVID-19, en mars 2020. En raison d’un malentendu relié à sa couverture d’assurance collective, il a été privé de 15 semaines de prestations durant son congé. Le tribunal lui donne raison et condamne le tiers-payeur administrateur (TPA) et l’assureur à payer conjointement la somme due, en plus d’ajouter des dommages.
La décision a été rendue en l’absence des défenderesses lors de l’audience tenue le 28 mars 2025, même si ces dernières avaient été dûment notifiées. Le jugement a été rendu le 18 juillet dernier par la juge Chantale Beaudin, du district de Saint-Jérôme de la Cour du Québec.
Le demandeur, Francis Cayer, occupait un emploi permanent et à temps plein de directeur de bord chez Air Canada. Par l’entremise de SSQ, Société d’assurance vie (aujourd'hui Beneva) et de Manion Wilkins & Associés, une agence spécialisée dans les avantages sociaux qui agit comme TPA pour le compte de l’assureur, l’employé bénéficie notamment d’une garantie d’assurance salaire de courte durée.
Le 23 février 2020, le demandeur cesse de travailler, ce que confirme son relevé d’emploi émis le 2 mars. Selon la police d’assurance collective, il a droit à une prestation équivalente à 60 % de son salaire s’il est totalement invalide et incapable de travailler.
Après le délai de carence de 14 jours, il reçoit ainsi les prestations durant 15 semaines payées par Manion au nom de SSQ, soit jusqu’au 20 juin 2020. Ces prestations sont non imposables.
La pandémie
Pour les 15 semaines subséquentes, la police prévoit que les prestations sont couvertes par la Loi sur l’assurance-emploi du Canada (LAE). Ces prestations sont imposables. Ensuite, le régime d’assurance salaire de courte durée prévoit le versement de 46 semaines supplémentaires.
Pour toute période d’invalidité totale, la police prévoit que les prestations sont payables durant une période maximale de 78 semaines, incluant le délai de carence.
À la fin juin 2020, M. Cayer dépose sa demande, mais même si la Commission de l’assurance-emploi du Canada est d’avis que sa demande est légitime, en raison des changements apportés à la LAE, il n’est pas admissible aux prestations de maladie.
En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a modifié la LAE. Toute demande de prestations maladie soumise entre le 15 mars et le 27 septembre 2020 est alors considérée comme une demande de prestation d’urgence.
Par conséquent, contrairement au terme de la police, les 15 semaines subséquentes ne sont pas couvertes par la LAE, mais par la prestation canadienne d’urgence (PCU). Sous prétexte que l’employé malade reçoit la PCU, et non la prestation maladie, les défenderesses refusent de lui verser ce qu’il réclame.
Durant 15 semaines suivantes, le demandeur ne recevra que 500 $ par semaine, au lieu de la prestation de 770 $ correspondant à 60 % de son salaire.
Les clauses de la police
Pour rendre son jugement, la juge Beaudin analyse les clauses du contrat d’assurance et les règles du Code civil du Québec.
Pour interpréter les contrats d’adhésion, ce qui est le cas d’un régime collectif d’avantages sociaux, l’article 1432 prévoit qu'en cas de doute, on donne raison à l’adhérent ou au consommateur.
Quant à lui, l’article 2403 du Code prescrit que « l’assureur ne peut invoquer des conditions ou déclarations qui ne sont pas énoncées par écrit dans le contrat ».
À l’article 2404, on ajoute qu’en assurance de personnes, « l’assureur ne peut invoquer que les exclusions ou les clauses de réduction de la garantie qui sont clairement indiquées sous un titre approprié ». Aucune exclusion dans la police n’est inscrite concernant l’admissibilité aux prestations de maladie de la LAE.
La police prévoit même, dans la rubrique « prolongation des prestations », que « si les prestations d’assurance salaire de courte durée prennent fin alors que vous êtes totalement invalide, les prestations continueront d’être versées pendant toute la période d’invalidité, comme si la garantie était toujours en vigueur ».
Or, la preuve montre que les prestations ont pris fin le 20 juin 2020, alors que l’invalidité du demandeur par la suite n’est pas contestée.
« La preuve démontre que la garantie pour l’assurance salaire de courte durée ne prévoit aucune limitation ou exclusion dans l’éventualité où les 15 semaines subséquentes n’étaient pas couvertes par la LAE en raison d’une modification à la loi pendant la période d’invalidité », souligne le jugement.
Selon la juge, l’assureur devait continuer de verser les prestations durant ces 15 semaines, comme si la garantie était toujours en vigueur. Le fait que le demandeur puisse être tenu de rembourser les prestations versées par l’assurance-emploi ne change rien aux obligations des défenderesses. En pareil cas, il sera de la responsabilité de l’employé invalide de rembourser les sommes reçues.
Le tribunal accorde donc les 15 semaines de prestations, pour une somme de 11 550 $.
Les dommages
Dans son témoignage que le tribunal qualifie de « sincère, honnête et crédible », M. Cayer raconte le désespoir, l’humiliation et la rage lorsqu’on l’informe que, n’ayant pas reçu de prestations de maladie de l’assurance-emploi, les défenderesses ne lui verseront aucune prestation.
Alors qu’il est en invalidité, fragile et épuisé, il doit multiplier les démarches auprès de la Commission pour avoir droit à ses prestations de maladie. Ses démarches sont infructueuses. Il raconte avoir vécu un stress énorme et avoir connu des ennuis financiers.
Le défaut des défenderesses de respecter leurs obligations lui a causé des troubles et inconvénients durant plusieurs semaines. La preuve médicale confirme l’intensité de la souffrance morale subie par le demandeur durant cette période.
Les défenderesses ont commis une faute dans le traitement de la réclamation et elles n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles, estime le tribunal.
La juge Beaudin cite ensuite la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec dans un litige de 2013 et la doctrine pertinente sur les obligations des parties après la déclaration de sinistre. « L’assuré a besoin de ses prestations pour maintenir ses acquis patrimoniaux et son régime de vie », écrivait le professeur Jean-Guy Bergeron.
« L’assureur doit mener une enquête adéquate, déterminer les garanties raisonnablement disponibles et verser promptement l’indemnité », ajoutait l’auteur dans un livre sur les développements récents en droit des assurances paru en 2010.
Pour ses dommages, le demandeur réclamait 3 450 $, ce qui menait sa réclamation totale à 15 000 $, la somme maximale que la chambre civile des petites créances de la Cour du Québec peut accorder.
Des dommages compensatoires sont de mise et le tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour accorder une somme de 2 000 $ au demandeur.
Les défenderesses sont donc condamnées solidairement à lui rembourser la somme totale de 13 550 $, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation.