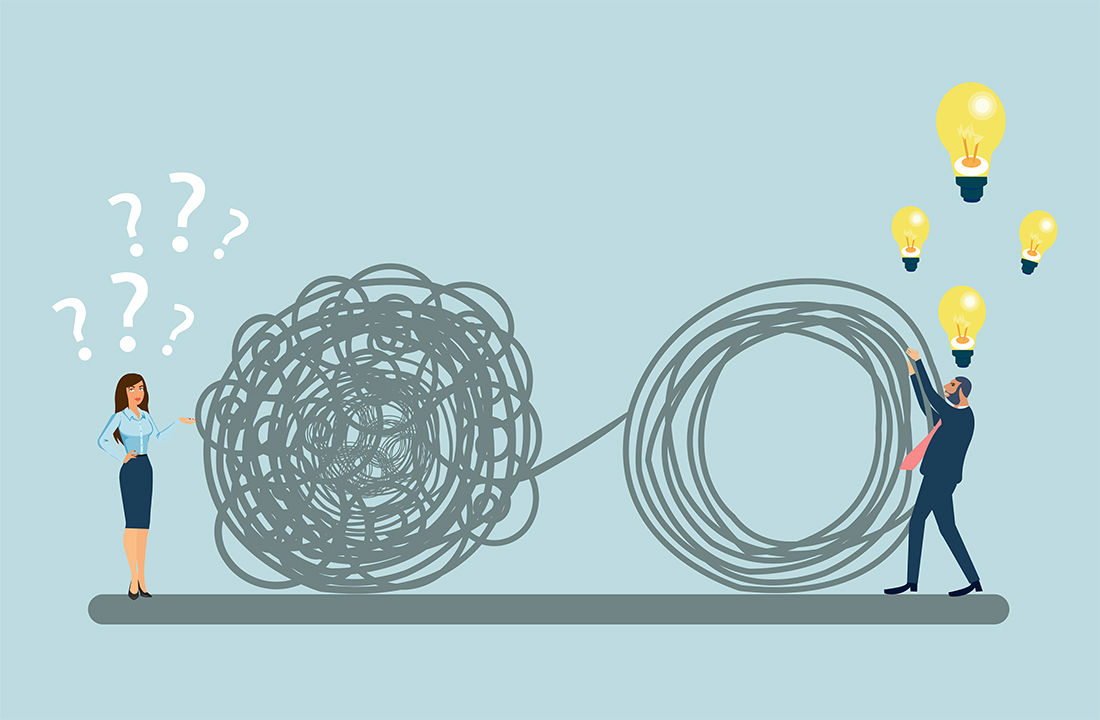La résidence de l’assurée est endommagée par un incendie en avril 2023. L’assureur découvre que la cliente possédait un python, ce qui serait une exclusion au contrat. L’assureur intente une action en garantie contre le cabinet de courtage qui a vendu la police.
La société 9388-8683 Québec inc., qui fait affaire sous la dénomination sociale Assurances Bernier et Filles, s’est présentée devant le tribunal pour soumettre une demande en irrecevabilité et en rejet. Le cabinet de courtage est la partie défenderesse dans un litige intenté par L’Unique Assurances générales, auquel l’assurée Céline Levasseur est citée comme partie mise en cause.
Le juge J. Sébastien Vaillancourt, du district de Longueuil de la Cour supérieure du Québec, a entendu les parties le 16 octobre dernier. Dans son jugement rendu le 28 octobre dernier, le juge refuse la requête du cabinet.
Il indique que « l’examen de la validité d’une subrogation conventionnelle requiert l’administration d’une preuve, de sorte qu’il y a lieu de laisser l’instance se poursuivre ». La subrogation est la substitution d’une personne ou d’une chose par une autre dans une relation juridique.
La procédure
Le tribunal rappelle les principes juridiques sur lesquels le tribunal se base pour analyser le rejet d’une procédure à un stade préliminaire. L’article 168 du Code de procédure civile établit les règles permettant de déterminer qu’une demande introductive d’instance est irrecevable ou abusive.
Le tribunal doit d’abord déterminer si les faits allégués doivent être tenus pour avérés, sans égard à la qualification juridique que peut en faire la partie demanderesse. Il doit ensuite se demander si ces faits « peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées ».
Le cas échéant, la tenue d’un procès sera évitée si le recours est dépourvu de fondement juridique. Pour en arriver là, la situation doit être claire et sans ambiguïté et apparaître à la simple lecture des allégations. Une telle sanction ne doit être réservée qu’aux cas évidents où le recours est voué à l’échec.
Dans l’incertitude, « il faut éviter de mettre prématurément fin à un procès », écrivait la Cour d’appel en 2012 en infirmant un jugement de première instance où le défendeur avait obtenu l’arrêt des procédures. Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit relèvent du juge au procès.
Le contexte
Les faits allégués par L’Unique sont tenus pour avérés dans le cadre de l’examen de la demande en irrecevabilité. Le tribunal résume les principaux éléments du dossier de la manière suivante.
La résidence de Mme Levasseur est assurée par L’Unique depuis août 2021, par l’entremise du cabinet de courtage. La résidence est endommagée par un incendie en avril 2023.
En menant son enquête, l’assureur découvre que l’assurée était propriétaire d’un python qui était présent dans la résidence. Le jugement ne précise pas si le reptile a survécu au sinistre.
Les normes de souscription prohibent l’émission d’une telle police lorsqu’il y a présence d’animaux exotiques. L’Unique déclare qu’elle n’aurait pas émis le contrat si elle avait su que l’assurée détenait un tel animal. C’est d’ailleurs ce qu’elle a écrit à l’assurée dès le 2 juin 2023. Cette lettre a été produite par la défenderesse pour soutenir sa demande de rejet de la procédure.
L’assureur a néanmoins indemnisé l’assurée pour un montant de 392 303,64 $. Il soutient que les représentants du cabinet étaient au courant de la présence du python puisqu’ils en avaient été informés par la consommatrice, et qu’ils lui ont caché cette information.
En agissant ainsi, l’assureur allègue que le cabinet a engagé sa responsabilité et que l’assureur a un lien de subrogation légale et conventionnelle avec les droits de Mme Levasseur. Ainsi, l’Unique réclame au cabinet l’indemnité versée à l’assurée.
La subrogation
Dans le cas présent, L’Unique a modifié son recours initial, où « elle alléguait seulement qu’elle était subrogée légalement dans les droits de Levasseur, sans faire référence à l’existence d’une subrogation conventionnelle ». À la suite de la demande en irrecevabilité et en rejet faite par la défenderesse, elle allègue pour la première fois l’existence d’une transaction subrogatoire signée par Levasseur en janvier 2025.
Le cabinet de courtage avance deux arguments principaux pour soutenir sa demande de rejet de la procédure, en s’inspirant des articles 1653 et 1654 du Code civil du Québec.
Premièrement, l’assureur ne peut être subrogé légalement dans les droits de l’assurée puisqu’il a décidé de l’indemniser après avoir procédé à l’annulation ab initio de la police en raison de fausses déclarations.
Deuxièmement, la défenderesse soutient que la subrogation conventionnelle doit être expresse et consentie par écrit par le créancier — l’assurée, dans ce cas-ci, et que cela doit être fait en même temps que le paiement. Or, des paiements ont été faits par L’Unique à Mme Levasseur en 2023 et en 2024, alors que la quittance a été signée en janvier 2025. La subrogation n’a donc pas été consentie par l’assurée au moment où elle a perçu l’indemnité.
La preuve à faire
S’il est vrai que les articles du Code civil cités par la défenderesse prescrivent ce qu’elle avance, « la volonté des parties au moment du paiement doit être prise en considération », exige la jurisprudence. Les paiements ont bel et bien été faits avant la quittance subrogatoire, reconnaît l’assureur.
L’Unique plaide cependant que les circonstances entourant les paiements et la conclusion de la quittance, une fois mises en preuve, pourraient avoir un impact sur l’examen de la validité de la subrogation conventionnelle. L’avocate de l’assureur rappelle d’ailleurs que la représentante de l’assurée a été informée du fait que le règlement de la réclamation « devra faire l’objet d’une transaction officielle entre nos clientes, incluant une quittance subrogatoire ».
La jurisprudence de la Cour d’appel soumise par la demanderesse rapporte d’ailleurs un tel cas où la quittance a été signée plusieurs mois après le paiement fait au créancier.
Le tribunal ne juge pas nécessaire de se pencher sur la question de l’existence d’une subrogation légale.
Le cabinet n’a pas insisté en cherchant à débattre du caractère abusif du recours intenté par la demanderesse. Le tribunal précise qu’il le fait à juste titre en raison des motifs qu’il a déjà invoqués.