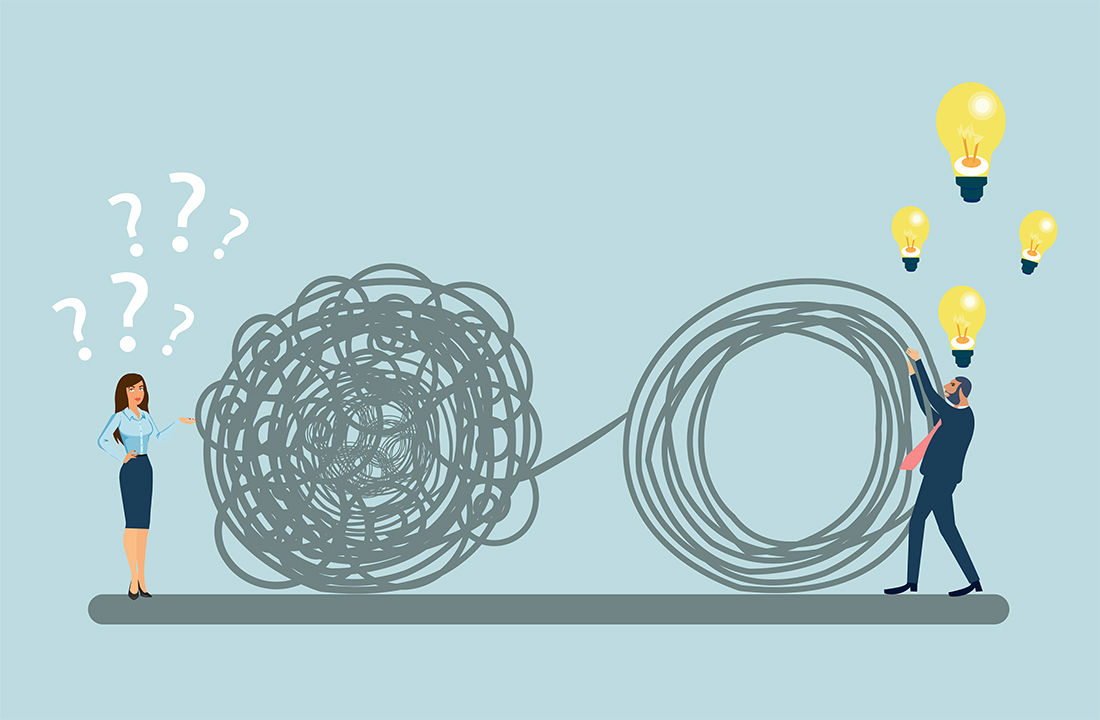Des maladies les plus répandues au Québec, la migraine est l’une des plus sous-estimées, selon Migraine Québec. D’après l’organisme, 1,2 million de Québécois en souffrent, dont 470 000 femmes en âge de travailler.
Dans une salle de 100 personnes, 10 à 12 d’entre elles sont affligées de cette maladie neurologique, bien que beaucoup l’ignore, faute de diagnostic. En l’ignorant, souligne Migraine Québec, ces personnes peuvent poser des gestes susceptibles de provoquer une détérioration de leur état ou une augmentation du nombre de crises.
La migraine touche davantage les femmes. Après la puberté, deux à trois femmes en sont atteintes pour un homme. Elle afflige notamment les travailleuses âgées de 30 et 50 ans qui sont en pleine carrière, ce qui entraîne de l’absentéisme, du présentéisme (soit le fait de travailler malgré la douleur) et des demandes d’invalidité.
En 2024, l’Institut de la statistique du Québec a estimé à 51 millions de dollars l’absentéisme lié à la migraine.
Cela dit, les médecins sont mieux outillés aujourd’hui pour confirmer et traiter la maladie avec de nouveaux médicaments de pointe.
Distinguer maux de tête et migraine
La migraine n’est pas mortelle, mais elle ne se guérit pas. Elle ne se voit pas dans une prise de sang ou en imagerie cérébrale, mais elle est bien réelle et elle affecte fortement la qualité de vie de ses victimes.
« La société a une image de la migraine qui n’est pas la bonne, constate Véronique Clément, directrice générale de Migraine Québec. Les gens n’en comprennent pas l’ampleur ». Ces migraineux et migraineuses se sentent souvent jugés dans leur milieu de travail et même dans leur entourage, car ils n’ont pas l’air malades.
Beaucoup de gens confondent migraine et maux de tête sévères.

« Avoir mal à la tête, ce n’est pas une maladie, c’est un symptôme, explique en entrevue au Portail de l’assurance la Dre Heather Pim, neurologue spécialisée dans les céphalées au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) ainsi que présidente et cofondatrice de Migraine Québec. La migraine est une maladie neurologique avec une biologie propre à elle. Il existe une classification internationale qui comporte tous les critères bien définis sur lesquels on se base pour établir un diagnostic. »
Durée et symptômes de la migraine
Chaque crise de migraine dure de 4 à 72 heures, précise la Dre Pim. Elle comporte des signes avant-coureurs et plusieurs phases. L’intensité de la douleur varie de modérée à grave et s'aggrave si on fait la moindre activité.
Ses effets s’accompagnent souvent de maux de cœur, parfois jusqu’à des vomissements. Elle entraîne habituellement une sensibilité à la lumière, aux sons et parfois aux odeurs, comme celles des parfums forts. Les personnes qui vivent avec la migraine ont aussi tendance à ressentir assez fréquemment le mal des transports.
Au sortir d’une crise, les gens tombent dans la dernière phase, le postdrome (ou phase postdromique). « On n’a plus mal, mais notre cerveau est tellement brûlé qu’on est déconcentré, décrit la neurologue. On est peut-être présent au travail, mais on est moins performant. »
Classification des migraines
Dans la plupart des cas, selon la Dre Pim, on naît avec une fragilité génétique envers la migraine. Assez souvent, on a des membres de notre famille qui sont migraineux. À un moment dans la vie, des déclencheurs qui peuvent être internes (comme les menstruations) ou causés par des stimuli ou des traumatismes entraînent l’apparition des crises.
« Les déclencheurs les plus fréquents sont le stress, la fatigue, la prise de repas à des heures irrégulières et le manque de sommeil, indique d’ailleurs Migraine Québec sur son site web. Selon des études, ces facteurs ont été identifiés comme étant des déclencheurs chez 74% à 84% des personnes atteintes de migraine. »
Parfois aussi, la maladie peut s’installer sans déclencheurs précis.
La fréquence des migraines est classifiée : 80% des gens qui en souffrent ont des effets « peu fréquents » ou « épisodiques », c'est-à-dire qu’ils font de 1 à 7 crises par mois ; 15% vivront de 8 à 14 crises par mois; et 5% éprouveront 15 jours de crises et plus par mois. Ces derniers seront considérés comme des migraineux chroniques et c’est dans cette dernière catégorie que se retrouve le plus grand nombre de cas d’invalidité.
« Les gens qui souffrent de migraine sont vus comme des plaignards. Ma clinique montre le contraire, souligne la Dre Pim. Je traite des personnes très atteintes et, pourtant, elles veulent travailler. Elles sont très travaillantes, parfois trop. J’ai des patients qui ne veulent pas se retrouver en invalidité. »
Des mesures pour réduire les migraines en milieu de travail
« Un des problèmes, c’est que les migraines ne sont pas toujours déclarées auprès des employeurs et des collègues, de crainte d’être vus comme faibles, observe Véronique Clément. Il y a un côté “stigmatisation au travail” que l’on essaie de défaire. »
Des adaptations en entreprise peuvent être faites avant d’arriver à l’invalidité, assure-t-elle. Migraine Québec travaille présentement à finaliser un programme pour les employeurs, Migraine au travail, afin de les sensibiliser à la migraine et aux actions qu’ils peuvent prendre. Une journée de rencontre avec des assureurs est prévue.
Pour illustrer le potentiel de rentabilité pour une entreprise, Véronique Clément prend l’exemple de l’entreprise Fujistu, au Japon, qui, grâce à des accommodements, a permis à des employés migraineux de gagner 15 jours de présence active au travail.
Des médicaments plus performants
Des progrès ont été accomplis dans la compréhension et le traitement de la migraine. Des médicaments ont été développés pour casser les crises, tels que les anticorps monoclonaux inhibiteurs du CGRP, communément appelés « anti-CGRP », apparus en 2021. « Ce sont des anticorps qui empêchent la liaison entre le peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP) et son récepteur, précise Migraine Québec. Le CGRP est un agent inflammatoire très actif dans le processus de la migraine. »
Ces médicaments, administrés par auto-injection ou par intraveineuse, coûtent environ 600 $ par mois.
Le recours aux traitements préventifs est au cœur de la prise en charge de la migraine. Ils peuvent améliorer significativement la qualité de vie des migraineux en réduisant le nombre et l’intensité de leurs crises.
Or, au Québec, l’accès à ces traitements préventifs spécialisés n’est pas automatique. La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) exige que l’essai de deux classes de médicaments ait échoué avant de rembourser des traitements comme les anti-CGRP.
« Il y a des compagnies d’assurance et des régimes collectifs qui connaissent très bien la migraine et qui vont plus loin que la RAMQ, se réjouit Véronique Clément. Avec d’autres, c’est plus compliqué. Elles se limitent à reproduire ce que rembourse le régime public. »
Elle souhaite que les assureurs couvrent les médicaments préventifs, incluant ceux de nouvelles générations, ainsi que les combinaisons de traitements de Botox et d’anti-CGRP, destinés à traiter les formes sévères de la maladie (5%).
Bien que le coût de ce traitement combiné puisse s’élever de 10 000 $ à 11 000 $ par année, la Dre Heather Pim croit que le prix en vaut la chandelle pour réduire le nombre d’invalidités.
Des formulaires simples, d’autres complexes
Chez certains assureurs, la procédure pour obtenir le paiement de traitements de pointe demeure ardue, constate la neurologue. Les formulaires – souvent encore imprimés – sont longs et peuvent exiger de 10 à 30 minutes à remplir, au grand dam des médecins. « Allégez notre fardeau administratif », leur demande la neurologue.
À l’inverse, elle cite comme modèle celui de la Sun Life qui pose des questions simples. Il pourrait inspirer d’autres assureurs, dit-elle. À tout le moins, la neurologue apprécierait que des compagnies offrent leurs formulaires en ligne, ce qui les rendrait plus faciles et plus rapides à remplir.
Elle aimerait aussi que des assureurs laissent aux spécialistes comme elle le soin de déterminer le niveau de médication plus ciblé dont des patients migraineux ont besoin, selon l’intensité de leur état. Dre Pim souligne qu’en sclérose en plaques, les neurologues peuvent d’emblée déterminer quelle médication de pointe ils vont prescrire. Elle espère la même chose pour les migraines lourdes qui l’exigent.
Elle a un message pour eux : « Permettez-nous de faire notre métier de médecin. Faites-nous confiance pour le choix des traitements et de la médication. Au final, ce sera meilleur pour la santé de votre assuré et économiquement moins coûteux pour vous. »