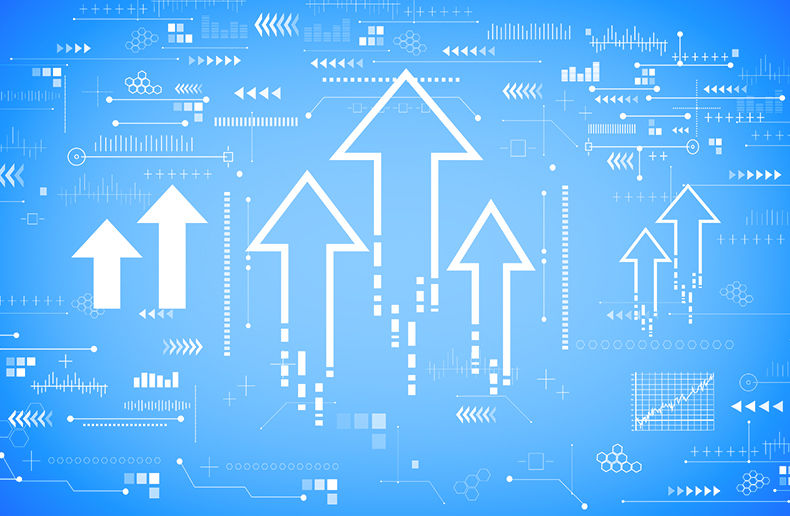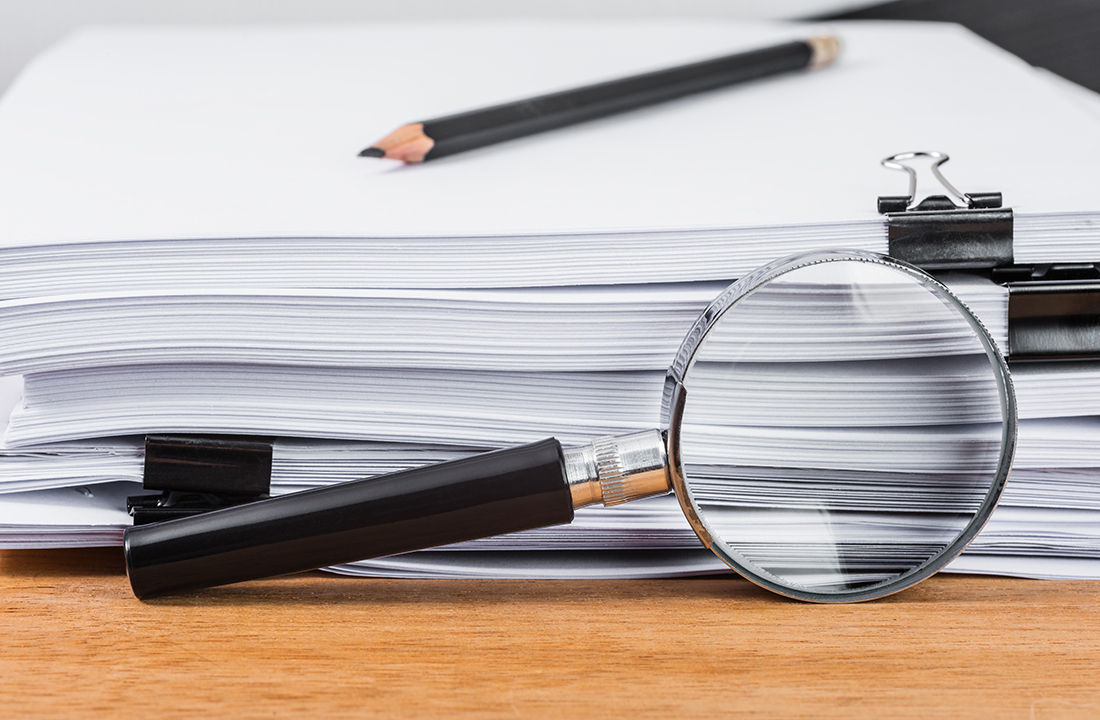Les membres du Comité de déontologie de la Chambre de l’assurance de dommages ont brillé par leur esprit de synthèse dans leur raisonnement sur la sanction imposée à l’encontre de l’experte en sinistre Guylaine Mathieu (no de certificat 144 758), pour négligences et manque d’explications. La décision a été publiée le 20 mars 2023.
Pourtant, lorsqu’un dégât d’eau vint affecter leur résidence de Montréal, en août 2018, ses clients avaient de multiples raisons de porter plainte et de vociférer à propos de ses silences et de ses omissions répétées.
Recommandation commune
Devant le récit des faits, l’expert elle-même a reconnu la gravité de ses négligences grossières, dans l’exercice de ses fonctions, que ses 20 ans d’expérience rendaient d’autant moins excusables. Mme Mathieu a même reconnu sa culpabilité.
Elle a aussi accepté, par la voie de son avocate, Me Sonia Paradis, et de concert avec le syndic représenté par Me Gabriel Chaloult-Lavoie, d’être radiée durant trois mois et de payer une amende de 5 000 $.
Cette sentence prend néanmoins en considération les facteurs atténuants que cette intimée a pu plaider, soit la reconnaissance de sa culpabilité et son absence de mauvaise foi. Ses difficultés à trouver un entrepreneur, qui constitue sa seule justification, ne sont évoquées qu’en quelques lignes dans le jugement, de même que les trois chefs d’accusation.
La négligence, conjuguée en trois temps
Le premier chef, qui se vaut une radiation de trois mois, repose sur « le contrôle perdu par l’expert de sa réclamation ». En fait, Guylaine Mathieu n’a pas évalué les dommages. Elle s’est contentée de prendre tel quel le rapport de ses estimateurs et de laisser le centre de relation avec la clientèle de l’assureur répondre aux demandes ses sinistrés, sans jamais leur assurer les suivis les plus légitimes.
Une telle attitude entre alors en contravention avec l’article 58 paragraphe 1 du Code de déontologie des experts en sinistre, selon lequel un exercice négligent par l’expert porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession.
Le second chef d’accusation, qui a justifié une amende de 5 000 $, touche l’article 21 de ce même Code, qui évoque le devoir de « fournir à l’assuré les explications nécessaires à la compréhension du règlement du sinistre et des services qu’il lui rend ». Le silence de Guylaine Mathieu aurait, en effet, pesé lourd devant les demandes répétées de ses clients d’obtenir des explications sur les détails de leur assurance multirisque.
Enfin, le troisième chef se base sur le même article et mène à la même peine que le premier (trois mois de radiation). Mais la négligence est, cette fois, associée au manque d’attention manifestée par l’experte devant les requêtes de ses clients concernant les mauvaises odeurs liées à l’humidité, la formation de champignons ainsi que le manque d’initiative de l’experte pour faire avancer les travaux.
Trois accusations, deux peines
À l’origine, d’autres articles du Code de déontologie des experts en sinistre venaient aussi accabler l’intimée, mais les chefs furent modifiés et un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions réglementaires qui servaient à soutenir le second d’accusation a été prononcé.
À l’égard des plaintes déontologiques, il est de coutume de fusionner les condamnations et les peines, lorsqu’elles portent sur un même plaignant durant une même période. Cette façon de faire tend, d’une part, à éviter d’alourdir les débats par des redondances. Mais elle sert aussi à éviter aux professionnels les lourdes conséquences d’une sanction.
Ici, les premiers et troisièmes chefs portent non seulement sur un même client et la même période, mais également sur le même article. Les trois mois de radiations sont néanmoins maintenus, mais purgés simultanément. Cela permettra à Mme Mathieu de retourner plus rapidement à ses fonctions, mais avec davantage de mentions à son avis de radiation temporaire… un avis qu’elle devra d’ailleurs défrayer dans un journal distribué dans la ville de Montréal, en plus des déboursés associés au jugement.
Un jugement s’appuyant sur la jurisprudence
Le raisonnement du comité autour de ces décisions ne se veut toutefois ni blâmant ni minimiseur. Il se concentre surtout à plaider sa contrainte de retenue en cas de recommandation commune. Ses membres s’appuient même sur une lourde jurisprudence pour déclarer que, dans ces circonstances « le comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction ». Son rôle se limite à évaluer si la peine proposée s’harmonise avec les principes de la protection du public par son exemplarité.
Il doit aussi s’assurer que l’équilibre entre l’effet dissuasif pour le professionnel et la reconnaissance de son droit d’exercer sa profession est maintenu. Le comité s’entend sur le fait que les sanctions proposées respectent ce principe. Cela explique en grande partie pourquoi le jugement est pratiquement exempt de détails accablants.