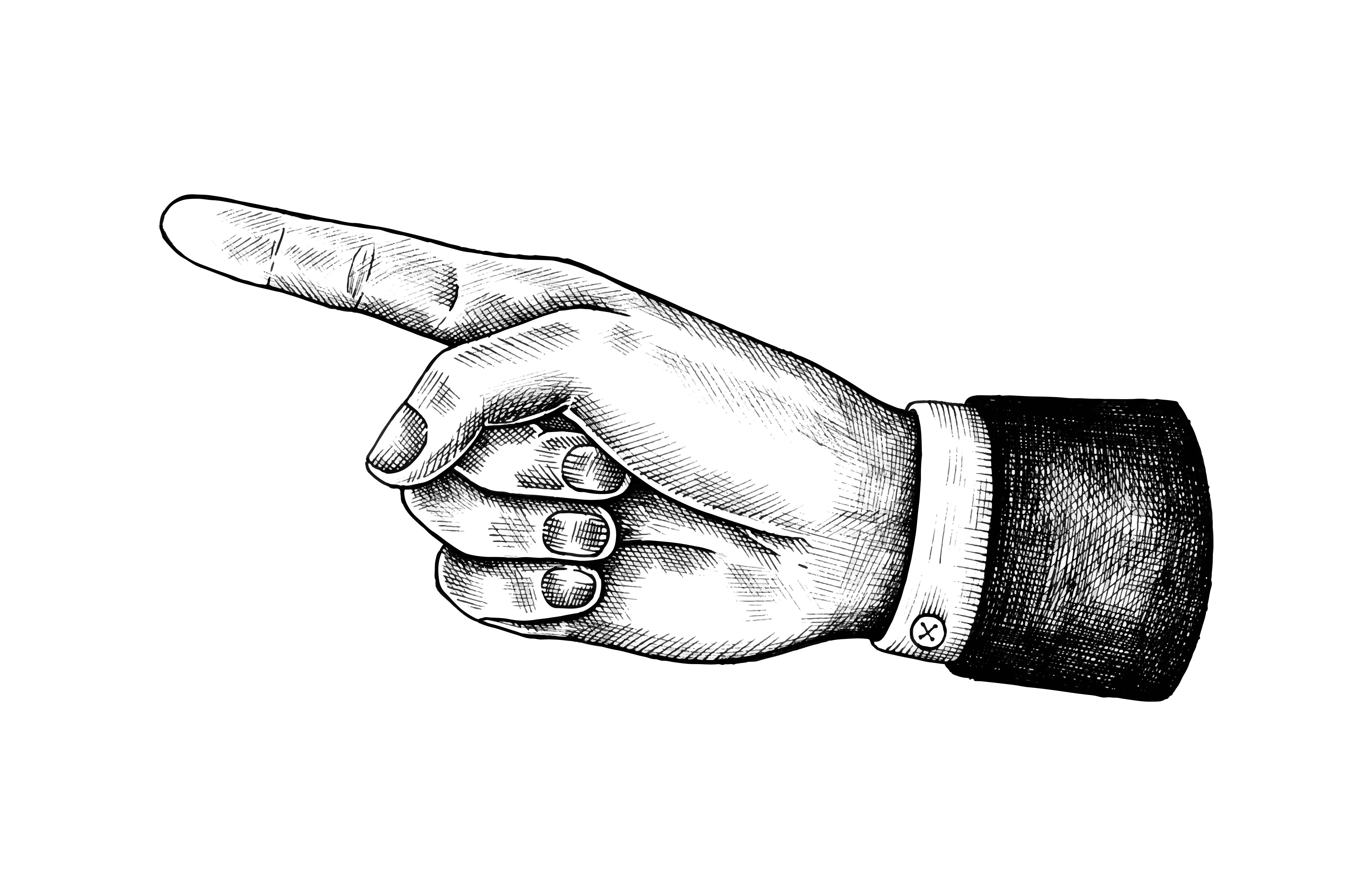Selon Gilles Ouimet, syndic de la Chambre de la sécurité financière, le processus disciplinaire ne doit pas entraîner une punition inutile pour le représentant sanctionné.
Le Portail de l’assurance s’est entretenu avec M. Ouimet le 13 juillet dernier. La première partie de notre entretien a été publiée ici. Gilles Ouimet est syndic de la Chambre depuis décembre 2018.
Dans une décision très récente, le comité de discipline a condamné Antonello Di Cesare à une peine de 10 ans de radiation. L’intimé n’a plus de certificat valide. Néanmoins, la peine est applicable dès maintenant.
Pendant longtemps dans les décisions du comité de discipline, après la sanction retenue, on indiquait que la peine allait être purgée au moment où l’intimé demande la remise en vigueur de son certificat.
Gilles Ouimet estime que ce changement était nécessaire. « Je suis contre cette pratique qui s’était développée de reporter la peine à la réinscription », dit-il.
L’objectif d’une peine de radiation est de mettre fin aux activités de la personne sanctionnée pendant un certain temps. « La seule raison pour laquelle on veut reporter ça au moment où la personne se réinscrit, c’est qu’on veut vraiment que ça fasse mal », dit-il.
Cette forme de punition à retardement est contraire à l’objectif de la justice disciplinaire dont le but est d’assurer la protection du public, insiste le syndic.
M. Ouimet estime que le report à la réinscription est d’autant plus « inopportun » si la sanction dépasse quelques mois. Le processus de réinscription est très lourd. Selon lui, il est illusoire de penser que la personne fera tout le processus afin de se réinscrire pour ensuite commencer à purger sa peine, ce qui la force à recommencer sa formation.
« Dans les faits, une période de radiation de 3, 4 ou 5 ans reportée à la réinscription, c’est une radiation permanente. Disons-le alors. Si on veut imposer la radiation permanente, qu’on l’impose », précise le syndic. Or, les dossiers où la radiation permanente s’impose sont très rares.
Une dissidence
La position de Gilles Ouimet est inspirée par la dissidence du juge Érick Vanchestein, de la Cour du Québec, dans une décision rendue en mai 2020 par le Tribunal des professions.
Cette cour entendait l’appel d’Élisabeth Parent qui s’opposait à la peine de sept mois de radiation temporaire que lui avait été imposée par le conseil de discipline de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. Le Tribunal a accueilli l’appel et réduit la sanction à une peine de deux mois de radiation à être purgée au moment de la réinscription.
La dissidence du juge Vanchestein porte justement sur le report de la sanction. « Je suis parfaitement d’accord avec sa dissidence », indique Gilles Ouimet. En plus d’être inutilement punitif, le report constitue une forme d’ingérence du conseil de discipline dans les pouvoirs de l’ordre professionnel, écrivait le juge Vanchestein.
« Comment un professionnel qui traîne un passé disciplinaire dont il ne peut s’acquitter complètement peut demander sa réinscription ? Cette façon de faire n’est certainement pas de nature à permettre “le droit par le professionnel d’exercer sa profession”, qui est un des objectifs à atteindre par la sanction disciplinaire », ajoutait le juge Vanchestein dans sa dissidence.
Le président du comité de discipline, Claude Mageau, a justement consacré une partie d’un jugement rendu en juin 2022 sur cette question du report de la radiation à la réinscription, rappelle Gilles Ouimet. Le syndic demandait de mettre fin à ce report.
L’approche contraire était devenue pratiquement un automatisme, déplore le syndic. L’origine de cette pratique remonte à une décision rendue par l’Ordre professionnel des avocats contre Perreton en 1997. Le Tribunal des professions l’avait réaffirmée dans une décision rendue à l’égard d’une infirmière auxiliaire en 2005.
Selon le syndic de la Chambre, c’est le rôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’encadrer le retour du représentant qui demande sa réinscription. « Qu’est-ce qu’on fait avec ceux qui ont déjà commis des fautes et qui reviennent ? On devrait les surveiller de plus près ? Doivent-ils être encadrés ? Ça, c’est le bout de l’AMF », note M. Ouimet.
La clémence
Au moment de faire ses représentations sur la sanction, est-ce que le syndic se montre plus clément envers le représentant qui a admis les faits ? « L’objectif de la discipline, c’est la protection du public », répond le syndic.
Le regard devrait être tourné vers l’avenir, insiste-t-il. « Personne n’a une boule de cristal. Tout ce qu’on a, ce sont les gestes, ceux du passé et les gestes actuels. » Selon lui, l’attitude de la personne qui reconnaît sa faute et qui propose des mesures pour corriger sa pratique et mieux se former est un élément à considérer.
Cela ne veut pas dire que le représentant visé par une plainte et qui refuse de reconnaître sa culpabilité doit être sanctionné de manière plus sévère, insiste-t-il. « On n’a jamais de garantie absolue, mais on a des éléments qui nous permettent de dire : on peut se baser sur ça pour espérer qu’il n’y aura pas de récidive », explique M. Ouimet.
La sanction doit être assez dissuasive pour obliger le représentant à corriger son comportement et à ne pas répéter la même faute. La récidive est ce qu’il y a de pire, de l’avis de Gilles Ouimet, car cela montre que le processus disciplinaire n’a pas fonctionné la première fois.
Parfois, cette volonté de s’amender n’est pas présente et c’est uniquement par la sanction que le message de dissuasion passe, conclut-il.
Appel de candidatures
Par ailleurs, la Chambre de la sécurité financière a récemment lancé un appel de candidatures pour devenir membre de son comité de discipline.
Le mandat dure trois ans et commence en 2024. La date limite pour poser sa candidature est le 20 octobre 2023. Le candidat doit exercer ses activités de représentant depuis au moins 10 ans.
Il doit notamment posséder la probité et l’intégrité nécessaires, avoir une conduite professionnelle exemplaire et être une référence pour ses pairs.
Le président de la formation qui entend la plainte, qui est toujours un avocat membre du Barreau du Québec, a droit à des honoraires pour chaque heure d’audition, de délibéré et de temps consacré à la rédaction de la décision. Le tarif prévu par règlement est de 120 $ l’heure.
Les autres membres désignés par le président du comité pour entendre la plainte ont droit à des honoraires de 300 $ par jour d’audition ou de délibéré. D’autres sommes sont prévues si le membre doit parcourir un trajet de plus de 80 km de sa résidence pour exercer ses fonctions. Cependant, cela est de moins en moins fréquent dans la mesure où les auditions se font de plus en plus souvent en mode virtuel.