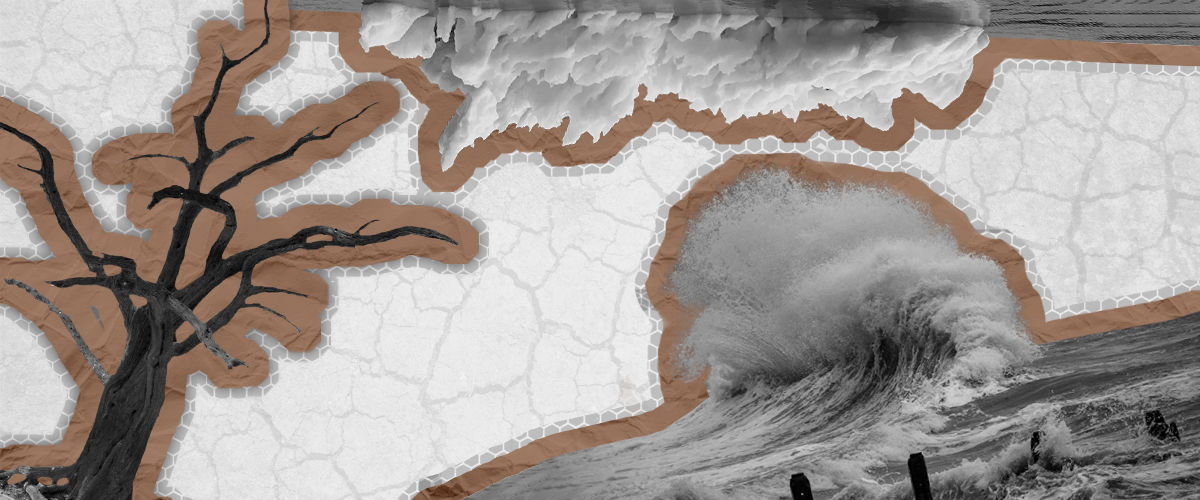L’année 2022 se termine avec de nouveaux signaux inquiétants en matière de changements climatiques qui confirment la nécessité de lutter contre le réchauffement global de la température.
Après la tenue de la 27e conférence de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur le climat tenue en Égypte en novembre, la 15e conférence de l’ONU sur la biodiversité vient de se dérouler à Montréal en décembre. Le Canada a accueilli cette conférence, car la Chine, le pays hôte, ne pouvait le faire en raison de la recrudescence de la pandémie de COVID-19.
À ces deux conférences, le gouvernement canadien a voulu montrer qu’il proposait des solutions pour améliorer la résilience des Canadiens à l’évolution du climat.
À la fin de novembre, le gouvernement soumettait à la consultation publique la Stratégie nationale d’adaptation du Canada. Les assureurs canadiens ont salué la publication du document de consultation.
À la fin du mois d’août, le gouvernement fédéral a rendu public le rapport du groupe de travail sur l’assurance contre les inondations et l’aide à la relocalisation.
Au Bureau d’assurance du Canada (BAC), on a bon espoir que le programme national permettra de mieux partager les risques. Son lancement était attendu avant la fin de l’année, mais il semble qu’il faudra attendre encore un peu.
Un nouveau mot
Après la difficile année 2021 en Colombie-Britannique, marquée par la sécheresse, la canicule, les feux de forêt et les inondations, les catastrophes naturelles ont été moins spectaculaires au Canada en 2022. Il a quand même deux tristes événements qui ont joint le top 10 des pires sinistres de l’histoire canadienne.
Le premier est relié aux violents orages qui ont frappé l’Ontario et le Québec le 21 mai, qui nous ont permis de découvrir un terme méconnu pour décrire un autre type de perturbation : le derecho.
Cette tempête a parcouru environ 1 000 km dans les régions les plus densément peuplées du pays. En plus de priver d’électricité plus d’un million de clients, au pire de la tempête, le sinistre a causé une dizaine de décès.
Selon Alain Bourque, du consortium Ouranos, ces épisodes climatiques extrêmes sont susceptibles de se reproduire de plus en plus souvent, au fur et à mesure que le climat se réchauffe.
Quelques semaines plus tard, le Bureau d’assurance du Canada (BAC) confirmait que le derecho du 21 mai faisait déjà partie des dix pires sinistres de l’histoire canadienne en matière de dommages assurés.
Selon Nicolas Milot, chef du bureau de projet de la Communauté métropolitaine de Montréal sur la gestion des risques d’inondations, les orages de l’été et de l’automne sont désormais susceptibles de créer encore plus de dommages que les crues printanières.
Quelques jours après ce derecho, le Réseau Inondations Intersectoriel du Québec (RIISQ) tenait son assemblée générale annuelle. La professeure Louise Hénault-Éthier y avait suggéré d’utiliser les infrastructures vertes pour améliorer la résilience des populations urbaines au risque d’inondations.
Dure saison des ouragans
La saison des ouragans a frappé aux deux extrémités de la côte est de l’Atlantique. Fin septembre, l’ouragan Fiona a été la première dépression tropicale majeure à causer des cheveux gris sur la tête des actuaires.
La tempête Fiona est devenue le pire sinistre en matière de dommages assurés de toute l’histoire des provinces maritimes, selon l’estimation du BAC publiée quelques semaines plus tard. Elle est devenue le deuxième sinistre de l’année à se glisser dans le top 10 des pires sinistres de l’histoire pour les assureurs.
L’ouragan Ian a suivi quelques jours plus tard et il a causé d’immenses dommages en Floride et dans les États voisins de la côte est américaine.
Les pertes subies par les assureurs sont susceptibles d’ébranler toute l’industrie, selon ce que rapportaient deux courtiers au Portail de l’assurance.
On s’attend d’ailleurs à ce que les conditions imposées par les traités de réassurance en cours de renouvellement forcent les assureurs de dommages à maintenir des hausses de primes supérieures à 10 % en 2023.
Le 20 septembre dernier, le BAC en Alberta a publié une compilation préliminaire des événements climatiques extrêmes survenus dans les trois provinces des Prairies en 2022. On y dénombre cinq sinistres importants.
La vulnérabilité
Dans son rapport sur les catastrophes du premier trimestre de 2022, Aon constatait notamment des écarts anormaux de température par rapport aux normales saisonnières observées à la mi-mars en Antarctique.
Des inondations particulièrement fortes en Australie font craindre des sinistres records dans les agglomérations urbaines les plus vulnérables.
L’Australie n’a d’ailleurs pas été épargnée par les inondations en 2022, car dans son bilan du troisième trimestre de l’année, Aon rapportait d’autres crues majeures sur la côte orientale et la situation continuait de se détériorer au début d’octobre.
Dans le sixième rapport du GIEC, cité par Aon dans son bilan trimestriel, on estime qu’au moins 3,3 milliards de personnes (42 % de la population mondiale) vivent dans des régions particulièrement vulnérables aux changements climatiques.
À la fin de juillet, Aon publiait le même bilan des sinistres couvrant le premier semestre de 2022. On y dénombrait 21 sinistres ayant provoqué des dommages supérieurs à un milliard de dollars américains. On y rapportait des épisodes de canicule particulièrement longs en Argentine, en France et en Espagne de même qu’au Pakistan. Une deuxième vague de canicule a d’ailleurs frappé plusieurs pays européens en juillet.
Résister à la canicule
Le Centre Intact d’adaptation au climat (CIAC) de l’Université de Waterloo a publié au début avril un troisième guide destiné à aider les Canadiens, après ceux sur les inondations et les feux de forêt publiés en 2021. Le plus récent guide porte sur la réduction des risques liés à la canicule.
On y constate qu’il y a trois zones plus densément peuplées qui sont plus susceptibles d’être touchées par le réchauffement du climat et la sévérité des canicules, situées en Colombie-Britannique, à la frontière méridionale des provinces de l’Ouest et dans la vallée du Saint-Laurent jusqu’au bord du lac Érié.
À l’automne, le CIAC a publié un nouveau rapport qui tente d’estimer la valeur financière des actifs naturels à l’ère des changements climatiques.
On y constate que si quelque 90 municipalités ou gouvernements locaux ont adopté une approche de gestion des actifs qui inclut cette valeur des milieux naturels, seulement 5 sont au Québec.