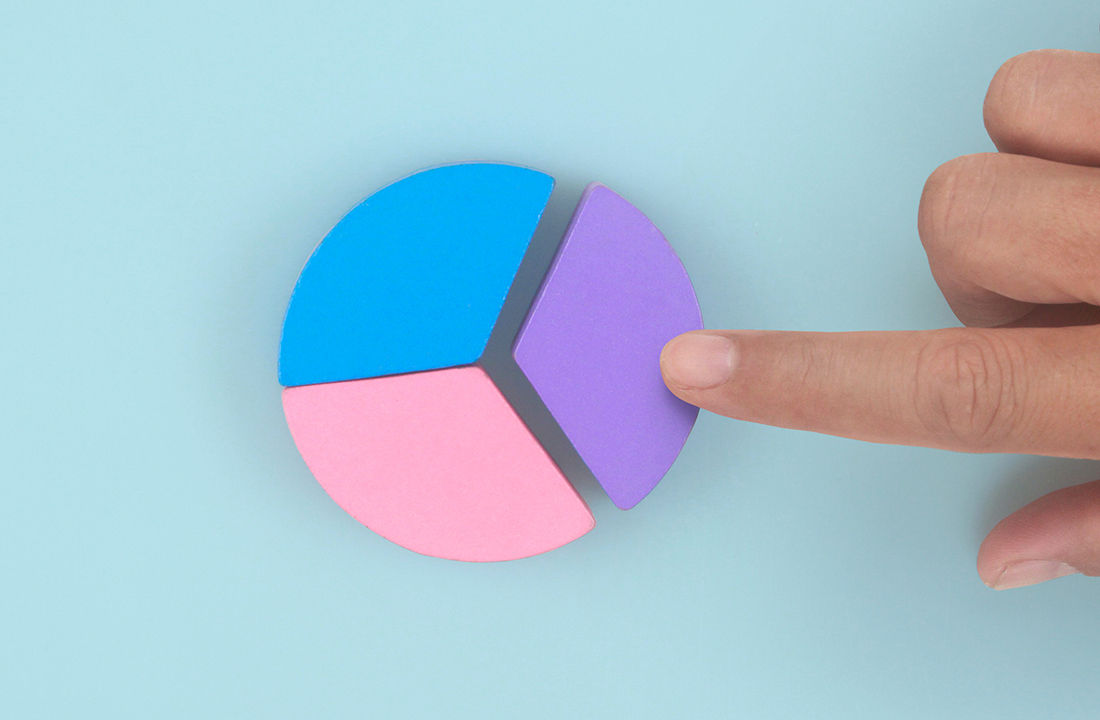La division administrative et d’appel de la Cour du Québec confirme les deux jugements rendus par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages à l’encontre de la courtière Chanel-Anoushka Giroux (certificat no 193 501).
Après avoir entendu les parties le 6 février 2024, le juge Steve Guénard a rendu sa décision le 15 mars dernier. La Chambre vient de publier un avis confirmant que la peine de radiation temporaire est purgée depuis le 15 avril 2024.
L’intimée a été déclarée coupable de quatre infractions en septembre 2022.
La décision sur la sanction a été rendue en juin 2023. À la suite de la publication de la dépêche confirmant la peine de neuf mois de radiation temporaire, le Portail de l’assurance avait fait une mise à jour le 20 septembre 2023 pour confirmer que les deux décisions rendues par le comité de discipline étaient portées en appel.
La décision de la Cour du Québec s’allonge sur 37 pages. L’appelante ne conteste pas qu’une licence de l’Organisme d’autoréglementation des courtiers en Ontario (RIBO) était nécessaire afin d’agir comme courtière en lien avec un risque situé en Ontario et qu’elle ne détenait pas ce permis.
Les procureurs de l’appelante postulent plutôt que, comme l’assurée et son administrateur sont ontariens, tout comme les assureurs contactés par l’intimée, l’appel devrait être accueilli, car le comité de discipline n’avait pas la juridiction ni l’autorité nécessaire pour rendre sa décision, vu le caractère extraterritorial des faits et gestes reprochés. Le juge Guénard souligne que cet argument n’a jamais été avancé devant le comité.
De plus, l’appelante estime que le comité aurait dû ordonner la suspension conditionnelle quant aux condamnations reliées aux chefs 4 et 5 de la plainte, en plus de contester la sanction de neuf mois pour chacun des quatre chefs.
De leur côté, les procureurs du syndic de la Chambre rappellent que l’intimée a affirmé, en première instance, n’avoir jamais agi comme courtière pour ce risque localisé en Ontario, prétention rejetée par le comité de discipline.
La décision sur culpabilité
La Cour du Québec note que le débat sur la norme applicable en appel ne concerne que la question relative à la compétence juridictionnelle du comité à l’égard des faits et gestes reprochés à la courtière. À l’égard des sanctions prononcées, le tribunal ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste.
L’avocat du syndic énumère plusieurs éléments qu’il aurait aimé soumettre si Mme Giroux avait soulevé en première instance un quelconque doute quant à la compétence du comité de discipline.
La présentation de l’argument sur l’absence de compétence du comité devant le tribunal d’appel est tardive, selon le juge Guénard. Les procureurs de la courtière affirment que cet argument leur est apparu à la lecture de la décision sur culpabilité, mais le tribunal n’en est pas convaincu.
En plus, même si l’argument avait été présenté en temps opportun devant le comité le tribunal estime qu’il est mal fondé. En manière disciplinaire, la juridiction est personnelle et non territoriale, comme en fait foi une « longue et foisonnante jurisprudence », indique le tribunal.
La courtière, qui mène ses activités au bureau de Laval du cabinet qui l’emploie, est intervenue dans un dossier épineux et dont le risque était situé en Ontario. Elle ne connaissait nullement la méthodologie à utiliser lorsqu’on doit recourir à un assureur de dernier recours. En agissant ainsi, elle a manqué à ses devoirs inscrits à l’article 17 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, indique le tribunal.
« Le professionnel conserve son titre, son chapeau de professionnel, peu importe où il se retrouve », indique le juge Guénard en citant un jugement rendu à l’encontre d’un médecin en 1985.
La décision du comité de traiter de la plainte formulée par le syndic est justifiée, raisonnable et correcte, conclut la Cour du Québec.
Quant aux autres moyens d’appel, les procureurs de la courtière devaient pointer du doigt une erreur manifeste et déterminante du comité dans la décision sur culpabilité pour chacun des chefs retenus. Aucun des arguments avancés n’est retenu par le tribunal d’appel concernant les chefs 1, 2, 4 et 5, et la décision sur culpabilité est maintenue.
Concernant l’apparent doublon des condamnations reliées aux chefs 4 et 5, il est exact que le comité trace un lien de continuité entre tous les chefs d’accusation. Il est manifeste que les chefs concernent une seule réclamation relative au même véhicule et les suites qui en ont découlé, indique le tribunal d’appel.
« Le fait qu’un continuum chronologique existe ne rend pas automatiquement applicable la règle interdisant les condamnations multiples », écrit le juge Guénard au paragraphe 146. Selon lui, il n’y a pas de redondance dans les condamnations, contrairement à ce que prétend l’appelante. La conclusion est la même pour le chef 5.
La décision sur la sanction
La Cour du Québec consacre ensuite une quarantaine de paragraphes pour étudier les motifs d’appel soulevés par les procureurs de la courtière à l’égard de la sanction, qu’ils jugent trop sévère.
L’appelante doit établir l’existence d’une erreur révisable à cet égard, rappelle le juge Guénard. À diverses reprises, les tribunaux ont rappelé qu’une sanction n’est pas déraisonnable du simple fait qu’elle puisse apparaître clémente ou sévère, poursuit-il.
Selon l’appelante, la sanction est purement punitive et vise à passer un message à la profession, message dont elle fait les frais. Elle ne soulève aucune erreur dans la décision sur la sanction.
Le tribunal n’est pas convaincu du caractère sévère ou purement punitif de la sanction imposée sur chacun des chefs, même s’il ne doute pas que l’appelante aurait préféré une pondération plus favorable des facteurs atténuants. Pourtant, le comité a analysé plusieurs d’entre eux, notamment celui portant sur l’appui et le soutien de son employeur qui limiterait « tout dérapage futur ».
L’exemplarité positive
L’appelante reproche aussi au comité d’avoir taillé la sanction en usant du concept d’exemplarité positive. L’objectif est de permettre au décideur de voir si le professionnel a cheminé entre le dépôt de la plainte et la date de l’audition sur la sanction.
Or, la courtière n’a pas témoigné à cette étape et le comité ne dispose d’aucune preuve qui lui permettrait de venir à la conclusion que l’intimée est en voie de se réhabiliter, selon le tribunal.
Enfin, l’appelante reproche au comité de discipline de s’être appuyé sur une décision rendue en août 2012 pour conclure à l’imposition des neuf mois de radiation, en notant que ce précédent ne présente aucune commune mesure avec son dossier.
Dans cet autre dossier, André Lacelle avait été reconnu coupable de 19 infractions, dont certains concernant la fraude. Six infractions ont été sanctionnées par la radiation permanente et 12 autres ont été punies par la radiation temporaire, dont quatre de cinq ans.
Or, le comité prend la peine de préciser qu’il « a été incapable de trouver un précédent jurisprudentiel qui se rapproche vraiment des faits dans la présente affaire ». La décision dans l’affaire Lacelle est utilisée par le comité pour les enseignements qu’il peut en tirer concernant l’imposition des peines. En conséquence, la décision sur la sanction est aussi maintenue, conclut le tribunal.