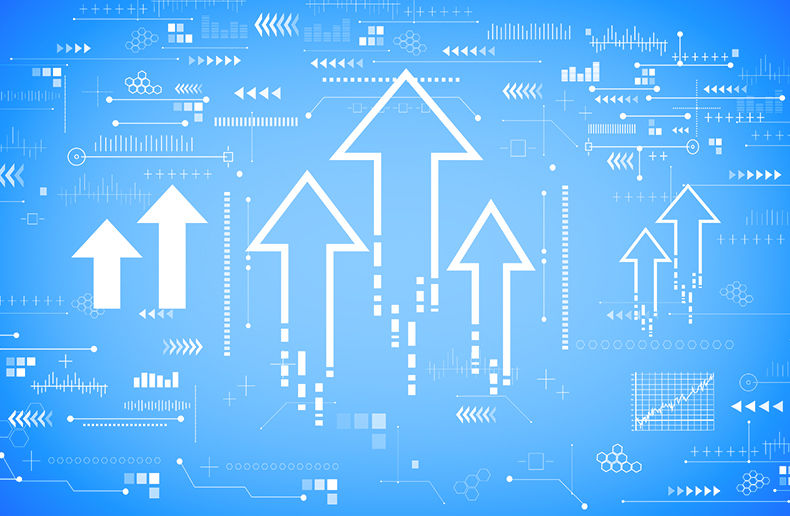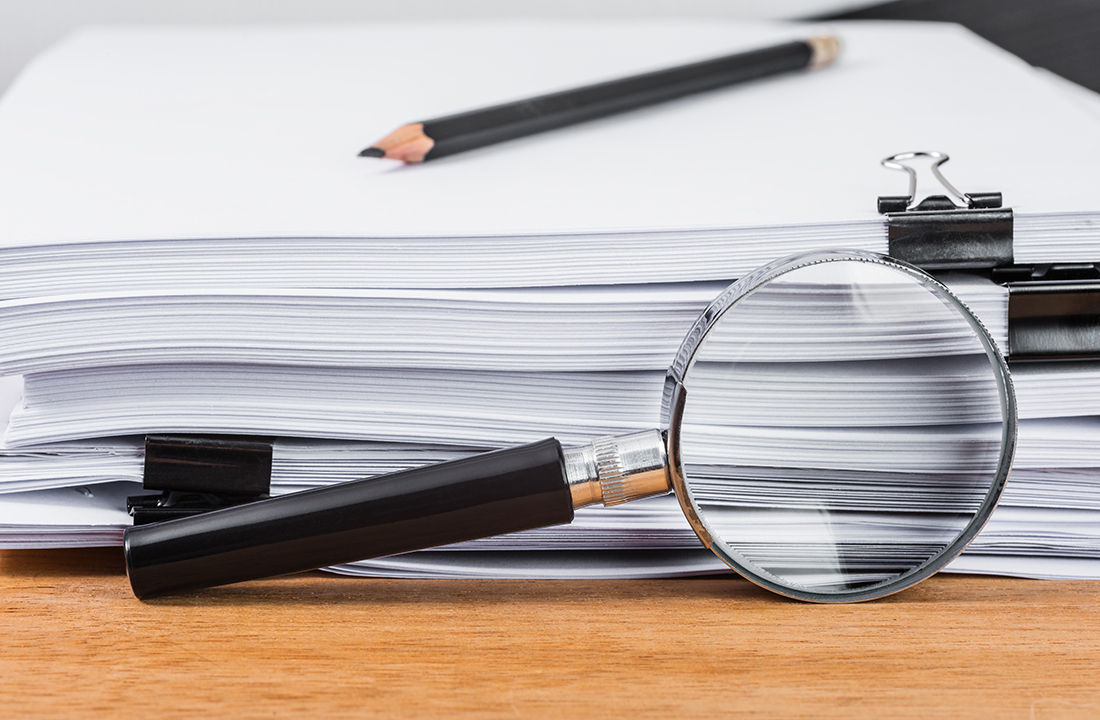Les sinistres découlant des événements extrêmes ont encore une fois été fort nombreux et coûteux en 2024. Le Canada a subi sa pire année à cet égard, en lien avec quatre événements majeurs survenus en moins d’un mois. Ces sinistres ont provoqué à eux seuls environ 228 000 demandes de règlement aux assureurs, selon le Bureau d’assurance du Canada.
D’abord, les 15 et 16 juillet dans la grande région de Toronto, une pluie diluvienne a provoqué des inondations majeures. Assez rapidement, dans une note publiée par Morningstar DBRS, on estimait que ce sinistre se comparait à l’inondation de 2013 à Toronto, ce qui laissait présager une facture d’au moins un milliard de dollars canadiens (G$ CA).
La facture sera finalement de 900 millions de dollars canadiens (M$ CA), selon l’estimation fournie par la suite par Catatrophes Indices and Quantifications (CatIQ), mais une autre pluie torrentielle survenue en août dans la même région ajoutera encore une centaine de millions de dollars en pertes assurées.
Ensuite à la fin de juillet, après plusieurs semaines de canicule et de sécheresse dans les provinces des Prairies, un feu de forêt rapidement devenu incontrôlable a ravagé la municipalité de Jasper, située en plein cœur du parc national du même nom en Alberta. Le sinistre a forcé l’évacuation de toute la population locale et des touristes et le tiers des bâtiments et des infrastructures a été rasé par le feu. Un mois plus tard, CatIQ estimait que les dommages assurés dépasseraient les 880 M$ CA.
Le troisième épisode a eu lieu le 5 août, une spectaculaire tempête de grêle a touché la région métropolitaine de Calgary, toujours en Alberta. Plus de 130 000 réclamations ont été faites. Les premières estimations faites par CatIQ rapportaient des pertes assurées de près de 2,8 G$. Un pompier forestier a perdu la vie en combattant les flammes.
Pire que le verglas
Le dernier des quatre sinistres majeurs de l’été au Canada, qui a dépassé en pertes assurées la facture du verglas de janvier 1998 au Québec, a touché la région métropolitaine de Montréal le 9 août dernier. Les restes de la tempête tropicale Debby ont provoqué des pluies diluviennes. Les infrastructures municipales n’ont pas été en mesure d’absorber les précipitations importantes tombées en seulement quelques heures, ce qui a provoqué des inondations pluviales.
Les assureurs ont été rapidement ensevelis par les quelque 70 000 réclamations enregistrées une semaine après l’événement, comme en ont témoigné deux responsables de l’indemnisation chez des assureurs. L’Autorité des marchés financiers a autorisé le recours aux surnuméraires par les cabinets d’expertise en sinistre et a haussé la limite de la réclamation que ces employés temporaires pouvaient traiter à 30 000 $.
Météo marquante
Dans la liste des 10 événements météorologiques les plus marquants de 2024, publiée le 10 décembre dernier par Environnement et Changements climatiques Canada (ECCC) les experts du ministère fédéral ont classé le froid glacial qui a frappé l’Ouest canadien en janvier dernier au troisième rang, derrière les feux en Alberta et les inondations qui ont frappé les provinces centrales durant l’été.
Dans cette même liste, on soulignait les particularités du début de l’été, où les populations des provinces maritimes suffoquaient sous la chaleur tandis que les Albertains grelottaient. Entre le 15 et le 20 juin, le mercure grimpait à 37,6 °C à Bathurst (Nouveau-Brunswick), un record historique, tandis qu’un avertissement de gel mettait en alerte la population des agglomérations d’Edmonton et de Calgary. Cet événement apparaissait au 9e rang du classement réalisé par ECCC.
En 10e place, on signalait les feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador en juin et juillet, qui ont notamment forcé l’évacuation de quelque 7 000 habitants de Labrador City entre le 12 et le 22 juillet.
À plusieurs reprises durant l’année, les agences de notation qui surveillent l’industrie se sont montrées rassurantes à l’égard des perspectives des assureurs canadiens concernant les sinistres climatiques.
Bilan provisoire
L’Institut Swiss Re a publié au début de décembre un rapport préliminaire des dommages et des pertes assurées associées aux catastrophes naturelles partout dans le monde. Les pertes découlant de ces événements sont estimées à 310 G$ US, en date du 5 décembre. La facture des dommages assurés approchait déjà 135 G$ US.
Pour une cinquième année consécutive, les pertes assurées dépassent la barre des 100 milliards de dollars américains (G$ US), ajoutent les analystes du réassureur.
Selon Aon, dans les neuf premiers mois de l’année, il y avait déjà eu 11 inondations majeures causant des dommages économiques supérieurs au milliard de dollars, dont sept sur le continent asiatique. Ce nombre n’incluait pas les inondations causées par l’ouragan Helene en Caroline du Nord ni celles associées à l’ouragan Milton en Floride.
Le groupe Reinsurance Group of America a publié une note à l’automne qui indique que la mortalité à long terme liée aux événements climatiques extrêmes n’est pas bien mesurée et quantifiée. Quelque 99 % des décès associés aux cyclones tropicaux surviennent plus de 21 mois après l’événement, rapportaient les chercheurs.
Ouragans
Les tempêtes tropicales ont été à l’origine d’une bonne partie des dommages assurés. À eux seuls, les ouragans Helene, vers la fin de septembre, et Milton, survenu deux semaines plus tard, ont entraîné des pertes assurées estimées à près de 50 G$ US, selon l’estimation faite par Swiss Re.
À propos de ces deux ouragans, l’organisme World Weather Attribution (WWA) estime que l’effet du réchauffement planétaire a contribué à empirer la sévérité de ces événements et les dommages qu’ils ont causés. Un constat similaire a été fait pour les inondations majeures survenues en Europe centrale du 12 au 16 septembre.
La tempête Beryl est devenue l’ouragan de catégorie 5 à survenir le plus tôt dans l’histoire moderne. Beryl a provoqué des dégâts du Texas à la région des Grands Lacs durant plus de deux semaines.
Le risque d’inondation
Un rapport publié par l’agence Moody’s révélait que le nombre de personnes exposées à un risque d’inondation augmente plus vite que la croissance de la population mondiale. Au début de 2024, un rapport de Statistique Canada faisait un constat similaire pour la proportion de la population canadienne qui résidait sur les côtes.
Selon Emmanuelle Bouchard-Bastien, professeure de l’Université Laval et conseillère à l’Institut national de santé publique du Québec, les victimes d’une inondation pluviale en milieu urbain ne sont pas aussi bien préparées à passer au travers de ce type de sinistre que les gens qui habitent près d’un cours d’eau ou sur les berges du fleuve.
Selon une analyse publiée par Morningstar DBRS, la nécessité d’adopter des mesures d’adaptation aux changements climatiques est devenue urgente. Parmi les 10 années les plus coûteuses au Canada pour les pertes assurées dues aux intempéries sévères, outre la tempête de verglas de 1998, toutes les autres ont eu lieu depuis 2011. De plus, les populations urbaines subissent de plus en plus souvent les impacts des pluies torrentielles, des feux de forêt et des vents violents.
Le Centre Intact d’adaptation au climat (CIAC) de l’Université de Waterloo a d’ailleurs lancé un outil destiné à aider les municipalités à trouver des solutions pour réduire le risque d’inondation.
De son côté, la firme WTW a publié une étude qui établit un lien entre la désuétude des infrastructures et l’augmentation des pertes assurées, et ce, à l’échelle mondiale. Cela concerne les réseaux pluviaux, mais aussi les digues, les barrages et les infrastructures de transport d’électricité.
Au début de l’été, CatIQ rapportait qu’à la fin de 2023, une proportion plus grande de Canadiens s’était procuré une assurance contre les inondations.
Séismes
Dès le 1er janvier 2024, un séisme d’une magnitude de 7,5 a ébranlé le Japon. Selon les données de l’United States Geological Survey (USGS), on rapporte au moins 240 décès dans la région de Noto, dans la préfecture d’Ishikawa et les pertes économiques sont estimées à plus de 17,5 G$ US.
Le 17 décembre, un autre séisme d’une magnitude de 7,3 a frappé l’archipel du Vanuatu, dans l’océan Pacifique. D’autres secousses ont suivi et une alerte au tsunami a été lancée. Des dommages importants ont été signalés dans la capitale, Port Vila. L’épicentre du tremblement de terre a été localisé à 30 km à l’ouest de la capitale, à une profondeur de 57 km dans l’océan. Quelque 72 heures plus tard, on rapportait au moins 18 pertes de vie.
Il s’agissait du 10e séisme d’une magnitude supérieure à 7 à survenir en 2024, selon USGS. Un séisme d’une magnitude de 7,4 a frappé l’île de Taïwan le 2 avril dernier, causant 18 morts.
Durant l’automne, le CIAC a publié une étude sur le risque sismique propre au Canada. Les pertes économiques liées à un tremblement de terre en Colombie-Britannique ou dans le corridor entre Québec et Ottawa pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars, rappellent les auteurs du rapport.