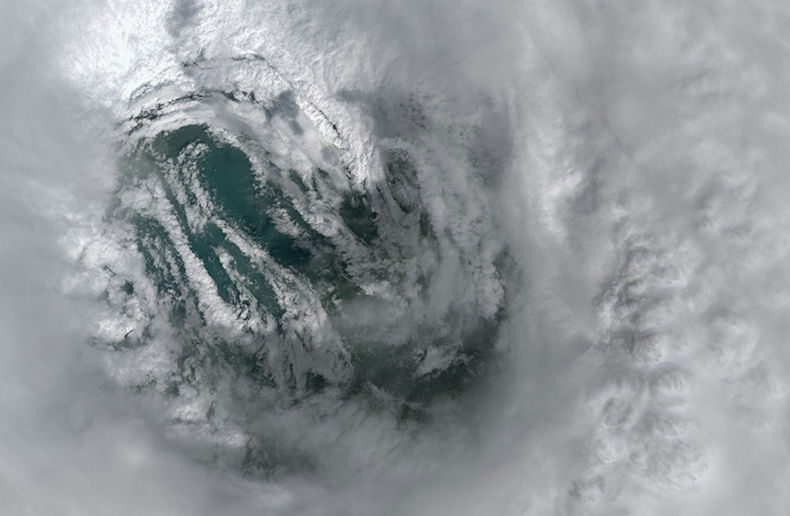La Cour supérieure du Québec a récemment rejeté les demandes de sursis faites par des assureurs concernant les demandes d’autorisation d’actions collectives qui les opposent à deux restaurateurs qui veulent être indemnisés pour les pertes d’exploitation découlant de la pandémie de COVID-19.
L’avocat Maurice Charbonneau, du cabinet Trivium, nous a informés de la publication de cette décision datée du 15 octobre 2021, rendue par le juge Gary Morrison.
De nombreux assureurs de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan sont visés par diverses procédures qui touchent différents secteurs d’activités. Des requêtes similaires ciblent des assureurs au Québec. Le juge Morrison a tranché les demandes d’action collective provenant de deux restaurants, l’Académie et Elixor. Les deux dossiers sont soumis par le même procureur, Me Laurent Debrun du cabinet Spiegel, Sohmer.
La première demande cherche à réunir les entreprises qui exploitent des restaurants ou des bars qui ont été contraints à la fermeture ou à limiter leurs activités à des services de vente pour emporter ou de livraison. La deuxième demande souhaite représenter le même groupe d’entreprises, mais en y incluant les cafétérias, les services de restauration à emporter et les services de traiteur.
Requêtes en sursis rejetées
Une troisième demande de sursis a été soumise par un exploitant de centre de conditionnement physique, Buzzfit. Me Christine Nasraoui, procureure du cabinet Merchant, fait valoir que la demande de sa cliente a préséance sur celles des deux restaurateurs.
Les assureurs Promutuel et Aviva allèguent que la demande de Buzzfit a été déposée en premier et vise les mêmes parties que celles soumises par les deux exploitants de restaurants. Ensuite, ils plaident que les actions collectives déposées dans les autres provinces concernent les mêmes parties, faits et objets.
Dans le cas du restaurant l’Académie, les assureurs intimés sont Aviva, Everest, la Souveraine/Sovereign et HDI Global. Aucune autre demande d’action collective ne touche les trois derniers assureurs. Aviva est l’assureur principal à 33 %, tandis que HDI et Everest couvre 25 % de la garantie et la Souveraine 17 %.
Dans le cas d’Elixor, la requête nommait seulement Promutuel Assurance comme partie intimée. Dans le cas de Buzzfit, ce sont 28 assureurs qui sont visés par la demande, incluant les 16 mutuelles membres de Promutuel.
La demande de Buzzfit (17 avril 2020) a été déposée avant celles d’Elixor (13 mai 2020) et l’Académie (28 août 2020). Il n’y a donc pas d’ambiguïté sur la préséance de la poursuite intentée par Buzzfit, selon le tribunal.
Pas d’identité de cause
Même s’il y a le minimum requis d’un défendeur commun, il n’y a pas d’identité de cause, plaide Me Laurent Debrun, et le juge Morrison lui donne raison.
Selon le tribunal, il existe un risque non négligeable que la réclamation de Buzzfit ne puisse aller de l’avant, car sa police d’assurance comprend une clause de règlement des différends. Les avocats de Buzzfit ont déposé d’autres demandes ailleurs au Canada, notamment contre 16 assureurs en Ontario et contre 25 assureurs en Saskatchewan.
Pour la demande d’Elixor, il n’y a aucune identité des parties ni des causes. Les actions collectives menées hors Québec sont nombreuses et ce risque de jugements contradictoires est très présent, souligne le tribunal.
Même si les parties et l’identité de cause étaient les mêmes, le juge Morrison aurait tout de même rejeté les requêtes en sursis, car un tel délai aurait été désavantageux pour les membres putatifs de l’action collective au Québec. Les demandes de sursis sont rejetées et les parties se reverront à l’étape de la demande d’autorisation.
Confirmation en appel
Par ailleurs, le 26 octobre dernier, la Cour d’appel du Québec a confirmé la décision rendue le 14 janvier 2021 en Cour supérieure et a rejeté la demande d’appel de la compagnie 9369-1426 Québec inc. (DBA Restaurant Bâton Rouge). Le juge Morrison avait donné raison à l’assureur Allianz Global Risks et avait envoyé les parties en arbitrage. Le restaurateur avait soumis une demande d’autorisation en action collective, laquelle a alors été rejetée.
Selon Me Laurent Debrun, procureur de l’appelante, les restaurants de la chaîne MTY ont tous des contrats similaires qui prévoient la médiation et l’arbitrage en cas de litige sur l’interprétation du contrat ou l’estimation des dommages.
Les trois juges de la Cour d’appel ont confirmé cette décision favorable à l’assureur Allianz. Cette décision a d’ailleurs servi de précédent dans les décisions rendues à la fin de novembre par la Cour d’appel dans deux autres requêtes intentées par des cliniques dentaires à l’encontre des assureurs, toujours en lien avec la garantie couvrant l’interruption des affaires.
En présence d’une clause de médiation et d’arbitrage dans le contrat d’assurance, le tribunal estime opportun que les parties passent par cette voie au lieu de se disputer devant les tribunaux.
La prochaine étape
Aucune date n’a encore été fixée pour les demandes d’autorisation des deux autres restaurants représentés par Me Debrun. Le procureur a obtenu les polices concernées par les décisions rendues par la Cour d’appel le 26 novembre dernier. « Pour les recours intentés par Elixor et L’Académie, on est en train d’évaluer s’il y a une similitude dans la rédaction des clauses, de sorte que le raisonnement du juge Davis sanctionné par la Cour d’appel trouverait application. Je suis en train de faire cet exercice », dit-il.
Le procureur rappelle que la police de l’assureur doit être précise. « Ce sont des polices tous risques, et après cela, on a des exclusions. La règle d’interprétation est que, à moins qu’une exclusion s’applique clairement, tout est couvert par la police. C’est donc le travail de l’assureur d’exclure et si la police n’exclut pas un événement comme une pandémie, ou une situation comme ça, à ce moment-là, l’assureur est à risque que la police soit interprétée en faveur de l’assuré », précise Me Debrun.
Le meilleur exemple de l’importance de la terminologie propre à chaque police est le cas de l’action intentée par la clinique dentaire contre l’Unique, qui a été autorisée. « C’est en raison des mots qui manquent dans la police que le même juge Davis en est venu à la conclusion qu’il y avait matière à aller de l’avant avec l’action collective. Ça ne veut pas dire qu’ils auront gain de cause, mais au moins, on peut en débattre », explique Laurent Debrun.
Être le premier ne suffit pas
L’autre aspect intéressant de la décision rendue le 15 octobre par le juge Morrison concerne la règle du premier arrivé, premier servi. En droit québécois, la règle dit que le premier à déposer une demande d’action collective au Québec est généralement celui qui ira de l’avant.
« Dans le cas qui nous concerne, même si Merchant a déposé le dossier de Buzzfit avant les nôtres, le tribunal conclut que ce n’était pas un moyen suffisant pour faire suspendre nos actions. La Cour supérieure conclut qu’il n’y a pas de risque de jugement contradictoire, car il n’y a pas identité de cause dans les affaires. Et à la demande des assureurs, elle a aussi conclu qu’il n’y avait pas matière à suspendre nos actions, malgré les multiples actions dans les autres provinces, pour les raisons qui sont exposées dans le jugement », ajoute Me Laurent Debrun.
Peu d’actions collectives autorisées
Jusqu’à maintenant, souligne Jessica Gauthier, un tout petit nombre de demandes d’action collective ont reçu l’autorisation de procéder. Avocate spécialisée en droit des assurances chez Stein Monast, Me Gauthier confirme qu’au stade de la demande d’autorisation en action collective, la preuve sur le fond du litige reste à faire.
« Malgré cela, dans certains cas, la demande a été rejetée par le tribunal en se basant sur le libellé des contrats d’assurance », indique-t-elle. Sur toutes les actions collectives reliées à l’interruption des affaires en raison de la pandémie, le seul dossier pour lequel la demande d’autorisation a été accordée est celui du Centre dentaire boulevard Galeries D’Anjou et l’Unique Assurances générales, qui a été accueilli par le juge Davis le 18 août dernier et dont la décision a été maintenue par la Cour d’appel le 26 novembre.
« Est-ce que le tribunal étirera l’interprétation jusqu’à dire que la présence d’un virus sur les lieux a atteint un bien assuré? Le mystère demeure entier, c’est difficile de se prononcer à ce stade-ci », dit-elle.
Ce type de libellé a déjà été discuté lors de litiges intentés par des assurés à la suite de la crise du verglas en 1998, durant laquelle de nombreux établissements ont été privés d’électricité durant plusieurs semaines. « La preuve des dommages matériels causée par la présence du virus devra être faite », ajoute-t-elle.
La nature de la couverture en assurance de dommages devra être plaidée, selon Me Gauthier. « Ça prend un sinistre qui cause des dommages aux biens des assurés. L’assureur paie la perte de revenus qui découle de ce sinistre. »
Les calculs actuariels des assureurs n’ont pas été faits pour inclure les pandémies mondiales dans le risque assuré. « Dans bon nombre de décisions rendues aux États-Unis, l’objectif de la couverture ne comprend pas ce risque en particulier. Évidemment, il faut que le texte du contrat supporte la prétention de l’assureur. Il faut que l’assureur ait prévu un dommage matériel aux biens. Aux États-Unis, c’est comme ça que les assureurs s’en sortent », dit-elle.
Aviva en Ontario
Nordik Windows est l’un des quatre dossiers pour lesquels l’assureur Aviva est poursuivi en Ontario par des demandes d’autorisation en action collective. Le 10 septembre dernier, la Cour supérieure de l’Ontario a autorisé la poursuite de ces actions, souligne l’avocate.
Dans le cas de cette entreprise et de trois autres entreprises compagnies, le mot à mot de la police concernant l’interruption des affaires ne précisait pas qu’il fallait un dommage matériel aux biens pour avoir droit à une indemnité pour la perte de revenus.
La faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie a créé un blogue (« Coverage COVID Litigation Tracker ») qui tient une mise à jour de tous les litiges du même genre reliés à la pandémie de COVID-19. Dans la très large majorité des cas, les assureurs ont gain de cause en première instance et devant les tribunaux d’appel, note Jessica Gauthier.