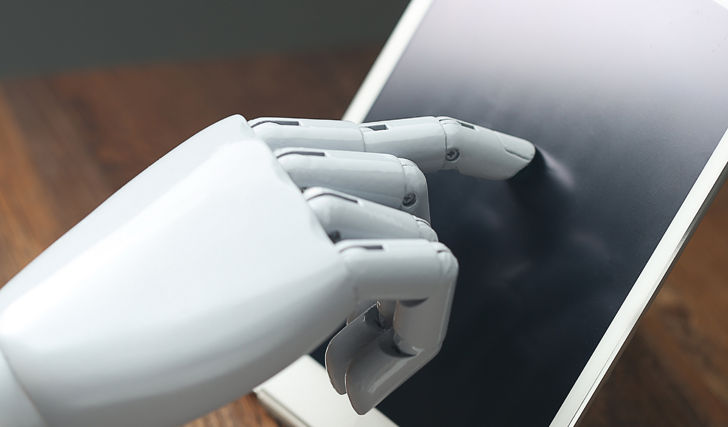La directrice générale de 42, Sophie Viger, estime que la solution à la rareté de la main-d’œuvre passe par une plus grande participation des femmes au marché du travail.
Sophie Viger, qui arrivait de France après un séjour au Japon, était conférencière à l’ouverture de la 3e édition d’Insurtech Québec, le 8 avril à Québec, l’une des nombreuses activités de la Semaine numérique. Elle estime que la révolution pédagogique en cours dans son organisation offre l’occasion d’augmenter la présence des femmes dans l’univers numérique.
Elle a présenté le modèle de l’école 42, dont elle est directrice générale depuis six mois. L’un de ses mandats était d’établir un peu plus de mixité dans les troupes admises à 42 et aussi dans l’univers numérique, largement dominé par le sexe masculin.
La formation offerte à 42 est gratuite, ouverte à toute personne intéressée par la programmation et âgée de plus de 18 ans. La pédagogie est inspirée de l’apprentissage avec les pairs. Par un fonctionnement participatif, sans cours ni professeurs, l’étudiant libère sa créativité en travaillant sur des projets.
Seulement dans l’Union européenne, pour les métiers associés à la programmation et à l’ère numérique, le nombre d’emplois à combler atteindrait 700 000 en 2020, dont 200 000 pour la France.
42 a été fondée en 2013 à l’initiative de Xavier Niel, un millionnaire du milieu des télécommunications en France. Après avoir peiné pendant des années à recruter, il a constaté que les meilleurs programmeurs venaient tous de l’école Épitech, fondée par Nicolas Sadirac, un adepte de la pédagogie active.
Il n’y a pas de frais de scolarité afin d’élargir le bassin potentiel de candidats en dehors des cercles habituels des classes privilégiées, comme ça se voit dans beaucoup d’écoles privées. Aucune condition n’est requise pour soumettre sa candidature. On a aussi mis fin à la limite des 30 ans et moins pour le recrutement.
Le recrutement passe par une épreuve d’immersion dite de la piscine. Durant quatre semaines, 7 jours par semaine et 24 heures par jour, les étudiants sont plongés dans les projets et apprennent à coder. Environ un tiers des candidats passe au travers. « Ça permet de renouer avec le désir d’apprendre, qui est très présent chez les enfants », explique Mme Viger.
Après avoir complété les sept premiers niveaux, l’étudiant est déjà un bon développeur. Il peut alors changer de campus pour se lancer dans une autre formation. En cours de route, il peut choisir l’une des trois branches principales : la sécurité, les algorithmes ou la création.
Pour atteindre le 21e niveau, l’étudiant peut prendre de 18 mois « si c’est un vrai génie, mais en travaillant fort, il y arrive en trois ans », explique Mme Viger. Le système fonctionne avec le principe du mur. Au début, le mur se rapproche, mais on le repousse en finissant des projets et en acquérant des points d’expérience. « Ça permet d’éliminer les paresseux qui ne font rien », dit-elle.
Avec l’expérience du Pôle Emploi, qui a réussi à former des chômeurs de longue date âgés de plus de 50 ans, on a supprimé la limite d’âge de 30 ans. Quelque 75 % d’entre eux ont réintégré le marché du travail. Selon Sophie Viger, cet exemple a fait croire qu’on allait ainsi trouver un bon nombre de candidates dans la trentaine, ce qui permettrait d’établir plus de mixité dans l’industrie. La suite lui a donné raison. En faisant sauter la limite d’âge, on se retrouve avec 70 % de femmes parmi les candidats de la tranche d’âge des 30-39 ans.
Quelque 40 % des étudiants de 42 n’ont même pas complété leur baccalauréat (français). Les finissants trouvent tous un emploi. La formation est axée sur la bienveillance et l’éthique, insiste-t-elle.
Plus de femmes
Lors de la piscine de février 2019, les femmes représentaient 26 % du bassin de candidats, comparativement à 15 % un an plus tôt. Pour la piscine de l’été 2019, la proportion des inscrites grimpe à 35 %.
À la première année de 42, seulement 7 % des candidats étaient des femmes. Jusqu’au début des années 1980, il y avait beaucoup de femmes dans les laboratoires informatiques, et on les appelait les « calculatrices », rappelle Sophie Viger. Ces emplois étaient peu valorisés.
L’avènement des ordinateurs personnels dans les années 1980 a été l’un des principaux facteurs du déclin de la présence féminine dans les laboratoires. Dans les métiers reliés à l’intelligence artificielle (IA), 95 % des emplois sont occupés par des hommes. Il existe d’autres métiers très genrés, mais dans l’univers numérique, on se prive ainsi d’un vaste bassin de main-d’œuvre alors que l’on manque de programmeurs.
« Ça a un impact monstrueux, car ce sont des métiers pérennes, très bien payés, où l’on peut s’éclater. Malheureusement, les femmes n’en profitent pas. C’est dommage, car l’on se prive de la moitié de l’humanité », dit-elle.
Il n’y a aucune raison pour que les filles soient moins bonnes que les garçons, insiste Sophie Viger. Par une sorte de prophétie autoréalisatrice, à force de se faire répéter que les filles ne sont pas bonnes en mathématiques, elles arrivent à le croire en constatant qu’elles sont peu présentes en sciences et génie.
« Donc, ça doit être vrai, je suis nulle », estime la jeune femme chaque fois qu’elle subit un échec, explique Mme Viger. Pourtant, cet apprentissage par l’échec est le fondement même de la pédagogie en programmation, poursuit-elle.
Il y a deux semaines, toujours avec le Pôle Emploi, on a réuni 350 femmes, parmi lesquelles on comptait bon nombre de femmes de milieu modeste, beaucoup de femmes à la peau noire ou de femmes voilées. « Quand on leur montre que faire du code, ça n’est pas du tout chiant, c’est même très rigolo. Dans combien de métiers on peut lancer un gros “YES” en brandissant le poing quand on fait un bon coup ? C’est très gratifiant, le code, quand ça marche, on est très content », dit-elle.
Ce sentiment aide à développer la fibre entrepreneuriale, car les étudiants apprennent à réaliser leur degré d’autonomie à réaliser un projet, au fur et à mesure qu’ils développent leur aptitude à coder. Pour les postes salariés, la rémunération est très bonne : les stages sont payés 1000 € par mois ; pour le stage de fin d’études, c’est 3 000 € par mois. Dès le premier emploi, le salaire mensuel grimpe à 4 000 ou 5000 €. « Ça ouvre des portes, ça donne de la flexibilité, vous pouvez travailler n’importe où », insiste-t-elle.
Inspiré par Douglas Adams
« 42 », c’est la réponse fourretout du mégaordinateur dans « Le guide du voyageur galactique » (Hitchiker's Guide to the Galaxy). Cette œuvre de Douglas Adams a d’abord été un feuilleton radiophonique en 1978 avant d’être déclinée sous différentes formes par la suite, dont une « trilogie romanesque en cinq tomes ».
Xavier Niel finance les activités de l’école, qui reçoit aussi divers dons et tire des revenus de contrats sous diverses formes. L’école 42 a aussi des partenariats avec d’autres écoles françaises, mais aussi en Afrique du Sud, en Russie, en Ukraine, au Maroc, en Belgique, etc.
Sophie Viger en promet d’autres sous peu avec des établissements du Brésil, du Japon et du Québec, espère-t-elle. À la fin de sa présentation, une jeune femme du Madagascar a offert son partenariat à Sophie Viger, car elle venait de fonder une première école de programmation dans son pays, où la formation est gratuite